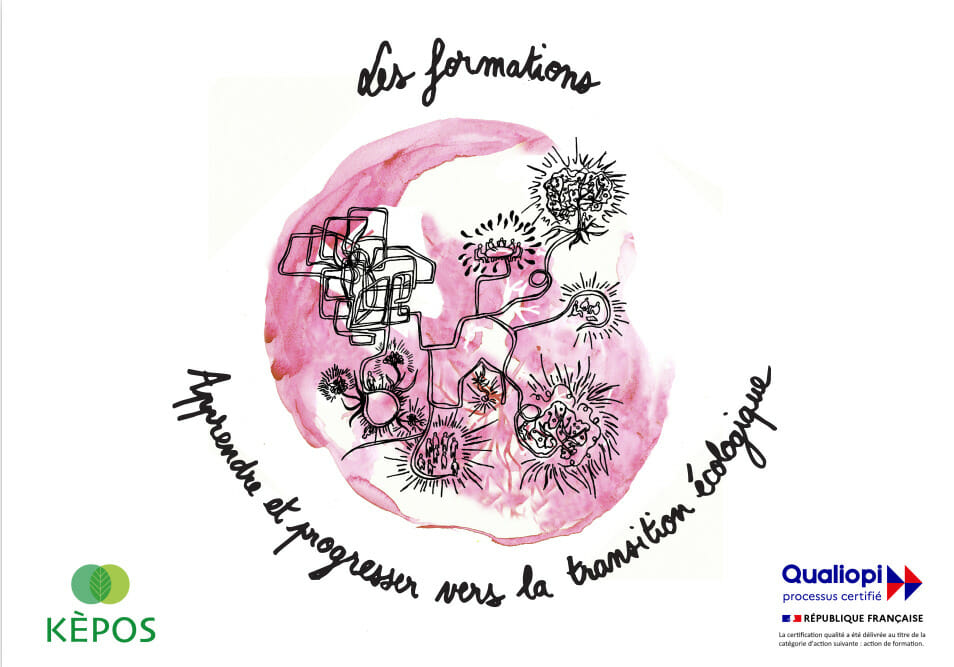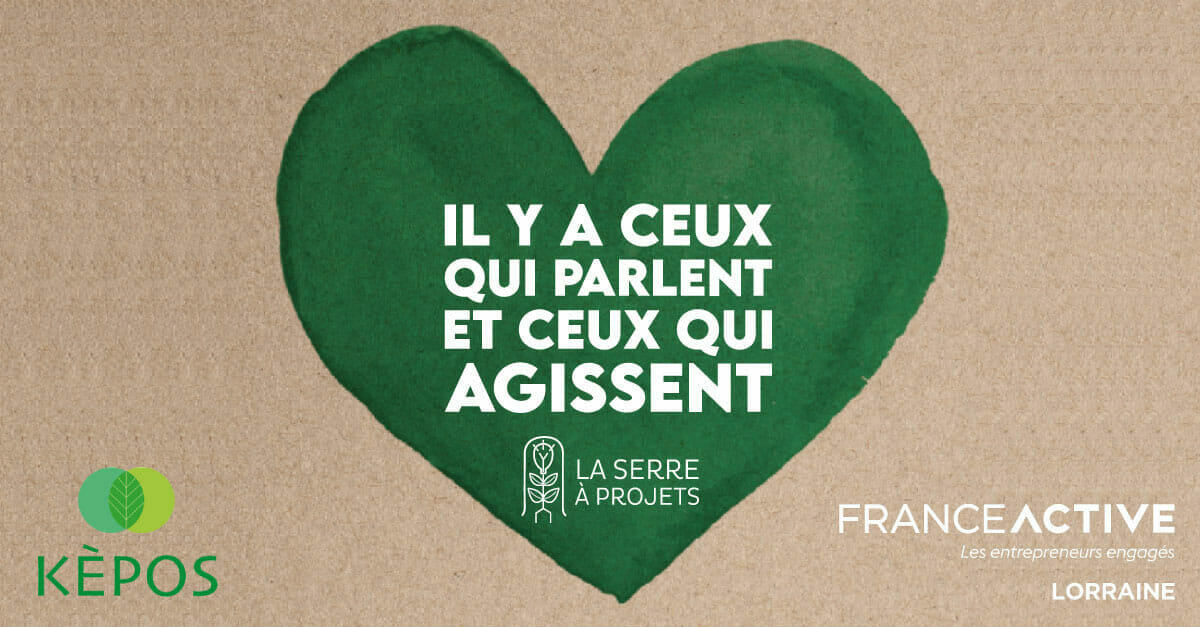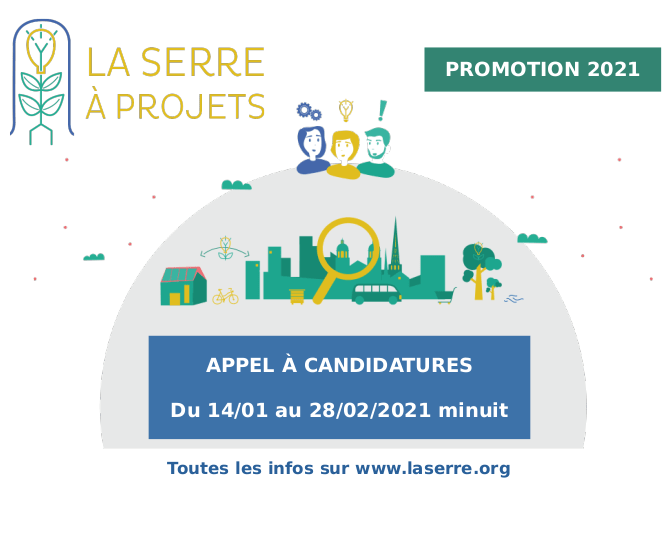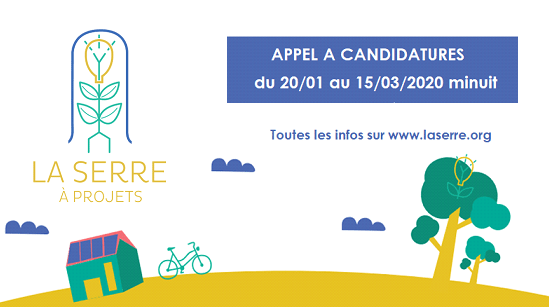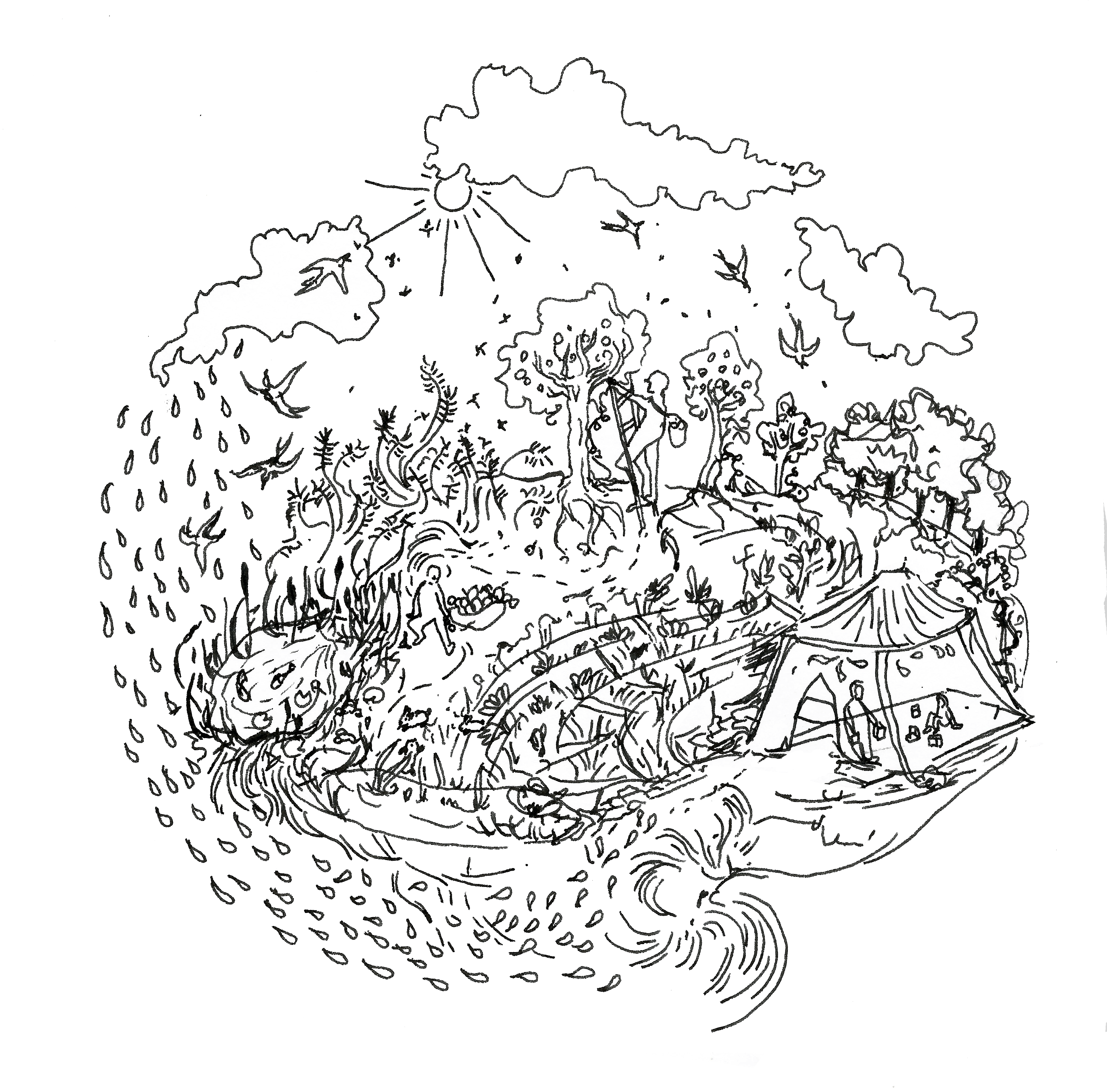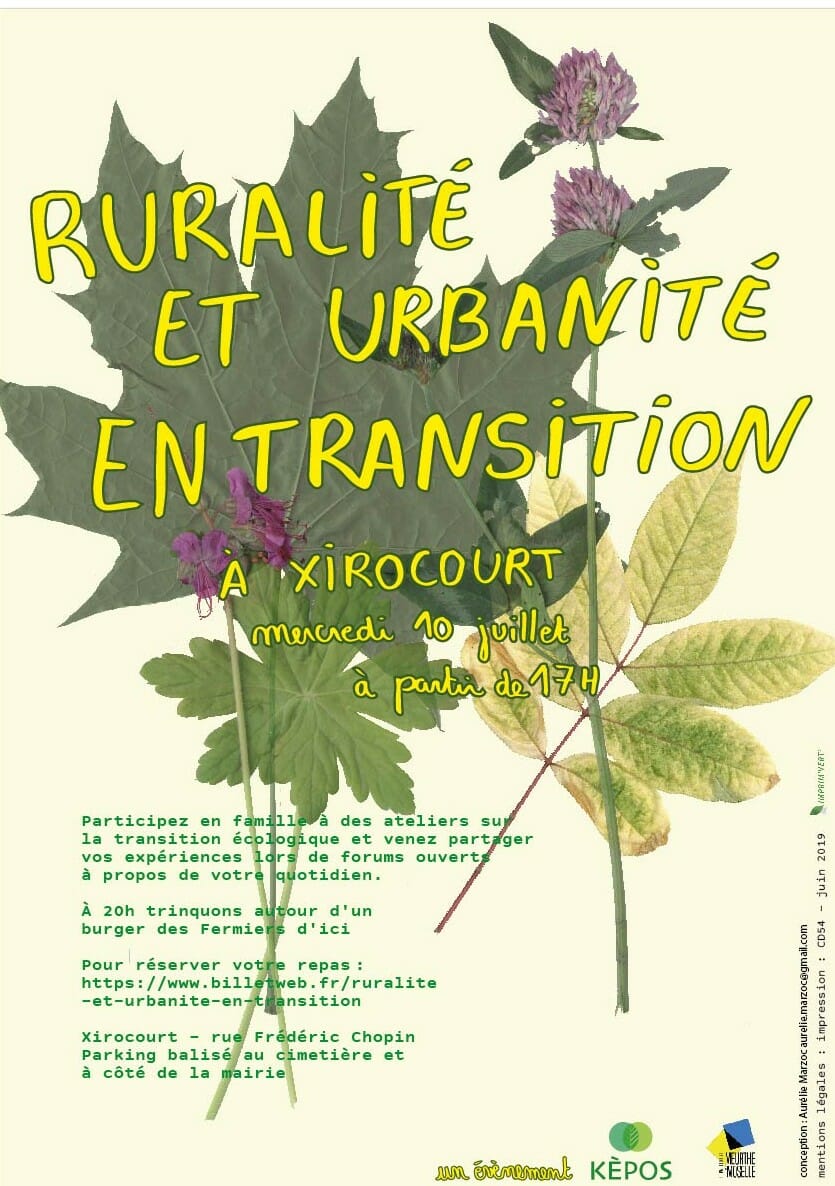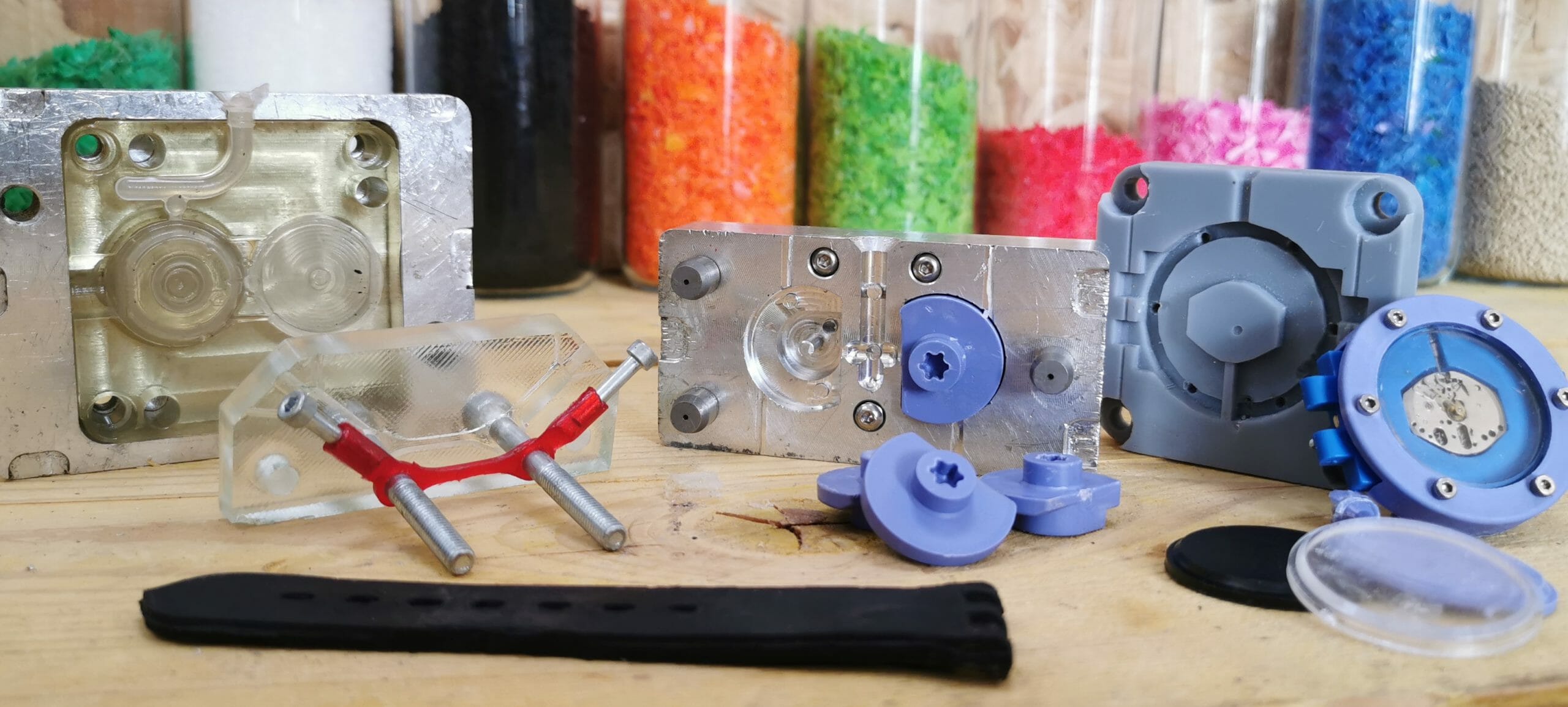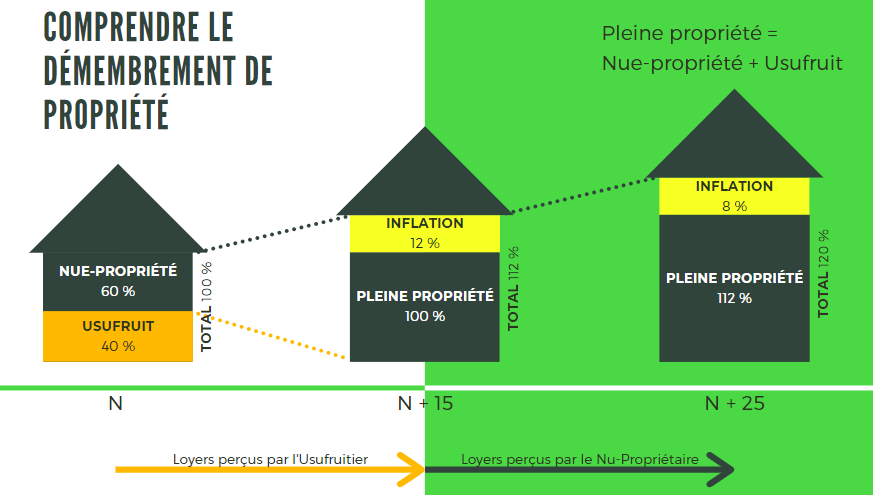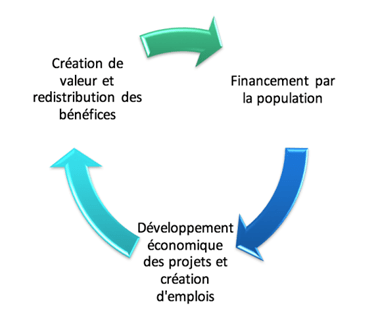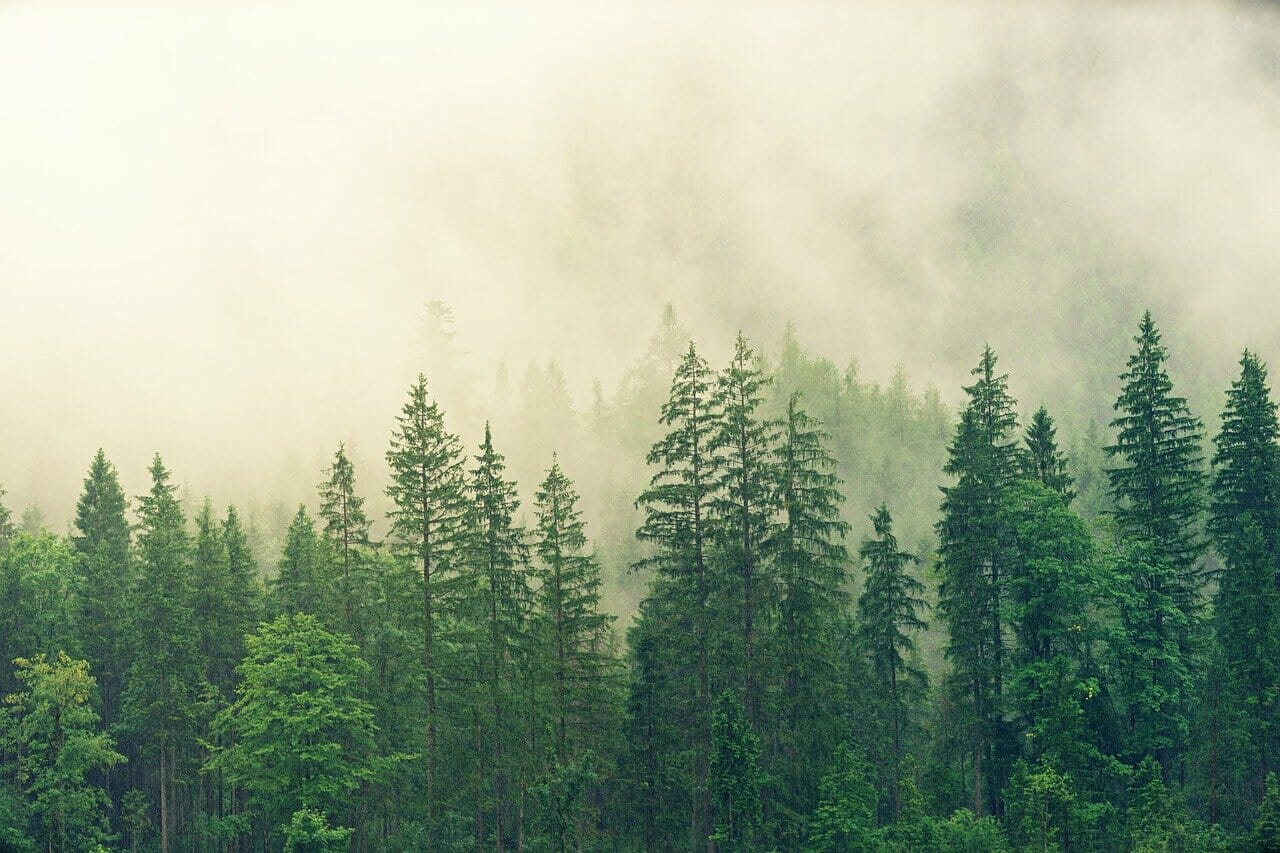A la une
22 août 2023Actualités / EvénementsÉtudiant.e sur le Grand Nancy à la rentrée ? Prêt.e à donner vie à ton nouvel appart ?Ne cherche plus !Fais le plein de pépites à prix mini avec la 1ère édition de la 𝗙𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 !𝗢ù ? 𝗦𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲s fêtes de 𝗚𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝘆 – Nancy𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 ? 𝗟𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟮 septembre de 𝟭𝟬𝗵 – 𝟭𝟴𝗵Tu cherches du petit électroménager, du mobilier stylé, des ustensiles de cuisine, des équipements high-tech, des vêtements tendance, du matériel de sport ou même un vélo ? Tout sera là, d’occasion et dans un esprit de solidarité et de durabilité.Un événement orchestré par 𝗟𝗲 𝗟𝗲𝘃𝗶𝗲𝗿, en partenariat avec la 𝗠étro𝗽𝗼𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆, le 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗩𝗶𝗲 𝗲𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆, la 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆, 𝗹’𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁é 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗖𝗿𝗼𝘂𝘀 𝗟𝗼𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲Viens retrouver nos héros locaux du réemploi :Recyclerie La Benne Idée, Les Ateliers Croix-Rouge Adlis, La Recyclerie de La Fabrique, Trucothèque, Recyclerie les 3R, De Laine en Rêves, Envie Lorraine, Repair café du Grand Nancy, Association Dynamo et Ecollecteurs, Association ALAIN, SOS FUTUR.Mais ce n’est pas tout ! Si ton toaster est capricieux ou si ta chemise préférée a perdu un bouton en cours de route, apporte-les ! Car tu pourras apprendre à redonner vie à ton toaster avec le Repaire Café et à recoudre les boutons de ta chemise avec Tricot Couture Service. Plutôt sympa, non ? De plus, nos experts Ambassadeurs de la Prévention et du Tri t’apprendront comment fabriquer tes propres produits ménagers et cosmétiques. Et pour couronner le tout, découvre comment le CROUS peut rendre ta vie étudiante encore plus cool.Comment nous rejoindre à la salle de Gentilly ?En Bus T2 direction Laxou Sapinière, arrêt Palais des Sports – GentillyEn Bus C2 direction Laxou Plateau De Haye, arrêt VologneEt devine quoi ? Le transport public est GRATUIT les week-ends !C’est GRATUIT et il y aura même de quoi satisfaire tes petites faims sur place !Invite tes amis à saisir l’opportunité et prépare une rentrée stylée et éco-responsable avec la FOIRE À L’ÉQUIPEMENT ! [...]
31 mars 2023Actualités / ArticlesKèpos, au travers de son centre de formation et de ressources « l’atelier de la transition », lance la programmation de ses formations 2023 sur son éco-lieu du Couarail à Vandoeuvre-lès-Nancy (54).
Pour vous inscrire c’est par ici ! Le prix de chaque formation est de 300 €, et peut être pris en charge par votre OPCO. Contactez-nous pour ne savoir plus : formation@kepos.fr.
Au menu :Au menu :
Le jeudi 6 juillet 2023 : “Transition écologique : comprendre les freins au changement”, par Samuel Colin, formateur chez Kèpos :
« Une de ces phrases vous parle peut être : « Je sais tout ça, mais que veux-tu que je fasse à mon niveau !», « A quoi bon, de toute façon, l’homme a toujours su rebondir », «Ce n’est pas à nous d’agir, c’est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités » . Pourquoi, alors que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir conscience des enjeux environnementaux, ne sommes-nous pas plus à agir ? Cette formation vous apportera des clés de lecture pour comprendre notre fonctionnement face aux changements et des pistes pour lever ces freins. »
Téléchargez ici le programme de cette formation.
Le jeudi 31 août 2023 : “L’éco-conception pour étoffer mon offre de produit ou de services”, par Ophélie Benito, Designer
« Formez-vous aux bases de l’éco conception en déstructurant le cycle de vie de vos produits et services. Apprenez à innover et améliorer votre offre en continu à partir des ressources du territoire. Découvrez les différentes méthodes d’innovation et de production respectueuses de l’environnement. »
Les jeudis 21 sept et 30 nov 2023 : “Comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action”, par Isabelle Jeannin, formatrice chez Kèpos
« Changement ou dérèglement climatique, finalement de quoi parle t-on ? Les informations se bousculent sur les enjeux environnementaux et il n’est pas aisé d’y voir clair, de prendre la mesure de ce qui se joue avec la transition écologique. Cette formation vous permettra à la fois de mettre de l’ordre dans votre perception des choses, de chasser les idées reçues, et surtout d’avoir des clés pour agir. »
Les 25 et 26 septembre 2023 : “Formation de formateurs” par Isabelle Jeannin et Samuel Colin, formateurs chez Kèpos
” Vous avez envie de transmettre vos compétences et vous avez besoin pour cela de maîtriser le cadre de la formation professionnelle pour les adultes afin d’animer efficacement des sessions de formation. Cette formation de 2 jours est faite pour vous donner toutes les clés pour bien démarrer une 1ère session avec des stagiaires “
Le jeudi 5 octobre 2023 : “Transition écologique et Objectifs de Développement Durable , comment articuler ces deux notions pour faciliter la sensibilisation ?”, par Isabelle Jeannin, formatrice chez Kèpos
” Vous avez envie d’accompagner la transition écologique de votre organisation mais vous ne savez pas par quel angle l’aborder. Vous connaissez les ODD, leurs liens avec vos activités n’est pas évidant pourtant vous sentez qu’ils pourraient être de bons alliés pour créer une dynamique de transition dans votre organisation. Venez découvrir le lien entre ODD et TE, comprendre comment les ODD peuvent être un atout pour lancer une dynamique “
Le jeudi 9 novembre 2023 : “Parler de mes convictions sans faire pression, écouter l’autre sans nier mes valeurs : initiation à la communication consciente” par Guilaine Didier, formatrice :
“Personne n’aime être un con-vaincu” (T. d’Ansembourg). Grâce aux clefs de la communication consciente (issue de la Communication Non Violente), venez comprendre et expérimenter ce qui, dans votre façon de vous exprimer et écouter, va favoriser l’ouverture et le dialogue autour des enjeux de la transition écologique. Ce qui au contraire ferme ou génère des réactions de défense, de déni. La communication consciente nous offre quelques belles clés pour nous rejoindre, fédérer et inspirer plutôt que se diviser, accuser et culpabiliser.“ [...]
29 octobre 2022Actualités / EvénementsLa transition écologique et solidaire impose de renouveler le tissu entrepreneurial local, et de faire émerger au plus près du terrain les activités engagées qui peuvent faire défaut sur le territoire. En effet il importe que, partout, de nouveaux services émergent et se développent, dans des domaines aussi variés que l’alimentation durable, les mobilités douces, l’économie circulaire ou encore les énergies citoyennes. Pour y parvenir, il peut paraître vain, ou en tout cas très long, d’attendre que les choses se fassent par elle-même. Les collectivités n’ont pas non plus la main pour développer cela en régie, sans risquer un épuisement de l’action publique. Il est donc essentiel que les acteurs d’un territoire sachent provoquer cette émergence. C’est précisément l’objet des fabriques à projets, ou fabriques à initiatives, que promeut l’agence d’innovation sociale Avise. Vous pourrez consulter sur ce sujet avec profit le livre blanc que celle-ci vient d’éditer sur les acteurs de l’accompagnement à l’entrepreneuriat durable.
Ces fabriques à projets sont des dispositifs partenariaux, mixant secteur public et secteur privé, qui visent à faire remonter du terrain des besoins non satisfaits en lien avec les enjeux de durabilité et de solidarité. A partir de ce travail diagnostic, il est mené une démarche d’idéation pour imaginer des idées d’activité à même de satisfaire ces besoins, puis d’étude de l’opportunité des projets qui pourraient en être issus. Ces projets en émergence sont alors confiés à des entrepreneurs sociaux du territoire, qui sont accompagnés jusqu’au lancement opérationnel des activités. On est donc bien là face à une logique d’entrepreneuriat inversé, où l’accompagnateur n’attend pas que le porteur de projet se manifeste, mais suscite le lancement des activités qui font défaut territorialement. Le benchmarking tient un rôle clé dans cette démarche : il s’agit d’observer ce qui se fait ailleurs, pour voir ce qui pourrait être transféré localement.
Pour des collectivités, ces fabriques à projets répondent à un vrai besoin, en ce sens qu’elles créent du partenariat entre le secteur public et le secteur privé, notamment l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Ce sont des démultiplicateurs d’initiatives, qui répondent à l’impuissance partielle d’une collectivité qui ne sait comment renforcer les services offerts sur le territoire sans les opérer elle-même. Elles constituent un moyen de créer des emplois durables non délocalisables répondant à des besoins sociaux, en misant sur la créativité des forces vives du territoire.
Kèpos a très tôt initié sur le bassin nancéien ce type de fabriques à projets, en coopération avec son partenaire historique, France Active Lorraine. C’est ce que nous avons appelé la « Serre à projets ». Celle-ci est en train de finaliser l’accompagnement de sa troisième promotion d’entrepreneurs, et a donné lieu à la création de plusieurs activités qui se sont depuis développées de manière ambitieuse : des recycleries, une conserverie de produits Bio et locaux, des services de mobilité douces, une coopérative funéraire, etc. Elle est financée par la Région Grand Est, le Département de Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand Nancy, la Ville de Nancy, mais aussi la Fondation GRDF, AG2R la Mondiale ou encore le Crédit Agricole. Pour aller plus loin dans la démarche, Kèpos et France Active Lorraine ont développé en 2021 une antenne de cette Serre à projets, nommée « Quartiers en transition », sur les Quartiers Prioritaires de la Politique de Ville (QPV) de la Métropole du Grand Nancy, grâce à des financements de l’État, de la Métropole et de la Banque des territoires. L’objectif : contribuer à la transition des quartiers en initiant des activités par et pour les habitants de ces lieux de vie.
Pour pousser plus avant la réflexion autour de ce modèle, Kèpos et France Active Lorraine vous proposent, en partenariat avec la Région Grand Est, une table-ronde sur le sujet le vendredi 4 novembre 2022 à 14h dans le cadre du Village des Solutions de Demain, qui se tient à l’Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle les 4 et 5 novembre prochain. L’occasion d’échanger avec des parties prenantes de cette dynamique : financeurs, opérateurs, bénéficiaires. Vous trouverez plus d’information sur cette rencontre sous ce lien. A bientôt ! [...]
10 octobre 2022ActualitésFace aux enjeux de la transition écologique, chaque acteur est mis en demeure de modifier sa stratégie et ses pratiques. Pour cela, les décideurs doivent réorienter leurs décisions, les agents faire évoluer leurs actions, et les particuliers transformer leurs modes de vie. Tout cela ne sera possible que si les acteurs ont les connaissances et les outils pour le faire. C’est pour cette raison que la question de la formation est une question clé de la transition.
Kèpos a très tôt voulu intégrer cet enjeu dans sa feuille de route. Notre SCIC est ainsi devenue centre de formation certifié Qualiopi en 2020. Elle propose ainsi à tous ses coopérateurs de développer leurs activités de formation sous sa bannière, contribuant ainsi à créer un véritable centre de formation de la transition écologique et solidaire. C’est ainsi que nos formateurs sont capables de vous accompagner et vous former sur des questions aussi variées que l’agroécologie, la biodiversité, l’énergie, le réemploi, le numérique responsable ou le climat. N’hésitez donc pas à consulter notre catalogue et à nous solliciter pour que nous construisions avec vous la formation dont vous avez besoin. [...]
6 septembre 2022Projets / Revues de ProjetsEn circulation depuis 2017, le Florain souffle sa cinquième bougie en 2022. Beaucoup de temps a passé depuis la première interview que nous avions dédiée à cette initiative. Le 8 octobre 2022, l’association fêtera dignement cet événement dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Nancy ! Cette date marquera aussi le lancement du Florain numérique, que chacun est invité à soutenir via un financement participatif. Pour parler de tout cela, nous rencontrons Virginie Hacquard, coordinatrice du projet et salariée de l’association.
Faisons connaissance : qui êtes-vous ? Comment en êtes-vous venu à participer au développement d’une monnaie locale ?
Salariée depuis juillet 2019, j’ai le rôle de coordinatrice au sein de l’association. Je suis pour le moment la seule salariée de la structure et j’occupe diverses missions avec l’appui d’autres bénévoles : la comptabilité, la participation aux groupes de travail et la mise en relation des bénévoles avec ces derniers, l’approvisionnement des comptoirs de change ou encore la gestion du stock de Florains. On peut dire que j’ai une vision globale de l’association. Avant de devenir salariée, j’ai eu connaissance du projet suite à une reconversion professionnelle qui m’a permis de découvrir le paysage associatif nancéien. Mes principales aspirations se sont tournées vers le mouvement climat avec les associations RAP Nancy, ANV COP21, Racines Carrées entre autres. C’est au bout de six mois d’aventure associative que je décide de postuler au Florain.
Quelles sont les principales évolutions vécues par le Florain depuis votre arrivée ?
Depuis mon arrivée il y a trois ans, j’ai pu assister et participer à de nombreux changements. Le réseau s’est très bien développé sur le territoire, touchant désormais tout le Sud de la Meurthe-et-Moselle, Lunéville ainsi que les côtes de Meuse. Nos partenaires se sont également multipliés : trois collectivités, les Villes de Nancy et Malzéville, et le Département de Meurthe-et-Moselle ont rejoint la monnaie. C’est une très bonne nouvelle pour nous et les habitants du territoire qui pourront payer dans un avenir proche les services publics en Florains.
De plus, notre projet de numérisation arrive enfin à terme cet automne, le 8 octobre 2022. Nous avions voté cette initiative lors de notre Assemblée Générale de 2020, ce qui représente plus de deux ans de travail. Derrière cet outil, nous avons pour objectif de toucher 1% des habitants du territoire, et de continuer à faire bouger les choses au plus près du terrain. Il nous permettra également de nous développer auprès des professionnels, et de rendre la circulation de la monnaie plus facile. En complément de toutes ces nouvelles activités, nous nous sommes rapprochés du mouvement SOL – réseau des monnaies locales complémentaires – à l’issue d’un appel à projets national. Nous avons candidaté et le résultat s’est révéler positif. En tant que lauréat, nous bénéficierons d’un accompagnement humain et financier sur trois ans.
Combien de Florains sont actuellement en circulation ? Chez combien de commerçants pouvons-nous les retrouver ?
Il existe à l’heure actuelle 82 monnaies locales en France, parmi lesquelles setrouve l’Eusko – monnaie du Pays basque – qui compte l’équivalent de plus de 3 millions d’euros en circulation. Début 2022, de notre côté, nous comptions 180 000 Florains en circulation sur le territoire Lorrain. Concernant les partenaires, nous en sommes à 206, de tous types : maraichers, boulangers, brasseurs, épiceries, petits commerçants, etc. Ils se regroupent autour de domaines d’activités très hétérogènes.”
Du point de vue interne, combien comptez-vous de bénévoles aujourd’hui ? Comment s’organise l’association ?
Nous comptons 25 bénévoles actifs, en légère augmentation ces derniers mois après l’organisation de plusieurs évènements sur la Metropole du Grand Nancy. La plupart viennent de milieux engagés liés aux mouvements écologiques et solidaires. Nous regrettons, cependant, de ne pas toucher plus d’étudiants car la moyenne d’âge est, pour le moment, au dessus de la trentaine.
Comment transformer ses euros en Florains ? Quelle est la démarche à suivre ? Ou pouvons-nous vous retrouver ?
Il faut être adhérent à l’association et se rendre dans un comptoir de change. Nous les avons répertoriés sur notre site internet. Pour rappel, un euro est égal à un Florain. Nous sommes par exemple tous les vendredis et tous les dimanches sur le marché de Vandoeuvre-lès-Nancy et le troisième vendredi du mois sur l’autre marché de Nancy près de l’Octroi. De manière ponctuelle, nous participons à différents évènements tels que “Jardins de Ville, Jardin de Vie”, qui se tiendra les 24 et 25 septembre prochain au domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange. Nous tenons notre site et nos réseaux sociaux à jour concernant les divers évènements sur lesquels nous avons l’opportunité d’avoir un stand.”
6. Quelles sont les perspectives à venir pour le projet ?
Plusieurs objectifs sont à relever ces prochaines années : un million de florains en circulation sur le territoire d’ici à 5 ans, embaucher une deuxième personne sur un poste de chargé de développement, travailler avec plus de collectivités, développer les groupes locaux et créer d’autres antennes de bénévoles sur des territoires autres que Nancy.
Alexandra Casas, Kepos [...]
27 juillet 2022Interviews Radio / ProjetsChloé Baduel met en lumière dans son émission radio les talents artistiques de Caroline Antoine, plasticienne et paysagiste membre de Kèpos. L’artiste a plusieurs cordes à son arc, que nous vous laissons découvrir dans cet interview réalisé dans l’émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy :
Vous pouvez retrouver ses œuvres, profondément inspirées par la poésie et le vivant, sur son site internet. Mais nous vous invitons également à découvrir son art le long des rives de Meurthe, dans le quartier des Grands Moulins à Nancy, en compagnie de la troupe artistique Melocoton. Notez dans votre agenda les prochains rendez-vous !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
23 juillet 2022RéflexionsOutre la fatigue, dont nous avons déjà parlé, le sentiment humain qui semble aujourd’hui un des mieux partagés, est l’anxiété. Les jeunes générations font couramment part de leur « éco-anxiété », ce sentiment diffus d’angoisse et d’impuissance qui croît à mesure que le changement climatique s’accélère. Il semble très lié à une impression pesante que la crise est insurmontable, et que l’action est vaine, parfois insincère, ou à tout le moins trop velléitaire.
Si ce sentiment naît chez certains d’une connaissance précise des enjeux climatiques ou de biodiversité, il est causé ou catalysé chez d’autres par la succession des épisodes aigus de nature écologique, sociale ou géo-politique, que nous vivons actuellement, et dont chacun pressent obscurément qu’ils sont liés. Plusieurs postures se font alors jour : la fuite, l’incantation, le repli sur soi, etc.
Comment, personnellement ou collectivement, faire face à ce sentiment d’anxiété qui paralyse ? Cela peut sembler d’autant plus difficile qu’il n’est pas du tout certain que les crises écologiques ou politiques que nous traversons soient solubles. Évoluant dans un monde conçus et façonnés par des ingénieurs, nous vivons sans doute dans l’illusion que tout problème a sa solution. Or, l’humanité fait aujourd’hui face à une difficulté à laquelle elle n’a jamais eu affaire : elle a généré une évolution de son cadre de vie qui petit à petit rend celui-ci invivable pour elle. La difficulté est hors-norme : elle concerne un macro-système qui collapse du fait de l’action d’un de ses agents internes. Celui-ci, à l’intérieur de ce système, doit le faire évoluer alors qu’il est complètement pris, englué dedans.
Au final, c’est notre rapport au monde qui est à interroger. En d’autres termes, la question fondamentale pour l’homme contemporain, est d’ordre métaphysique, ou à tout le moins anthropologique : « Quelle est la place de l’homme dans le monde ? ». Nous devons nous y confronter, sans nous abriter derrière des process techniques ou des habitudes sociales en espérant qu’ils répondent à notre place. Alors, une fois que nous aurons humblement envisagé la question , il nous faudra admettre qu’il existe quelque chose en dehors de nous, que l’homme n’est pas la mesure de toute chose, et que donc nous devons effectuer une sorte de retrait, au moins partiel.
Ce retournement, cette conversion, sont à envisager comme un processus de dépossession, de perte de contrôle consentie. Ce mouvement d’acceptation de notre vulnérabilité est fondamentalement anxiolytique : il ne nie pas l’angoisse, il permet de vivre avec. Et il reconfigure l’action. Aujourd’hui, si nous le voulons, il nous est possible d’agir avec mesure, non pour nous imposer à ce qui est autre, mais pour dialoguer avec l’autre, s’agencer à lui. Cette action qui transforme avec respect, qui reconfigure en reconnaissant l’altérité, est fondamentalement joyeuse.
C’est précisément ce renouvellement de posture que connaissent tous les grands malades qui arrivent à se rétablir, qui regagne une capacité d’agir : ils ne sont plus dans la toute-puissance antérieure, mais vivent avec la blessure ou la maladie, pour ajuster ce qu’ils sont à ce que leur environnement leur permet d’être.
Emmanuel Paul, Kèpos [...]
6 juin 2022Interviews Radio / ProjetsAu tour de la SCIC Energéthic, de se rendre dans les studios de l’émission “Bio diversité” de Radio Caraib Nancy. Face au constat des limites et impacts des énergies fossiles, Dominique Isler, fondateur de la coopérative, a fait le choix de se tourner vers les énergies renouvelables. Retrouvez des exemples de projets réalisés et à venir dans l’interview accordé à Chloé Baduel, animatrice de l’émission :
Suivez de près l’actualité de la SCIC. Des conférences sont régulièrement données sur la Métropole du Grand Nancy.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
31 mai 2022ActualitésKèpos développe avec l’association d’insertion ULIS un parcours de formation aux métiers de la Transition Écologique sur trois mois du 27 juin au 14 octobre 2022. Ouverte à tout type de public âgé de 16 ans minimum, cette démarche pédagogique alterne théorie, pratique et activation des savoir-être professionnels autour de la construction de leur projet professionnel. En tant que Stagiaire de la Formation Professionnelle rémunéré, l’action ouvre droit à :
L’AREF si demandeur d’emploi percevant l’ARE Ou une rémunération de la Région (Docaposte)
Cette action sur mesure est financée par la Région Grand-Est, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Politique de la Ville et la Métropole du Grand Nancy.
En partenariat avec la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, la formation se déroulera sur le terrain de Biancamaria, rue des Écuries, dans les locaux d’ULIS, rue d’Echternach et la Salle du Vélodrome de la Ville.
Le programme s’articule autour de trois pôles techniques : l’écoconstruction et les métiers du bois, les énergies renouvelables et les espaces verts. Un pôle spécifique vise, quant à lui, à accompagner les personnes via un suivi personnalisé :
Travail sur les soft skills (126 heures)
Sensibilisation à la Transition Écologique (28h)
Bilan de compétences, technique de recherche d’emploi, travail du projet professionnel (35h)
Communication et gestion de conflit (21h)
Écoute, confiance en soi, motivation, travail autour des métiers et de la posture (28h)
Aisance informatique, numérique responsable (14h)
Parcours personnalisé (40h)
3 entretiens de suivi individuels (3h)
Immersion en entreprise pour découvrir et confirmer son projet (35h + 2h de visite)
Approche des métiers du bois (189 heures)
Apprentissage des techniques manuelles élémentaires de la construction bois (175 heures)
Recyclerie : réemploi et création de mobilier (14 heures)
Énergies renouvelables (63 heures)
Réglementation électrique, sécurité travaux en hauteur et fonctions photovoltaiques (28 heures)
Immersion en entreprise : montage échafaudages, pose des panneaux et mise en service (35 heures)
Métiers liés aux espaces verts (105 heures)
Design et conception paysagère (14 heures)
Interprétation de la composition des sols (21 heures)
Animation et découverte de la biodiversité (7 heures)
Jardinage, maraîchage, élagage, cueillette.. (63 heures)
Vous trouverez des informations complémentaires sur le dispositif en parcourant ce document. Si ce dernier vous intéresse, nous vous invitons à remplir ce dossier de candidature.
Nous organisons deux réunions d’information collectives dans les locaux de l’Agence Pôle Emploi de Vandœuvre-lès-Nancy, 2 allée de Rotterdam, le 7 juin à 14h et le 16 juin à 9h. Contactez Magali Lergenmüller, en charge du projet chez Kèpos, à l’adresse suivante magali@kepos.fr ou Séverine Taulin à s.taulin@ulis.fr si vous souhaitez y participer.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
27 avril 2022Interviews Radio / ProjetsOphélie Benito, fondatrice de la SARL Mollis, spécialisée dans la conception et fabrication d’équipements bio-sourcés pour le soin des personnes fragiles, répondait aux questions de Chloé Baduel dans son émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy. Découvrez les engagements sociétaux de cette jeune entreprise du bassin nancéien :
Si cette nouvelle manière d’appréhender le soin des personnes vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’entreprise à l’adresse suivante : contact@mollis.fr. [...]
20 avril 2022Projets / Revues de ProjetsNous rencontrons aujourd’hui Chloé Lelarge, fondatrice de l’association Frugali, cabinet d’expertise en pratiques et alimentation durable. Elle revient sur la genèse du projet et ses missions en matière d’alimentation durable.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Chloé Lelarge, j’ai débuté mes études par une prépa littéraire et j’ai ensuite poursuivi en sciences sociales avec un master en géographie de l’Alimentation et des Cultures Alimentaires à La Sorbonne. Mes études m’ont permis d’acquérir une vision globale des pratiques alimentaires. Après l’obtention de mon diplôme, j’ai travaillé pour la restauration collective sur les questions d’alimentation durable en Ile-de-France. C’est à mon retour à Nancy, à la fin de mon contrat, que se développe ma prise de conscience écologique. Je participe à des événements autour du Zéro Déchet et c’est à ce moment que je rencontre Anais Streit.
Anais est formée en neurosciences et gestion de projets, nous comprenons rapidement que nos profils se complètent. Notre objectif, celui de relier nos convictions écologiques et compétences professionnelles dans le but de faire évoluer les pratiques en entreprise sur les questions alimentaires, se dessine doucement. C’est grâce à La Serre à Projets que le projet est officiellement lancé. Lauréates de la première promotion en 2020, le dispositif nous a permis de nous structurer et envisager la suite avec plus de clarté. Pendant un an, nous avons porté Frugali à bout de bras, moi en salariat à temps plein, Anaïs bénévole à mi-temps. Aujourd’hui Anais m’a rejoint à temps plein.
Qu’est-ce que Frugali ?
Les missions de Frugali sont multiples : nous proposons, d’une part, notre offre de formations aux organisations sur la Transition Ecologique et Alimentaire tout en les accompagnant vers une transformation de l’existant. Nous construisons des programmes de formations afin d’introduire des concepts et modes d’innovation frugaux au sein des entreprises. Ces formations ont pour objectif de développer les compétences professionnelles et ainsi faire le lien avec des pratiques responsables au sens culturel, écologique et social. Nous accompagnons les entreprises dans leur structuration interne ainsi qu’au diagnostic de leur activité.
Nous intervenons pour le moment auprès de collectivités et nous déployons actuellement des offres avec les mutuelles mais également de grands groupes engagés sur les questions de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et de transition. Nous sommes déjà référencés sur des plateformes de formations, ce qui nous permet d’être sollicitées par des organisations en France Métropolitaine.
Comment en êtes-vous arrivée à imaginer cette nouvelle activité professionnelle ?
La création de Frugali est un mélange entre coup de chance et opportunités. A l’époque, Kèpos avait réalisé un sondage sur les activités manquantes du Grand Nancy. Ayant déjà le projet en tête, j’ai pu à plusieurs reprises en discuter avec Emmanuel Paul, fondateur de Kèpos, pour réaliser un diagnostic de territoire. Ce dernier révélait le manque d’un acteur qualifié en matière d’alimentation durable et porteur d’une offre de formation sur le bassin nancéen. Nous avons, par conséquent, profité de cette opportunité pour déposer un dossier de candidature à La Serre à Projets.
En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?
Comme je l’évoquais un peu plus haut, le projet Frugali comporte différentes strates :
Une première qui représente le noyau dur de notre activité : un travail de lobbying auprès des organisations privées, publiques et associatives sur la modification de leurs pratiques.La deuxième réside dans le changement du fonctionnement et pratiques professionnelles via un travail de sensibilisation et formation.
Nous avons à cœur de ne jamais juger les structures que nous accompagnons et travaillons avec bienveillance pour comprendre les besoins de nos clients. Plus le dialogue sera fluide, plus les organisations seront disposées à mettre en place les nouvelles pratiques responsables que nous leur conseillerons.
Comment envisagez-vous la suite de l’aventure ?
Nous travaillons, en 2022, à rechercher l’équilibre économique, tout en pensant à l’intégration en salariat d’Anaïs.
A moyen et long terme, nous aimerions élargir nos partenariats et pouvoir créer des permanences juridiques dédiées aux salariés sur la transition alimentaire au sein des entreprises.
En ce qui concerne nos engagements chez Kèpos, nous participons à la construction d’un PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique) sur le territoire du Grand Nancy. Parmi les différents groupes de travail, nous avons fait le choix de rejoindre celui dédié à la RSE.
Merci ! [...]
6 avril 2022Interviews Radio / ProjetsL’émission “Bio diversité“, animée par Chloé Baduel sur Radio Caraib Nancy, accueille Fabien Potiez, coordinateur de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Fibricoop. L’occasion de revenir sur le changement de statut de l’association, qui œuvre à la récupération de déchets textiles industriels pour leur offrir une seconde vie.
Si vous êtes à la recherche de sacs résistants issus de l’économie circulaire, n’hésitez pas à contacter Fibricoop via son site internet ! [...]
30 mars 2022RéflexionsLa guerre en Ukraine a déjà pour effet de faire grimper substantiellement les prix de l’énergie et des matières premières, notamment agricoles. C’est ainsi que le pétrole, le gaz, le nickel, le blé ou encore l’huile de tournesol voient leur prix s’envoler de manière exponentielle. L’inflation est au plus haut depuis de très nombreuses années en Europe, et notamment en France. Mais il est important de noter que ce mouvement haussier était déjà en cours avant l’agression de l’Ukraine par la Russie. Il concernait alors en particulier le gaz et le pétrole, mais aussi les coûts de logistique ou les semi-conducteurs. Il était alors majoritairement attribué à la reprise post-covid et à la désorganisation des chaînes logistiques internationales. Mais personne ne prenait en compte qu’il n’était pas impossible que la capacité à fournir des écosystèmes dont nous dépendons soit elle-même limitée, et d’une certaine manière, déjà « au taquet » !
La Guerre en Ukraine est un accélérateur et un amplificateur de ces tendances, dans plusieurs domaines :
Les occidentaux cherchent à réduire leur dépendance au gaz et au pétrole russes, ce qui accroît la pression haussière sur les prix via une demande plus forte auprès des autres producteurs.Les engrais et autres produits de synthèse pour l’agriculture sont très dépendants du pétrole, et massivement produits en Russie et Ukraine. Cela implique directement une augmentation des coûts de production des agriculteurs.La Russie et l’Ukraine sont de très importants exportateurs de matières premières agricoles (céréales, oléagineux, etc.). Leur capacité à fournir va être très fortement impactée par la guerre : incapacité des paysans ukrainiens à pratiquer leur activité (manque de carburant, indisponibilité des agriculteurs car partis au combat ou ayant dû fuir, etc.), impossibilité d’exporter les marchandises depuis les ports de la Mer Noire, difficulté à payer les opérateurs russes du fait des sanctions financières touchant le pays, etc.Augmentation du coût des matières premières métalliques, comme par exemple le nickel, du fait d’une forte concentration de la production en Russie. On constate également par exemple en ce moment de très fortes pénuries d’acier, l’Ukraine étant un pays avec une puissante industrie lourde.
écologiques se renforcent pour aboutir à un même résultat : notre mode de vie va devenir littéralement hors de prix. Quelque part, nous avons vécu depuis des décennies à crédit, en pillant les écosystèmes, en prenant dans leur stock de capital plutôt que dans les intérêts qu’ils étaient capables de nous fournir, les fameuses ressources renouvelables. Pour des acteurs comme Kèpos, il était clair que l’on ne pouvait toujours sortir plus de produits d’écosystèmes dont la capacité à fournir était par définition limitée, et qu’un hiatus allait apparaître.
En conséquence, la sécurité alimentaire d’une grande partie du monde n’est plus assurée, les causes géopolitiques se mêlant aux difficultés économiques et aux effets du changement climatique (sécheresse historique au Maroc ou en Amérique latine par exemple). Mais le pire est bien sûr que ce sont les populations les plus déshéritées qui vont le plus souffrir, et notamment dans les pays dont l’autosuffisance alimentaire est la plus faible (Moyen-Orient, Maghreb, Afrique subsaharienne, etc.). On s’attend à des famines et des troubles politiques et géopolitiques terribles.
En France, la situation se traduit par la montée en puissance de la thématique du « pouvoir d’achat », qui devient incontournable dans le débat présidentiel. Mais malgré la démagogie de nos candidats et dirigeants, il est très clair que l’on ne s’en sortira pas à coup de ristournes sur le prix de l’essence ou de primes inflation. Et que ce soit l’État ou les consommateurs qui sortent l’argent, il faudra toujours payer ! Il importe donc que tout un chacun comprenne que la donne vient de radicalement changer, et que ce qui n’était jusqu’à présent que latent devient terriblement réel : il va nous falloir payer le vrai prix des choses. L’abondance dans laquelle nous avons vécu depuis un siècle était d’une certaine manière irréelle. Plus que jamais, le seul scénario soutenable est celui de la sobriété. Et nous avons tous intérêt à la choisir plutôt qu’à la subir.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
28 mars 2022ActualitésLa Serre à Projets accompagne depuis 2019 des porteurs de projets engagés dans la Transition Écologique et Solidaire sur le Grand Nancy. Le dispositif repère en amont des besoins non-satisfaits sur le territoire, imagine des solutions pour y répondre, étudie leur opportunité, puis les transmets à des porteurs de projets issus de l’Économie Sociale Solidaire. Retrouvez plus d’informations sur le fonctionnement de La Serre à Projets en vous rendant sur son site internet ou sur cet article.
Ce jeudi 17 mars 2022, Kèpos et France Active Lorraine, qui portent tout deux la Serre à projets, accueillaient les lauréats de la nouvelle promotion pour une journée d’intégration en présentiel. Une première pour le dispositif qui, depuis près deux ans, organisait ses rencontres en visioconférence.
Au programme de cette journée : atelier brise-glace durant lequel les lauréats ont appris à se connaître, présentation des projets et de l’accompagnement proposé par Kèpos et France Active Lorraine, suivie par une formation sur les six étapes de la création (l’idée, l’étude de marché, l’étude financière, l’étude juridique, la recherche de fonds, et enfin l’installation). D’autres formations auront lieu dans les prochaines semaines pour accompagner au mieux chaque activité, et faire monter en compétences les porteurs de projet.
Parmi les lauréats sélectionnés cette année, nous retrouvons une grande variété de projets :
Une recyclerie de matériels numériques portée par l’association ULIS et la société SOS Futur.Une solution d’auto-hébergement informatique libre et écologique par Codatte, jeune entreprise fondée en 2020.Une offre de vélo-taxi et vélo-bus pour une mobilité douce permettant de réduire la pollution liée au trafic automobile en ville.Un centre de médiation équine au service du bien-être des humains et des animaux.Un projet de “Café des enfants”, lieu de vie et de rencontres pour petits et grands.Une Cantine Solidaire avec l’association Le Vert T’y Go, réunissant publics isolés et producteurs locaux.Une recyclerie créative de textile.Une productrice de fleurs locales avec la Ferme Florale du Sânon La collecte et traitement efficaces des biodéchets par l’association AEIM ADAPEI 54
Le dispositif s’étend également depuis cette année sur les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) : “Les Provinces” à Laxou et “Les Nations” à Vandœuvre-lès-Nancy. Sur ces deux secteurs, la Serre va accompagner les projets suivants :
Un projet de Cantine Solidaire porté par l’association KHAMSAUn tiers-lieu dédié à la transition écologique et solidaire par l’association “Si l’on se parlait“
Les lauréats sautent désormais dans le grand bain de l’entrepreneuriat ! Suivez leurs évolutions sur le site internet de La Serre ou depuis sa page Facebook.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
22 mars 2022Projets / Revues de ProjetsA l’occasion du changement d’échelle de plusieurs membres du Jardin d’Entreprises, au capital desquels la CIGALES Mirabelle a pris des parts, Samuel Colin, qui est également salarié de Kèpos, nous explique le fonctionnement de ces clubs d’investisseurs engagés dans la transition écologique. A noter qu’il est d’ailleurs partie prenante dans l’association régionale des CIGALES du Grand Est.
Faisons connaissance : qui êtes-vous ? Comment en êtes-vous venu à participer à une CIGALES ?
Je suis impliqué de longue date dans différents projets en lien avec la transition écologique (création d’une AMAP, mouvements associatifs de protection de l’environnement). Par ailleurs, mes études en école de commerce m’ont permis de me former à la gestion financière. Au delà de la vision promue par ces écoles, j’ai peu à peu découvert les impacts négatifs majeurs de la finance sur l’environnement. En d’autres termes, mon épargne placée dans une banque “traditionnelle” pouvait servir, à mon insu, à financer des projets particulièrement polluants, tels que l’extraction d’énergies fossiles, la fabrication d’armes, etc. Peu de temps après cette prise de conscience, j’entends parler du mouvement des CIGALES dans un article de l’Est Républicain. J’assiste à une réunion d’information organisée à la MJC Bazin de Nancy et j’y rencontre les futures personnes avec qui la CIGALES Mirabelle sera créée !
Pouvez-vous nous présenter l’association des CIGALES du Grand Est ?
Par définition, une CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) est un regroupement de particuliers mettant en commun une partie de leur épargne pour financer des entreprises qui se lancent ou se développent. Chaque CIGALES est composée de 5 à 20 personnes. Ces dernières interviennent, la plupart du temps, en prenant des parts dans les entreprises ou en réalisant des prêts quand la prise de parts n’est pas possible. On compte aujourd’hui 13 CIGALES actives en Grand Est.
Notre association régionale les fédère et a pour principales missions :
D’accompagner les CIGALES locales.De faire vivre le mouvement en interne.D’élargir le mouvement en favorisant la création de nouvelles CIGALES et en recrutant de nouvelles personnes.
En ce qui concerne le département de Meurthe-et-Moselle, nous comptons actuellement 5 CIGALES en activité.
Comment rejoindre une CIGALES ?
Sur ce point, chaque CIGALES est autonome et fixe ses règles. La meilleure façon de se lancer est de créer sa propre CIGALES. Prenons l’exemple de la CIGALES « Coup de pousse », initiée par Laure Hammerer, également salariée chez Kèpos, et Franck Magot, qui avait lui même été financé par deux CIGALES au lancement du projet “Les Fermiers d’Ici“. Voici ce que dit Franck :
“A la création de l’entreprise, j’ai ouvert le capital à deux clubs d’investisseurs (des CIGALES) et une personne physique. C’est sûrement le choix dont je suis le plus satisfait. Cela me permet d’échanger avec eux, de prendre du recul et de progresser. Sans ce partage, l’entreprise n’en serait pas là où elle en est en ce moment.“
Si cette idée vous tente, le premier pas à réaliser est de contacter l’association régionale pour qu’elle vous donne toutes les clés et vous accompagne à la création d’une CIGALES. Les étapes sont globalement simple, et en un rien de temps le projet sera lancé !
Quels sont ses champs d’action et en quoi le projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ? A quels types de projets a déjà participé la CIGALES Mirabelle ?
L’objectif d’une CIGALES est d’aider à faire naître sur un territoire des projets qui auraient plus de mal à émerger sinon. Les CIGALES favorisent et interviennent dans le champ plus général de l’Economie Sociale et Solidaire en apportant de l’argent « frais » au capital des structures. Les CIGALES défendent dans leurs investissement les valeurs de la Charte des CIGALES. Chaque club choisi, de façon indépendante, ses valeurs principales, qu’elles soient écologiques, sociales ou culturelles. Dans la CIGALES Mirabelle, nous sommes très attachés aux questions écologiques. Nous accompagnons actuellement pas moins de 13 projets différents, dont plusieurs font partie du Jardin d’Entreprises de Kèpos : Les Fermiers d’Ici, Mollis, Energéthic, le restaurant-coopératif Arlevie, la brasserie de bières biologiques et artisanales La Grenaille, l’épicerie Court-Circuit, Fibricoop, Vêt Ethic, la Grande Epicerie Générale (GEG) ou encore l’épicerie animée PAMBio à Pont-à-Mousson…
Au delà de l’apport financier, les cigaliers peuvent participer, si la structure le souhaite, aux réunions stratégiques et grandes réflexions sur l’avenir de l’entreprise. La CIGALES sert également de relais de communication, favorise la mise en réseau et soutient le porteur de projet lorsqu’il en a besoin.
Quelles sont les limites de ce type d’initiative ?
Le mouvement des CIGALES est nécessaire mais ne sera jamais suffisant pour financer la transition écologique. Il doit s’accompagner d’établissements financiers éthiques tels que la Nef et du changement de pratiques des banques conventionnelles. Toutefois, les CIGALES représentent un outil intéressant pour la finance au service d’une économie concrète, de proximité, réellement écologique et solidaire.
Comment envisagez-vous la suite de l’aventure CIGALES ?
La durée de vie légale d’une CIGALES est de 5 ans. Au bout de ces 5 ans, les CIGALES doivent décider si elles souhaitent se renouveler ou non. De notre côté, la dynamique est bonne chez Mirabelle et nous aimerions que le projet continue encore sur de nombreuses années. En ce qui concerne l’échelle régionale, j’aimerais que la dynamique de nouvelles créations de CIGALES accélère et qu’à terme les CIGALES se réunissent pour financer des projets à plus grande échelle !
Merci !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
23 février 2022Actualités / Interviews Radio / ProjetsEn compagnie de Chloé Baduel, animatrice de l’émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy, Chloé Lelarge, fondatrice du cabinet de conseil et de formation Frugali, est revenue sur les origines du projet, son champ d’actions mais également les perspectives qui se profilent pour l’année 2022.
Retrouvez son intervention ci-dessous :
Si la transition de votre entreprise vers des pratiques plus responsables vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Frugali via son site internet.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
23 février 2022ActualitésCe lundi 21 février, nous nous rendions dans les locaux de la recyclerie La Benne Idée, situés au 16 rue de la Malgrange à Jarville, en compagnie de plusieurs membres du Jardin d’Entreprises de Kèpos. Un moment convivial hors-les-murs pour faire découvrir les activités de chacun et, par la même occasion, créer du lien. A l’honneur ce mois-ci : l’association de réemploi de mobilier qui a pris le temps de nous expliquer la genèse ainsi que l’avenir du projet.
Lauréate de la Serre à Projets en 2020, l’association collecte des objets destinés à être jetés pour ensuite les vendre à prix solidaire en intégrant de la rénovation et de la création pour valoriser au maximum le mobilier récupéré. A termes, l’équipe espère réemployer 280 tonnes de déchets mobiliers par an grâce à l’accès aux déchetteries du Grand Nancy ainsi que les différents dons de particuliers et professionnels.
A l’initiative de ce projet nous retrouvons trois entrepreneurs engagés : Antoine Plantier, ingénieur géologue, Chloé Geiss, ingénieur agronome et Thomas Henry, anciennement menuisier ébéniste. Tous ont à cœur de mêler utilité sociale, sensibilisation et éco-responsabilité.
Ce projet pour objectif de créer 35 emplois dont une vingtaine en chantier d’insertion. Pour cela, la recyclerie a obtenu, il y a peu, l’agrément d’Atelier et Chantier d’Insertion. Une nouvelle étape pour cette association solidaire qui permettra d’accompagner des personnes dans leur démarche de retour à l’emploi.
Au sein de 5 000m² d’espaces disponibles destinés à devenir une “Cité du Faire”, la recyclerie en occupe actuellement 1 000m². De nouveaux ateliers d’artisans d’art devraient voir le jour dans quelques mois sur l’espace restant.
A terme pourront être menées des actions de sensibilisation à la transition écologique mais également des activités de création de mobilier design.
Découvrez la boutique en ligne
Suivez de près les actualités de l’association en cliquant ici.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
14 février 2022Actualités / Projets / Revues de ProjetsL’agence de communication responsable Comm’ un avenir soufflait sa première bougie le 4 janvier dernier, à cette occasion, nous avons posé quelques questions à sa fondatrice, Anne-Sophie Gall, sur son parcours et les perspectives du projet.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Anne-Sophie Gall et j’ai débuté mon parcours en communication par un DUT Communication des Organisations à l’IUT Charlemagne à Nancy. J’ai ensuite poursuivi en Master Stratégie et Conseil en Communication à la Faculté de Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Lorraine. Ma passion pour le chant et le secteur musical me destinait plutôt à travailler dans cette voie, mais ma progressive prise de conscience des enjeux environnementaux m’a amenée à repenser mes projets professionnels. C’est en 2018 que je commence à m’engager dans diverses associations écologiques, en particulier Greenpeace et La Cantoche. Le besoin de retrouver du sens dans ma vie professionnelle me pousse à quitter mon poste de Chargée de communication à la Ville de Ludres. L’idée de créer un projet en lien avec la transition écologique m’apparaît désormais comme une évidence. Après quelques mois de réflexion, je décide de me lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat en proposant mes compétences en communication aux structures engagées située dans la Métropole du Grand Nancy.
Qu’est-ce que Comm’ un avenir ?
L’objectif premier de ce projet réside dans le soutien que j’apporte aux initiatives vertueuses de mon territoire. Les associations et petites structures souffrent souvent d’un manque de visibilité et de ressources humaines ou matérielles en terme de communication. En les aidant dans leur communication, les structures auront la possibilité de toucher un plus large public et de démocratiser les problématiques d’enjeux climatiques et sociétaux.
En ce qui concerne, le terme « Agence », je suis consciente que ce dernier est connoté. Cependant, Comm’ un Avenir relève d’une réelle alternative aux agences de communication classiques. Ce terme permet de rassembler, en un seul mot, les différents champs d’action sur lesquels je peux intervenir : gestion des réseaux sociaux, communication print, identité visuelle, éco-conception, relations presse mais également la réalisation de plans de communication.
Je travaille pour le moment seule pour différentes structures, telles que day by day, Décor’Jardin, les Fermiers d’ici ou la coopérative anti-gaspi Arlevie. Grâce à la mise en réseau de Kèpos, j’ai également pu œuvrer à la communication de Fibricoop, coopérative de réemploi de textiles usagés issus de blanchisseries industrielles.
Comment en êtes-vous arrivée à imaginer cette nouvelle activité professionnelle ?
Cette idée d’agence responsable vient de mes engagements associatifs. Le manque de moyens en interne, qu’ils soient d’ordre humain, communicationnel ou financier, m’a poussé à créer ma propre entreprise au service de l’intérêt général. Bien qu’il existe une dissonance entre la communication et la transition écologique : l’un agit plutôt dans une vision court-termiste, tandis que le second s’inscrit dans le long terme, j’ai décidé de m’intéresser aux alternatives de la communication responsable. Cette dernière se démarque des messages poussant à la surconsommation ou la production de supports très énergivores. Chacune de mes missions est donc pensée de manière à limiter ses impacts : utilisation de logiciels open source, choix de supports écolabellisés et prestataires engagés, diffusion de messages clairs et transparents en accord avec les objectifs de développement durable, etc.
En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?
Le projet Comm’ un avenir contribue à la transition du territoire nancéien en soutenant des initiatives écologiques et sociales en faveur d’une meilleure intégration du territoire dans les enjeux de demain. Véhiculer des messages de sobriété me tient particulièrement à cœur, la transmission de connaissances est un levier indispensable à la sensibilisation à l’écologie des générations actuelles et futures. C’est pourquoi j’interviens également dans le cadre de la Licence Information et Communication de la Faculté de Lettres de Nancy, afin de partager mes expériences et montrer qu’une synergie entre écologie et communication est possible.
Consciente du manque en interne des associations, je propose un tarif solidaire et engagé de -20 % sur l’ensemble des services proposés. Bien qu’au départ Comm’ un avenir se destinait à la communication des associations, celle-ci s’oriente aujourd’hui vers tout type d’acteur de l’ESS portant des valeurs fortes et se donnant les moyens de les appliquer.
Comment envisagez-vous la suite de l’aventure ?
J’envisage la suite de l’agence à plusieurs. En effet, les propositions de contrats et la charge de travail s’accumulant, il devient de plus en plus difficile de travailler seule. Les demandes se multipliant, le projet tend également à élargir sa zone d’activité à la région Grand Est. J’aimerais, d’autre part, aller plus loin dans la réflexion et la réalisation des supports de communication responsable en creusant tous les aspects de l’éco-responsabilité et renforçant mes liens avec les structures engagées du territoire.
Merci !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
9 février 2022ActualitésCo-porté par Kèpos, France Active Lorraine et Simplon Grand Est, le Crea-Lab vise à accompagner de jeunes entreprises engagées de moins de 3 ans sur le bassin lunévillois.
L’accompagnement de la première promotion a débuté en octobre 2021 en regroupant divers secteurs d’activités : lutte contre le gaspillage alimentaire, restauration biologique et itinérante, dépollution des sols, création d’une librairie éco-responsable ou encore le développement d’un garage solidaire. Autant de projets qui participe à l’économie locale et dynamise son territoire !
Pour cette deuxième saison, le Crea-Lab lance son appel à candidatures pour recruter sur l’ensemble du bassin de vie lunévillois des entrepreneurs prêts à démarrer un programme de 6 mois visant à accélérer leur développement et conforter leur engagements écologiques, numériques et sociétaux .
Vous bénéficierez :
D’un accompagnement personnalisé
D’un diagnostic 360° de la performance de votre entreprise
D’un programme d’ateliers de formation ciblés
Si le projet vous intéresse, rejoignez nous lors d’une réunion d’information en ligne gratuite le jeudi 24 février de 9h30 à 10h30 !
Je m'inscris
N’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse suivante isabelle@kepos.fr ou par téléphone 06 61 48 81 92 si vous avez des questions !Vous avez jusqu’au 25 mars 2022 pour déposer votre candidature en remplissant le formulaire ci-dessous :
Je dépose ma candidature
Alexandra Casas de Kèpos [...]
1 février 2022Interviews Radio / ProjetsChloé Baduel, animatrice de l’émission « Bio diversité » sur Radio Caraib Nancy, fait intervenir chaque mois des membres du Jardin d’entreprises de Kèpos et des Lauréats de la Serre à Projets.
Retrouvez aujourd’hui le restaurant-associatif La Cantoche en compagnie d’Arnaud Maujean, membre du Conseil d’Administration et Isabelle Dollander coordinatrice salariée de l’association. Son objectif : lutter contre le réchauffement climatique en sensibilisant à une alimentation saine et durable !
Retrouvez leur intervention ci-dessous :
Alexandra Casas de Kèpos [...]
24 janvier 2022ActualitésNotre chef de projet, Ian Mc Laughlin, répondait aux questions de Chloé Baduel dans son émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy le 20 janvier dernier, concernant l’appel à candidatures 2022 de La Serre à projets
Retrouvez son interview pour en apprendre plus sur ce dispositif et les thématiques retenues pour cette troisième année :
Alexandra Casas de Kèpos [...]
21 janvier 2022Réflexions« Si vis pacem, para bellum » : si tu veux la paix, prépare la guerre ! Face à l’accroissement des périls à l’Est de l’Europe, cet adage latin devrait présider à notre action. Rappelons les faits : la Russie, qui a déjà annexé le Crimée et déstabilisé le Donbass, masse des troupes (plus de 110000 hommes) et du matériel lourd à la frontière ukrainienne. Dans le même temps, elle annonce déployer son armée pour des exercices en Biélorussie, et organise des manœuvres navales d’ampleur mondiale. Face à cela, l’Ukraine appelle à l’aide les occidentaux. Mais la menace ne se limite pas à l’Ukraine : pays baltes, scandinaves et d’Europe centrale s’inquiètent. C’est ainsi que la Suède commence à déployer des troupes sur certaines de ses îles jouxtant la Russie. La question se pose : qu’est-ce qui intéresse vraiment la Russie ? Seulement l’Ukraine ? Ou tout le périmètre de l’ancienne sphère d’influence soviétique ?
Dans le même temps, la Russie fait monter la pression en exigeant des États-Unis et de l’OTAN des concessions exorbitantes : impossibilité de plus étendre le périmètre de l’OTAN, retrait des troupes de l’OTAN d’Europe centrale et orientale, etc. De plus, la Russie entend négocier directement avec les Etats-Unis, en n’incluant pas les Européens, pourtant les premiers concernés. Ces demandes ressemblent plutôt à des ultimatums, et ne sont pas de réelles négociations. Au même moment, l’opinion publique russe est abreuvée d’un discours présentant l’OTAN comme assiégeant la Russie, alors qu’elle n’a en réalité qu’une fonction défensive.
Face à cela, il apparaît de plus en plus clair que les occidentaux ne sont pas prêts à mourir pour l’Ukraine. Mais le seront-ils pour défendre des membres de l’Union Européenne et de l’OTAN ? Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse d’une agression par la Russie de l’Ukraine, les occidentaux menacent le Russie de sanctions économiques et politiques d’ampleur systémique, qui couperaient les vivres aux Russes. Mais ce qui pourrait se profiler derrière tout cela, ce pourrait être une déstabilisation plus vaste de toutes les démocraties de l’Est et du Nord de l’Europe.
Face à cette situation, on ne peut qu’être abasourdi par l’esprit munichois qui prévaut dans un pays comme la France. La France ne croit pas réellement à une agression de l’Ukraine par les Russes, et avance qu’un dialogue exigeant est possible. Les experts éclairés ne croient plus à la possibilité de ce dialogue, qui est, au mieux, un vœux pieux, au pire, une compromission. Si l’on tenait vraiment à la démocratie et à la liberté, l’heure devrait être au réarmement, militaire, politique, économique et surtout moral.
Or, que voit-on ? Toute une partie de la classe politique a basculé dans une attitude de fascination ou d’ambiguïté vis à vis de Poutine : Mélenchon, Zemmour, le Pen, et même une partie de la droite républicaine. L’itinéraire de François Fillon est à cet égard symptomatique, qui prend des responsabilités aux conseils d’administration de plusieurs grandes entreprises russes. Dans la sphère médiatique, on frise l’inconscience : tout le monde est incrédule face au péril, et on préfère consacrer son attention à la réouverture des discothèques et autres sujets du même genre. Sans parler des citoyens, qui ont déjà en grande partie abdiqué leur liberté, c’est à dire leur capacité à influer, par la participation à la délibération démocratique, sur la volonté générale et le destin collectif.
Munichois un jour, Munichois toujours : telle pourrait être notre devise. Nous semblons croire que la rationalité l’emportera. C’est méconnaître les passions humaines à l’œuvre dans l’histoire, faite de démesure et d’inconséquence. Or, ce que l’on voit, c’est un dirigeant russe animé de l’esprit de revanche. Dans ce contexte, et alors qu’une guerre chaude de dimension potentiellement systémique pourrait être déclenchée, il ne faudrait pas que nos renoncements et notre manque de courage nous précipitent dans l’abîme. Après notre pusillanimité face au changement climatique, nous adoptons la même attitude face au risque géopolitique.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
18 janvier 2022Interviews Radio / ProjetsDans le cadre de notre partenariat avec Radio Caraib Nancy, Chloé, l’animatrice de l’émission « Bio diversité », intervient sur des sujets liés à la transition écologique.
C’est au tour, cette fois-ci, de Day by Day : première épicerie 100% vrac gérée par Cécilia Gana au Faubourg des trois Maisons, à Nancy. Son mot d’ordre : moins d’emballage, moins de gaspillage et plus d’économies !
Retrouvez ci-dessous l’interview de Cécilia :
Alexandra Casas de Kèpos [...]
11 janvier 2022ActualitésNous confions aujourd’hui la plume à Damien Peltier, chef de projet de notre tiers-lieu sur le quartier Biancamaria !
Je souhaiterais vous parler des jardins partagés ou collectifs, et pour tout dire, tout particulièrement de celui créé de toutes pièces en partant simplement d’une idée : remettre en valeur une friche urbaine, couplée à l’envie de retrouver un lien avec la terre et le vivant.
Mais avant cela, une petite rétrospective s’impose…
Depuis le moyen-âge, nos villes occidentales sont pensées et conçues sur un modèle d’arrachement à la nature. Plus sûres et plus « civilisées » que jamais, nos cités actuelles nous apportent un confort indéniable : de l’eau potable au robinet, une commode proximité avec toutes sortes de vendeurs de biens et de denrées, la sécurité grâce à la protection apportée par nos portes blindées et nos brigades de police, la facilité d’accès à la culture, aux divertissements et aux soins … Un véritable paradis !
Pourtant, à la fin du XIXe siècle, l’urbanisation effrénée, engendrée par la « révolution industrielle », a reposé la question du rôle et de la place attribués au végétal dans l’espace urbain. C’est en 1919 qu’est apparue la notion « d’espaces libres à préserver », en 1961 que le terme « espace vert » a été introduit pour la première fois dans les textes réglementaires, et aux alentours des années 1980 que le concept de « trame verte et bleue » a été pensé. Enfin, dans les années 1990, les premiers jardins collectifs ont commencé à voir le jour en France. Bref, bien du chemin a été parcouru depuis l’ère industrielle, de l’urbanisme de la fonctionnalité d’hier à l’urbanisme écologique que nous connaissons aujourd’hui.
Mais alors, pourquoi, me direz-vous ? Pourquoi défaire le béton et les paysages stériles si rassurants et aisément praticables que nous avons mis tant de temps et d’énergie à fabriquer ? Pourquoi changer le visage de nos chères villes, devenues plus hautes, plus vastes et plus peuplées que jamais ?
En résumé, pourquoi réintroduire des espaces verts ?
La réponse à ces questions semble peut-être plus évidente avec cette reformulation : combien d’entre nous ont souffert de l’absence d’espace de « nature » en ces temps d’épidémie ?
Mais tout d’abord, peut-être convient-il de se demander : qu’est-ce que la nature ?
Si on en croit le Petit Robert, la nature c’est « tout ce qui existe dans l’univers hors de l’être humain et de son action ».
Cela voudrait dire que, quoique nous fassions, la ville et tous les espaces qui la composent ne peuvent être des espaces de « nature » puisque façonnés par l’homme.
Pire encore, cette définition amène à penser que l’homme lui-même ne fait pas partie de la nature.
Mais alors, sommes-nous destinés à vivre dans un univers parallèle fait de béton et de métal ? Nous sommes-nous tant éloignés de notre nature profonde et de la biosphère au point de nous en émanciper de la sorte ?
Force est de constater que non, si l’on en croit les très nombreuses études listant les bienfaits directs et indirects que ces petits coins de verdures nous apportent : diminution de la pollution de l’air et sonore, réduction du stress, santé préservée grâce à l’activité physique, impacts des vagues de chaleur et des inondations atténués, création de lien social… pour ne citer que ceux-là !
Nous aurions donc, bien malgré nous, besoin de cette nature que nous avons reléguée au rang de simple fournisseur de matière première, sale et insécure.
Pourtant, et ce n’est plus une surprise pour personne, la biosphère va exceptionnellement mal !
Depuis l’ère industrielle, l’activité humaine a provoqué à une vitesse record des changements qui ne se mesuraient jusqu’alors que sur des temps géologiques. De façon générale, nous nous rapprochons toujours plus des limites planétaires à ne pas dépasser si nous voulons éviter les dysfonctionnements globaux des écosystèmes… et il ne semble pas y avoir de changement dans cette tendance là non plus.
Ce qui signifierait que nous accordons moins de valeur à la nature qu’à notre propre bien être, alors qu’ils semblent si étroitement liés…
Mais alors, y aurait-il un souci dans la valeur que l’on donne à la nature ?
Puisque nos modes de vie et notre culture nous incitent à toujours faire un ratio coût/bénéfice pour juger de la juste valeur des choses, l’économiste écologue Robert Constanza a pris la peine de mesurer en 2016 le prix des services rendus par la biosphère : cela représenterait quelques 33 000 milliards de dollars par an…et rien de cela ne pollue ni ne génère de déchets qui ne soient pas valorisés par ailleurs…et tenez-vous bien, tout cela nous est offert ! Cadeau, c’est gratuit !
Oui, vous avez bien lu ! Plus d’un tiers du PIB mondial en services rendus gratuitement, voilà une approche pertinente pour déclencher les décisions de nos dirigeants !
Mais cette valeur a-t-elle véritablement un sens ? Est-ce que tout a un prix utilitaire ? N’avez-vous pas, comme moi, certaines choses dans votre vie qui ont une valeur qui ne puisse être mise en équation ? Votre famille, vos amis, votre santé peut être…
Revenons à notre jardin…
C’est en 2020 que la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Kèpos, la coopérative pour laquelle je travaille, est entrée en contact avec la ville de Vandœuvre-lès-Nancy. La commune avait un terrain, Kèpos les savoir-faire, et nous avions tous cette envie commune de faire évoluer les choses vers plus de bien-être, plus de liens, plus de « vert ».
J’ai failli oublier ! Kèpos est un ensemble d’entreprises et d’associations qui œuvrent à la transition écologique du territoire, et mon job à moi, c’est de coordonner les actions des différents membres de la coopérative. Ils sont aujourd’hui 24 et travaillent sur des sujets comme l’écoconstruction, la transition alimentaire, l’agroécologie, les énergies renouvelables, la science, la mobilité douce, le réemploi, le mieux-vivre et bien d’autres domaines encore… Bref, toutes sortes de compétences spécialisées qui, mises bout à bout, dessinent une forme de circuit logique, holistique et cohérent, où chacun est en mesure d’apporter à l’autre, tout comme dans un écosystème !
Le cahier des charges paraissait simple : créer un jardin partagé pour les habitants du quartier Biancamaria, tout en respectant les codes d’urbanisme et de façon à ce que cela soit bénéfique pour l’environnement. Il fallait donc trouver ce point d’intersection entre les envies et les besoins de chacun, les contraintes physiques et environnementales, les visions des uns et des autres…simple disais-je ?
Nous nous sommes donc concertés, avons réfléchi, nous sommes interrogés, avons réunionné, compilé, reconcerté… chacun a apporté sa pierre à l’édifice : la ville, les membres de la coopérative, les habitants du quartier, moi, l’aménageur, la Métropole… et après une « trouzaine » de réunions, de plans et de plannings en tous genre, nous avions enfin le feu vert pour investir ce terrain de jeu en août 2021.
Et quel terrain de jeu !! Avec Caroline (« Caroline Antoine ») et Aurélie (« Aurélie Marzoc »), qui ont pris en charge la concertation et la conception paysagère, nous partions d’une feuille vierge pour dessiner un lieu écologique, un lieu qui serait la vitrine des savoir-faire de la coopérative, un lieu créateur de lien, un lieu pour nous et pour les autres. Tout ou presque était possible, il suffisait de l’imaginer !
Notre envie principale était de remettre de la vie dans cette friche et de mettre de la vie dans le quartier. Nous n’étions pas seuls à le vouloir ; un groupe de résidents du quartier s’est mobilisé et nous a suivi, aidé, conseillé, appuyé.
On pouvait les compter sur les doigts d’une main au départ : Corinne, Gauthier, Yves et Max (le sympathique pince-sans-rire), de bonnes volontés à qui il convient de rendre hommage.
Créer un jardin prend du temps si on veut le faire dans le respect de l’environnement, et puisque travailler sur « sol vivant » n’est pas possible à coup de granules magiques, il fallait bien préparer ce terrain au sol si pauvre que même de simples patates n’auraient probablement rien donné. Nous avions besoin de bras, de beaucoup de bras.
Dès le départ, nous avons choisi de coconstruire ce lieu. L’évidence était donc d’offrir, aux habitants qui le voulaient, des formations en agroécologie en échange de leurs temps et de leurs efforts, lors de la création des zones de culture et du verger partagé. Du temps contre du savoir, des efforts contre des fruits et légumes.
Le premier atelier a eu lieu en août 2021, le 28 au matin, c’était un samedi.
Ils étaient six habitants en plus d’Enzo et Théo, les deux membres de la coopérative spécialistes des jardins permacoles (« Des Racines et Des Liens »). Malgré mon envie, je n’ai pu m’y rendre ce jour-là, car j’avais contracté ce satané virus qui fait frémir les Etats et met à mal les systèmes de santé depuis deux ans maintenant.
Ce que j’aurais aimé être là ! Des mois de travail pour finalement manquer le jour du lancement, les premières délimitations qui dessinaient enfin l’esquisse de quelque chose de concret ! J’aurais l’occasion de me rattraper…
Six en août, disais-je, puis douze à l’atelier de septembre, respectivement dix-sept et dix-huit, sans compter les oiseaux de passage, lors des ateliers d’octobre, et ça n’a pas désempli depuis. Des nouveaux venus à chaque rencontre, des curieux de passage, des enfants qui sèment et jouent dans les bottes de foin qui nous servent à couvrir les sols, pauses café-croissant, thé-gâteaux maison en fonction de ce que chacun apporte. Tantôt on bêche, tantôt on pioche, plante, pellette, discute, rigole, on échange une recette de cuisine, on raconte une blague, bref on fait connaissance…
Alors c’est ça un jardin partagé ? Un endroit où on noue des liens, où on joue et apprend, où on transpire et cultive plus qu’une simple terre. Un endroit où on donne une autre valeur au temps. Le temps de bien faire, le temps de faire une pause pour raconter sa vie à son voisin, pour écouter la sienne, le temps de laisser faire, le temps d’être ensemble, le temps de prendre le temps tout simplement… Voilà bien une chose dont la valeur n’est intéressante selon aucun calcul, et qui, selon moi, a pourtant une valeur infinie. Eh bien, c’est autant de choses que l’on peut trouver dans un jardin partagé.
Un jardin potager, c’est anthropique (donc pas « naturel » selon le petit Robert), ça produit de la nourriture – qui a une valeur utilitaire mesurable – mais c’est en réalité beaucoup plus que cela si on y ajoute toute la valeur immatérielle qu’il génère. Cette valeur ne dépend que de ce que l’humain est prêt à y mettre pour son prochain, mais aussi pour la faune et la flore qui l’habite et avec qui nous partageons plus qu’une partie de notre génome : un même lieu de vie, une même terre d’accueil.
Cette année, nous poursuivrons les ateliers de jardinage. Nous allons planter un verger partagé, mettre en terre nos premiers plants et récolter nos premiers légumes. Il va sans dire, vous êtes les bienvenus !
Nous allons également accueillir des écoliers à des ateliers de science participative autour du thème des sols et de la biodiversité (avec « Sol &co » et le « Laboratoire Sauvage »), organiser avec du public en insertion des chantiers participatifs autour du thème de l’écoconstruction et des énergies renouvelables (avec « I Wood » et « Energethic »)… Enfin, nous espérons construire un centre de formation à la transition écologique pour lequel ce jardin hybride sera le support pédagogique.
Quel programme ambitieux quand on regarde le cahier des charges de départ !
Ambitieux vraiment ? Oui et non.
Ambitieux oui parce que c’est un projet hybride et complexe, parce qu’ils sont nombreux à s’engager dans cette dynamique (en premier lieu les habitants), ambitieux parce que nous sommes soutenus par la Région, la Métropole, le Département, la Préfecture, la ville de Vandœuvre, et parce qu’on espère que cela rayonne sur tout le territoire…
Et ambitieux non, car au fond, ce n’est qu’un tout petit rien, un lopin de terre infiniment petit à l’échelle de la planète et une action infiniment mince face aux innombrables dégâts que nous avons déjà occasionnés depuis 200 ans. Bref, ce n’est rien qu’un jardin partagé.
Cependant, et si ça donnait envie à d’autres ? Si nous avions la chance de voir une foule de ces petits coins de verdures créateurs de bien-être et de lien naître un peu partout ? En fait, ils sont nombreux à nous avoir précédé – de la MJC Nomade à Racines Carrées, en passant par World in Harmony – et nous mettons déjà notre expérience au service du SIVU du quartier Saint-Michel-Jericho pour la construction d’un jardin intergénérationnel sur l’espace Champlain. Pour autant, cela changera t’il la face du monde ?
Probablement que non, mais chacun de ces lieux nourriciers et anthropiques est un moyen de rendre à la planète un peu de ce qu’elle nous donne et, au regard des changements brutaux qui nous attendent, autant de petits airbags nécessaires à l’Homme pour amortir le choc.
Damien Peltier [...]
4 janvier 2022ActualitésCette année encore, Kèpos anime, en coopération avec France Active Lorraine, le dispositif de la Serre à projets. Celui-ci lance ce mercredi 5 janvier 2022 un appel à candidatures afin d’accompagner sur le sud de la Meurthe-et-Moselle la création de nouvelles activités engagées pour la transition écologique. Les candidats peuvent postuler jusqu’au 9 février via le site de la Serre et sont invités au webinaire d’information le 20 janvier 2022 à 17h30. Retrouvez plus de détails ici.
Pour rappel, le dispositif de la Serre à projets vise à repérer des besoins non satisfaits sur le territoire, à imaginer des solutions pour y répondre, à étudier l’opportunité et la faisabilité des projets qui en sont issus, et à les transmettre à des porteurs de projets de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
6 opportunités d’activités retenues pour 2022
La valorisation de coproduits et déchets brassicolesUne cantine éco-responsable et solidaireLa collecte et le traitement écologique des déchets organiquesLa production et/ou la vente de fleurs coupées, locales et de saisonUne unité de lavage du linge éco-responsableUn système de vélo-bus et/ou vélo-taxi
Les candidats souhaitant s’investir dans la création de l’une de ces activités sont invités à répondre à l’appel à candidatures. Si aucun de ces projets n’a retenu votre attention, nous vous donnons également la possibilité de vous positionner sur le volet blanc, autrement dit proposer votre propre projet.
Quartiers en transition : des thématiques dédiées aux QPV !
La Serre se déploie également dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) du Grand Nancy pour accompagner la création d’activités répondant à 4 besoins recensés dans deux quartiers sélectionnés :
Les Nations à Vandœuvre-lès-NancyCuisine partagée et éco-responsableCantine SolidaireLes Provinces à LaxouRessourcerie “Jouets et enfance”Création d’un tiers-lieu
Qui peut répondre à l’appel à candidatures ?
Les porteurs de projets peuvent être de trois types :
Un ou plusieurs particuliers qui souhaitent s’engager dans un projet entrepreneurial. Les candidatures peuvent être émises par une personne seule ou par un collectif informel.Une association existante.Une entreprise sociale existante. Par entreprise sociale, on entend une entreprise s’inscrivant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire ou dont les activités sont porteuses d’un impact social et environnemental positif pour le territoire.
Les porteurs de projets peuvent ne pas être encore implantés sur le territoire du Sud Meurthe-et-Moselle. En revanche, leur projet doit nécessairement y être principalement localisé.
De quel accompagnement bénéficieront les lauréats ?
Les lauréats de la Serre à projets bénéficieront :
D’un appui méthodologique dans la réalisation de l’étude de faisabilité du projet.De la mise en réseau avec les partenaires de la Serre à projets.D’un ensemble de formations et d’ateliers.D’un accompagnement global sur le montage du projet jusqu’à sa concrétisation.D’un soutien technique et d’un appui dans la recherche de financements.
Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans le cahier des charges de l’appel à candidatures.
Les candidats sélectionnés devront par la suite présenter leur projet à l’oral devant un jury d’experts le 1er avril 2021.
Le décompte est lancé !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
4 janvier 2022Interviews Radio / ProjetsDans le cadre de notre partenariat avec Radio Caraib Nancy, Chloé, l’animatrice de l’émission « Bio diversité », intervient sur des sujets liés à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’environnement.
La recyclerie La Benne Idée, située à Jarville-la-Malgrange, s’est prêtée au jeu en retraçant les origines et le développement de cette association de réemploi spécialisée dans les objets de l’habitat : meubles, décoration, vaisselle et bricolage
Retrouvez l’interview d’Antoine Plantier, co-fondateur du projet :
Alexandra Casas de Kèpos [...]
20 décembre 2021Projets / Revues de ProjetsA l’occasion de la transformation de l’association Fibricoop en coopérative, nous avons interviewé Fabien Potiez, coordinateur de ce projet de valorisation des déchets textiles !
Qu’est-ce que Fibricoop ?
C’est une coopérative qui collecte et transforme le textile au rebut qui provient de blanchisseries industrielles. Nous créons des sacs avec différents types de textile : vêtements de travail colorés et linge plat blanc. En ce qui concerne notre gamme, nous commercialisons pour le moment des totes bags. Des cabas, sacs à langer, trousses d’école et de toilette, sacoches à vélo et des sacs à bières verront bientôt le jour ! On peut en faire des choses avec des anciens vêtements de travail ! Notre stock de matières premières va devenir plus conséquent dans les mois à venir : nous allons travailler avec des chiffonniers, prestataires de notre blanchisserie partenaire, ce qui nous permettra d’étendre notre gamme et répondre à la demande.
En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?
Parce que c’est un projet 100% local et très peu énergivore avec un impact environnemental positif : les vêtements sont réutilisés par Fibricoop au lieu de partir à la poubelle. Nous les transformons très peu, nous avons seulement besoin d’un peu de découpage pour créer les produits finaux, et cela sans aucun traitement chimique contrairement à ce qu’il est courant de voir dans l’industrie du textile. D’autre part, nous travaillons exclusivement avec des partenaires de la région : APF Entreprise pour l’atelier de couture, les produits sont floqués à Laxou, les vêtements viennent d’une blanchisserie à Malzéville et la collecte et l’acheminement du textile pourrait bien être réalisé prochainement en vélo cargo par la coopérative Les Coursiers Nancéiens ! Cette rencontre a d’ailleurs été organisée par Kèpos, nous vous remercions ! Le fait d’être passé d’une association à une SCIC renforce notre impact positif sur le territoire, puisque nous avons la garantie que le projet sera non-délocalisable et d’utilité sociale pour les habitants.
Pourquoi être passé du statut d’association à celui de coopérative ?
Notre projet a une visée commerciale et une production semi-industrielle, ce que ne permet pas le statut associatif. Maintenant pourquoi une SCIC ? Parce que nous voulons que chaque partenaire ait un intérêt à nous suivre, faire en sorte que toutes ces entreprises travaillent avec nous et ne soient pas en concurrence. Le projet de se transformer en SCIC nous est apparu évident parce que nous répondons à un besoin d’utilité sociale et notre projet fait partie intégrante de l’Économie Sociale et Solidaire. Les principes d’une SCIC sont les suivants : contribuer à l’impact positif d’un territoire, engager toutes les parties prenantes de la coopérative, créer un projet non délocalisable, et n’être rentable que dans l’objectif de pouvoir réinvestir en retour dans le projet. A l’inverse du système capitaliste, la prise de part au capital ne permet pas de s’enrichir ou de prendre possession de l’entreprise !
Comment se déroule le lancement de la souscription au capital ? Quels sont les retours ? Combien de sociétaires avez-vous actuellement ?
Tout se passe plutôt bien, plusieurs entreprises ont pris des parts mais pas encore de collectivités pour le moment. Nous visons les 15 000 euros avant la fin d’année. Nous comptons parmi nos sociétaires : la société COMPAS, l’épicerie de vrac Court-Circuit, APF entreprise, différents membres du Jardin d’entreprises de Kèpos, mais aussi de nombreux particuliers. La SCIC sera effective dès le 1er Janvier 2022. Il reste possible de prendre des parts tout au long de la vie de la coopérative.
Comment envisagez-vous la suite de l’aventure ? Si tout se passe bien, comment vous voyez-vous dans 5 ans ?
Si tout se passe pour le mieux, nous aimerions multiplier les produits et élargir notre gamme. Nous pourrons, par conséquent, proposer un catalogue fourni à toutes les entreprises que nous irons démarcher. Du point de vue des Ressources Humaines, nous souhaitons recruter un designer textile sur une durée indéterminée et pourquoi pas des apprentis dans les deux années à venir. A terme, l’idéal serait d’essaimer le projet sur d’autres territoires. APF a des ateliers de couture un peu partout en France, tandis qu’il y a également des blanchisseries industrielles dans tout le pays, ce qui nous laisse donc la possibilité de dupliquer notre projet.
Retrouvez toutes les actualités de Fibricoop ici et n’hésitez pas à contribuer au lancement de sa coopérative !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
14 décembre 2021ActualitésEn tant que centre de ressources et de formations à la transition, Kèpos veille à vous proposer des éléments de compréhension, méthodes et outils pour enclencher votre propre processus de transformation. Pour vous accompagner, selon vos besoins, dans une démarche d’évolution vers des usages plus sobres et soutenables, retrouvez nos prochaines sessions de formations ci-dessous :
INTRODUCTION A LA COMMUNICATION CONSCIENTE
Acquérir de nouvelles compétences émotionnelles et relationnelles
Public : particuliers et professionnels
Comment s’engager sans s’épuiser ? Comment collaborer dans nos équipes et collectifs de façon sereine et efficace ? La Transition Ecologique une grande intelligence émotionnelle et relationnelle de part l’implication et les transformations nécessaires. Heureusement, l’intelligence émotionnelle ça se travaille ! Guilaine Didier vous propose de découvrir la communication consciente pendant deux journées mêlant théorie et pratique pour des apprentissages concrets et dans la légèreté. Découvrez le programme de la formation sous ce lien.
24 et 25 janvier 2022
Durée : 14hDe 9h à 17h
300€ TTCPossibilité de payer en florains
Plan B51 rue de la République, 54140 Jarville-la-Malgrange
Je m'inscris à la formation
DEVENIR VOLONTAIRE ENVIRONNEMENT
Mettre en oeuvre l’écocitoyenneté au travail
Public : professionnels
Vous avez envie de porter un projet écologique au sein de votre entreprise ? Cette formation certifiante dispensée par le Réseau Feve est faite pour vous ! Frigo solidaire, jardin partagé, comptabilité carbone, paniers de fruits et légumes locaux, autant d’initiatives qui ont permis de changer les organisations de l’intérieur grâce au travail collectif des référents environnement. Sous un format alliant modules e-learning et journées en présentiel, appréhendez les outils et méthodes nécessaires au changement lors d’une formation qui débutera en mars 2022.
Feuilletez le programme en suivant ce lien.
COMPRENDRE ET LEVER LES FREINS AU CHANGEMENT
Public : professionnels et particuliers
Samuel vous guidera dans la compréhension des freins qui nous empêchent de changer, consciemment ou inconsciemment. Au programme : fonctionnement de nos cerveaux et biais cognitifs, aspects psychologiques, sociaux, économiques et mise en pratique collective autour de difficultés rencontrées dans vos activités avec vos clients, fournisseurs, salariés ou partenaires. L’urgence climatique sera le fil rouge mais les thématiques sociétales ou organisationnelles seront aussi les bienvenues. Découvrez le programme de la formation via ce lien.
28 février 2022
Durée : 7hDe 9h à 17h
150€ TTC
Possibilité de payer en florains
Plan B
51 rue de la République, 54140 Jarville-la-Malgrange
Je m'inscris à la formation
L’aspect financier ne doit pas être un frein pour votre formation ! Sollicitez votre OPCO pour une prise en charge et si le financement reste un problème, contactez-nous pour en discuter via formation@kepos.fr.
Je trouve mon OPCO
Alexandra Casas de Kèpos [...]
6 décembre 2021RéflexionsLe temps passe, et la lassitude gagne… « L’éternité, c’est long, surtout sur la fin », dit Woody Allen. Et en effet, les soubresauts de l’épidémie de Covid générèrent chez tout un chacun le sentiment d’être embarqué dans une sorte d’ascenseur émotionnel. C’est ainsi qu’au printemps 2020, avec le premier confinement, tout le monde était persuadé qu’il s’agissait d’un sprint, un mauvais moment à passer en quelque sorte. Le Président de la République a pu emprunter l’expression du « retour des jours heureux » au début de l’été 2020, alors que la contrainte sanitaire se relâchait. A l’automne, nous nous faisions fort de mieux gérer les éventuels sursauts épidémiques avec les masques arrivés depuis en quantité suffisante. Las, cela n’était pas du tout suffisant, et les contaminations reprirent. Revint alors l’espoir avec les vaccins, qui allaient nous sortir d’affaire. Et effectivement, la situation s’améliorait : armés de nos passes sanitaires, nous pouvions à nouveau fréquenter restaurants, concerts et salles de cinéma. Hélas, les perspectives s’assombrissent aujourd’hui à nouveau : les vertus des vaccins faiblissent avec le temps, le virus mute régulièrement, des personnes non vaccinés assurent au virus des jours fastes de circulation, et la fatigue se fait sentir.
La fatigue… « La chose la mieux partagée » aujourd’hui, pourrait-on dire en paraphrasant Descartes. Elle apporte une coloration à notre être au monde, elle est l’expérience contemporaine collective et individuelle par excellence. Les articles fleurissent sur la question, et la recherche académique s’en empare. Et de fait, les conséquences psychologique, sociale ou économique du Covid sont d’ores et déjà considérables. Certes, sous l’effet du Plan de relance, la machine économique s’est relancée de manière intense. Mais on aurait presque l’impression d’un épisode maniaque chez un patient bipolaire, tant cela semble artificiel et exagéré. Et quoi qu’il en soit, le rattrapage économique de 2021 ne résout aucun de nos problèmes sociaux, écologiques ou politiques.
Cette fatigue, de laquelle personne n’arrive à venir à bout, est d’autant plus écrasante que nous ne voyons pas le terme de cette épidémie. Et dussions-nous y arriver, elle n’est qu’un épisode de la crise écologique en cours, qu’un avatar d’une évolution bien plus large, celle qui a vu l’homme devenir une force géologique, évolution que l’on nomme anthropocène. En effet, le Covid et la manière dont il s’est déployé, sont très liés à notre rapport vicié aux écosystèmes naturels, à notre propension à nous déplacer à la surface du globe de manière frénétique, à notre appétit insatiable en produits et services, etc. Et l’anthropocène nous met face à des mutations autrement plus majeures qu’une épidémie somme toute bien maîtrisée et peu létale : effondrement de la biodiversité inédit depuis plus de 60 millions d’années, changement climatique dû à des concentrations de CO2 dans l’atmosphère inconnues depuis 3 millions d’années, etc. Bref, nous n’avons déjà plus faim, alors que nous n’en sommes qu’aux hors d’œuvre !
La fatigue de nos sociétés et de leurs membres est aussi celle des écosystèmes dans lesquels nous vivons, épuisés de sollicitations permanentes, que nous stimulons sans arrêt pour en obtenir davantage. Et comme pour n’importe quels organismes, plus nous les stimulons, moins nous en tirons quelque chose. Qu’il s’agisse de productions agricoles, de pétrole ou de matière premières minérales, partout les rendements sont décroissants, et il nous faut stimuler plus pour obtenir moins.
La bonne nouvelle est que ce dont ont besoin à la fois les écosystèmes, les sociétés humaines, les êtres humains en tant que corps et esprits, c’est de repos. L’antidote au burn out et à la fatigue, c’est de s’arrêter, de regarder autour de soi, de reprendre ses esprits, et de prendre conscience de qui l’on est, où l’on habite, etc. Prêter attention à soi, à l’autre, à ce qui est, est ce à quoi nous invite la philosophe Simone Weil dans l’Enracinement. Elle est une posture éthique fondamentale, qui nous restaure en tant que sujet, et donne à l’objet de notre attention la place qui doit être la sienne. Elle est l’alternative à l’excitation du monde actuel, connecté à tout, présent à rien. Le repos est ce dont les écosystèmes naturels ont besoin pour se réhabiliter. Il fait signe vers un choix essentiel que nous devons apprendre à faire : procrastiner ! Garder des choses à faire pour le lendemain, savoir s’arrêter, est une vertu, dont nous parle Charles Péguy dans le Porche du Mystère de la Deuxième vertu. Il s’agit d’une condition de l’espérance, dont nous avons tant besoin aujourd’hui. Nous voici donc au seuil d’un choix crucial : savoir distinguer nos vrais et nos faux besoins. C’est alors que nous pourrons laisser filer les vaines affaires du monde, pour renouer les fils du sens de nos vies terrestres.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
23 novembre 2021ActualitésAccompagnée de Fibricoop – coopérative de valorisation des déchets textiles industriels – et Frugali – cabinet de conseil et de formation en alimentation durable, Alexandra, notre alternante en communication, s’est rendue dans l’une des trois capitales européennes pour participer au Forum du Développement Durable. La 12ème édition du Forum avait lieu le mardi 9 novembre 2021, sous un format hybride alliant événement physique au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg et sessions décentralisées accessibles en physique ou en ligne depuis Laxou et Châlons-en-Champagne.
Organisé par l’association « Initiatives Durables », engagée au service de la responsabilité sociale, économique et environnementale, le Forum vise à promouvoir la transition écologique et créer des synergies entre professionnels du Grand Est.
L’évènement en quelques chiffres
Depuis 2008, le Forum a rassemblé plus de 7000 participants, 644 intervenants & animateurs, 164 sessions et 20 plénières
Le thème choisi pour cette nouvelle édition était le suivant : « Choisissons nos demains ! ». L’occasion de remettre en question nos modes de consommation post crise sanitaire et de nous questionner sur les solutions concrètes possibles et souhaitables de « demain ».
Au programme cette année
5 parcours thématiques : environnement, coopération, numérique, projection, organisation et managementDes tables rondesDes ateliers participatifsDes rendez-vous de networkingLa remise des Trophées RSE Grand Est
Autant de thématiques auxquelles Kèpos, en tant que structure de l’Economie Sociale et Solidaire, est attachée et et à la promotion desquelles notre coopérative travaille quotidiennement auprès des collectivités et de la société civile.
Une première table ronde « Anticiper, réagir et s’adapter : vers des territoires plus résilients » nous a permis de rencontrer des acteurs engagés de la région pour qui la notion de coopération représente également une valeur forte. « La résilience est notre horizon quoiqu’il arrive, il n’y aura pas de transformation de territoire sans les entreprises » soulignaient Sebastien Maire, délégué général de France Ville Durable et Pierre Zimmerman, chargé de mission ville en transition à l’Eurométropole de Strasbourg.
La journée a également été ponctuée d’ateliers participatifs sous le signe de l’impact numérique et de ses leviers d’actions. De beaux échanges sur les manières de réduire son impact environnemental par le biais de logiciels OpenSource et des démarches de sobriété numérique. Différents champs d’action sur lesquels Kèpos se positionne déjà depuis la création de la SCIC, en privilégiant des outils libres et une communication responsable.
Une belle opportunité pour notre structure et nos membres d’engager le dialogue avec des entrepreneurs engagés de la Région Grand Est et de favoriser l’échange de bonnes pratiques !
Retrouvez le déroulé de l’évènement sous ce lien !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
Actualités
22 août 2023Actualités / EvénementsÉtudiant.e sur le Grand Nancy à la rentrée ? Prêt.e à donner vie à ton nouvel appart ?Ne cherche plus !Fais le plein de pépites à prix mini avec la 1ère édition de la 𝗙𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 !𝗢ù ? 𝗦𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲s fêtes de 𝗚𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝘆 – Nancy𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 ? 𝗟𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟮 septembre de 𝟭𝟬𝗵 – 𝟭𝟴𝗵Tu cherches du petit électroménager, du mobilier stylé, des ustensiles de cuisine, des équipements high-tech, des vêtements tendance, du matériel de sport ou même un vélo ? Tout sera là, d’occasion et dans un esprit de solidarité et de durabilité.Un événement orchestré par 𝗟𝗲 𝗟𝗲𝘃𝗶𝗲𝗿, en partenariat avec la 𝗠étro𝗽𝗼𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆, le 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗩𝗶𝗲 𝗲𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆, la 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆, 𝗹’𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁é 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗖𝗿𝗼𝘂𝘀 𝗟𝗼𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲Viens retrouver nos héros locaux du réemploi :Recyclerie La Benne Idée, Les Ateliers Croix-Rouge Adlis, La Recyclerie de La Fabrique, Trucothèque, Recyclerie les 3R, De Laine en Rêves, Envie Lorraine, Repair café du Grand Nancy, Association Dynamo et Ecollecteurs, Association ALAIN, SOS FUTUR.Mais ce n’est pas tout ! Si ton toaster est capricieux ou si ta chemise préférée a perdu un bouton en cours de route, apporte-les ! Car tu pourras apprendre à redonner vie à ton toaster avec le Repaire Café et à recoudre les boutons de ta chemise avec Tricot Couture Service. Plutôt sympa, non ? De plus, nos experts Ambassadeurs de la Prévention et du Tri t’apprendront comment fabriquer tes propres produits ménagers et cosmétiques. Et pour couronner le tout, découvre comment le CROUS peut rendre ta vie étudiante encore plus cool.Comment nous rejoindre à la salle de Gentilly ?En Bus T2 direction Laxou Sapinière, arrêt Palais des Sports – GentillyEn Bus C2 direction Laxou Plateau De Haye, arrêt VologneEt devine quoi ? Le transport public est GRATUIT les week-ends !C’est GRATUIT et il y aura même de quoi satisfaire tes petites faims sur place !Invite tes amis à saisir l’opportunité et prépare une rentrée stylée et éco-responsable avec la FOIRE À L’ÉQUIPEMENT ! [...]
31 mars 2023Actualités / ArticlesKèpos, au travers de son centre de formation et de ressources « l’atelier de la transition », lance la programmation de ses formations 2023 sur son éco-lieu du Couarail à Vandoeuvre-lès-Nancy (54).
Pour vous inscrire c’est par ici ! Le prix de chaque formation est de 300 €, et peut être pris en charge par votre OPCO. Contactez-nous pour ne savoir plus : formation@kepos.fr.
Au menu :Au menu :
Le jeudi 6 juillet 2023 : “Transition écologique : comprendre les freins au changement”, par Samuel Colin, formateur chez Kèpos :
« Une de ces phrases vous parle peut être : « Je sais tout ça, mais que veux-tu que je fasse à mon niveau !», « A quoi bon, de toute façon, l’homme a toujours su rebondir », «Ce n’est pas à nous d’agir, c’est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités » . Pourquoi, alors que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir conscience des enjeux environnementaux, ne sommes-nous pas plus à agir ? Cette formation vous apportera des clés de lecture pour comprendre notre fonctionnement face aux changements et des pistes pour lever ces freins. »
Téléchargez ici le programme de cette formation.
Le jeudi 31 août 2023 : “L’éco-conception pour étoffer mon offre de produit ou de services”, par Ophélie Benito, Designer
« Formez-vous aux bases de l’éco conception en déstructurant le cycle de vie de vos produits et services. Apprenez à innover et améliorer votre offre en continu à partir des ressources du territoire. Découvrez les différentes méthodes d’innovation et de production respectueuses de l’environnement. »
Les jeudis 21 sept et 30 nov 2023 : “Comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action”, par Isabelle Jeannin, formatrice chez Kèpos
« Changement ou dérèglement climatique, finalement de quoi parle t-on ? Les informations se bousculent sur les enjeux environnementaux et il n’est pas aisé d’y voir clair, de prendre la mesure de ce qui se joue avec la transition écologique. Cette formation vous permettra à la fois de mettre de l’ordre dans votre perception des choses, de chasser les idées reçues, et surtout d’avoir des clés pour agir. »
Les 25 et 26 septembre 2023 : “Formation de formateurs” par Isabelle Jeannin et Samuel Colin, formateurs chez Kèpos
” Vous avez envie de transmettre vos compétences et vous avez besoin pour cela de maîtriser le cadre de la formation professionnelle pour les adultes afin d’animer efficacement des sessions de formation. Cette formation de 2 jours est faite pour vous donner toutes les clés pour bien démarrer une 1ère session avec des stagiaires “
Le jeudi 5 octobre 2023 : “Transition écologique et Objectifs de Développement Durable , comment articuler ces deux notions pour faciliter la sensibilisation ?”, par Isabelle Jeannin, formatrice chez Kèpos
” Vous avez envie d’accompagner la transition écologique de votre organisation mais vous ne savez pas par quel angle l’aborder. Vous connaissez les ODD, leurs liens avec vos activités n’est pas évidant pourtant vous sentez qu’ils pourraient être de bons alliés pour créer une dynamique de transition dans votre organisation. Venez découvrir le lien entre ODD et TE, comprendre comment les ODD peuvent être un atout pour lancer une dynamique “
Le jeudi 9 novembre 2023 : “Parler de mes convictions sans faire pression, écouter l’autre sans nier mes valeurs : initiation à la communication consciente” par Guilaine Didier, formatrice :
“Personne n’aime être un con-vaincu” (T. d’Ansembourg). Grâce aux clefs de la communication consciente (issue de la Communication Non Violente), venez comprendre et expérimenter ce qui, dans votre façon de vous exprimer et écouter, va favoriser l’ouverture et le dialogue autour des enjeux de la transition écologique. Ce qui au contraire ferme ou génère des réactions de défense, de déni. La communication consciente nous offre quelques belles clés pour nous rejoindre, fédérer et inspirer plutôt que se diviser, accuser et culpabiliser.“ [...]
29 octobre 2022Actualités / EvénementsLa transition écologique et solidaire impose de renouveler le tissu entrepreneurial local, et de faire émerger au plus près du terrain les activités engagées qui peuvent faire défaut sur le territoire. En effet il importe que, partout, de nouveaux services émergent et se développent, dans des domaines aussi variés que l’alimentation durable, les mobilités douces, l’économie circulaire ou encore les énergies citoyennes. Pour y parvenir, il peut paraître vain, ou en tout cas très long, d’attendre que les choses se fassent par elle-même. Les collectivités n’ont pas non plus la main pour développer cela en régie, sans risquer un épuisement de l’action publique. Il est donc essentiel que les acteurs d’un territoire sachent provoquer cette émergence. C’est précisément l’objet des fabriques à projets, ou fabriques à initiatives, que promeut l’agence d’innovation sociale Avise. Vous pourrez consulter sur ce sujet avec profit le livre blanc que celle-ci vient d’éditer sur les acteurs de l’accompagnement à l’entrepreneuriat durable.
Ces fabriques à projets sont des dispositifs partenariaux, mixant secteur public et secteur privé, qui visent à faire remonter du terrain des besoins non satisfaits en lien avec les enjeux de durabilité et de solidarité. A partir de ce travail diagnostic, il est mené une démarche d’idéation pour imaginer des idées d’activité à même de satisfaire ces besoins, puis d’étude de l’opportunité des projets qui pourraient en être issus. Ces projets en émergence sont alors confiés à des entrepreneurs sociaux du territoire, qui sont accompagnés jusqu’au lancement opérationnel des activités. On est donc bien là face à une logique d’entrepreneuriat inversé, où l’accompagnateur n’attend pas que le porteur de projet se manifeste, mais suscite le lancement des activités qui font défaut territorialement. Le benchmarking tient un rôle clé dans cette démarche : il s’agit d’observer ce qui se fait ailleurs, pour voir ce qui pourrait être transféré localement.
Pour des collectivités, ces fabriques à projets répondent à un vrai besoin, en ce sens qu’elles créent du partenariat entre le secteur public et le secteur privé, notamment l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Ce sont des démultiplicateurs d’initiatives, qui répondent à l’impuissance partielle d’une collectivité qui ne sait comment renforcer les services offerts sur le territoire sans les opérer elle-même. Elles constituent un moyen de créer des emplois durables non délocalisables répondant à des besoins sociaux, en misant sur la créativité des forces vives du territoire.
Kèpos a très tôt initié sur le bassin nancéien ce type de fabriques à projets, en coopération avec son partenaire historique, France Active Lorraine. C’est ce que nous avons appelé la « Serre à projets ». Celle-ci est en train de finaliser l’accompagnement de sa troisième promotion d’entrepreneurs, et a donné lieu à la création de plusieurs activités qui se sont depuis développées de manière ambitieuse : des recycleries, une conserverie de produits Bio et locaux, des services de mobilité douces, une coopérative funéraire, etc. Elle est financée par la Région Grand Est, le Département de Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand Nancy, la Ville de Nancy, mais aussi la Fondation GRDF, AG2R la Mondiale ou encore le Crédit Agricole. Pour aller plus loin dans la démarche, Kèpos et France Active Lorraine ont développé en 2021 une antenne de cette Serre à projets, nommée « Quartiers en transition », sur les Quartiers Prioritaires de la Politique de Ville (QPV) de la Métropole du Grand Nancy, grâce à des financements de l’État, de la Métropole et de la Banque des territoires. L’objectif : contribuer à la transition des quartiers en initiant des activités par et pour les habitants de ces lieux de vie.
Pour pousser plus avant la réflexion autour de ce modèle, Kèpos et France Active Lorraine vous proposent, en partenariat avec la Région Grand Est, une table-ronde sur le sujet le vendredi 4 novembre 2022 à 14h dans le cadre du Village des Solutions de Demain, qui se tient à l’Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle les 4 et 5 novembre prochain. L’occasion d’échanger avec des parties prenantes de cette dynamique : financeurs, opérateurs, bénéficiaires. Vous trouverez plus d’information sur cette rencontre sous ce lien. A bientôt ! [...]
10 octobre 2022ActualitésFace aux enjeux de la transition écologique, chaque acteur est mis en demeure de modifier sa stratégie et ses pratiques. Pour cela, les décideurs doivent réorienter leurs décisions, les agents faire évoluer leurs actions, et les particuliers transformer leurs modes de vie. Tout cela ne sera possible que si les acteurs ont les connaissances et les outils pour le faire. C’est pour cette raison que la question de la formation est une question clé de la transition.
Kèpos a très tôt voulu intégrer cet enjeu dans sa feuille de route. Notre SCIC est ainsi devenue centre de formation certifié Qualiopi en 2020. Elle propose ainsi à tous ses coopérateurs de développer leurs activités de formation sous sa bannière, contribuant ainsi à créer un véritable centre de formation de la transition écologique et solidaire. C’est ainsi que nos formateurs sont capables de vous accompagner et vous former sur des questions aussi variées que l’agroécologie, la biodiversité, l’énergie, le réemploi, le numérique responsable ou le climat. N’hésitez donc pas à consulter notre catalogue et à nous solliciter pour que nous construisions avec vous la formation dont vous avez besoin. [...]
31 mai 2022ActualitésKèpos développe avec l’association d’insertion ULIS un parcours de formation aux métiers de la Transition Écologique sur trois mois du 27 juin au 14 octobre 2022. Ouverte à tout type de public âgé de 16 ans minimum, cette démarche pédagogique alterne théorie, pratique et activation des savoir-être professionnels autour de la construction de leur projet professionnel. En tant que Stagiaire de la Formation Professionnelle rémunéré, l’action ouvre droit à :
L’AREF si demandeur d’emploi percevant l’ARE Ou une rémunération de la Région (Docaposte)
Cette action sur mesure est financée par la Région Grand-Est, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Politique de la Ville et la Métropole du Grand Nancy.
En partenariat avec la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, la formation se déroulera sur le terrain de Biancamaria, rue des Écuries, dans les locaux d’ULIS, rue d’Echternach et la Salle du Vélodrome de la Ville.
Le programme s’articule autour de trois pôles techniques : l’écoconstruction et les métiers du bois, les énergies renouvelables et les espaces verts. Un pôle spécifique vise, quant à lui, à accompagner les personnes via un suivi personnalisé :
Travail sur les soft skills (126 heures)
Sensibilisation à la Transition Écologique (28h)
Bilan de compétences, technique de recherche d’emploi, travail du projet professionnel (35h)
Communication et gestion de conflit (21h)
Écoute, confiance en soi, motivation, travail autour des métiers et de la posture (28h)
Aisance informatique, numérique responsable (14h)
Parcours personnalisé (40h)
3 entretiens de suivi individuels (3h)
Immersion en entreprise pour découvrir et confirmer son projet (35h + 2h de visite)
Approche des métiers du bois (189 heures)
Apprentissage des techniques manuelles élémentaires de la construction bois (175 heures)
Recyclerie : réemploi et création de mobilier (14 heures)
Énergies renouvelables (63 heures)
Réglementation électrique, sécurité travaux en hauteur et fonctions photovoltaiques (28 heures)
Immersion en entreprise : montage échafaudages, pose des panneaux et mise en service (35 heures)
Métiers liés aux espaces verts (105 heures)
Design et conception paysagère (14 heures)
Interprétation de la composition des sols (21 heures)
Animation et découverte de la biodiversité (7 heures)
Jardinage, maraîchage, élagage, cueillette.. (63 heures)
Vous trouverez des informations complémentaires sur le dispositif en parcourant ce document. Si ce dernier vous intéresse, nous vous invitons à remplir ce dossier de candidature.
Nous organisons deux réunions d’information collectives dans les locaux de l’Agence Pôle Emploi de Vandœuvre-lès-Nancy, 2 allée de Rotterdam, le 7 juin à 14h et le 16 juin à 9h. Contactez Magali Lergenmüller, en charge du projet chez Kèpos, à l’adresse suivante magali@kepos.fr ou Séverine Taulin à s.taulin@ulis.fr si vous souhaitez y participer.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
28 mars 2022ActualitésLa Serre à Projets accompagne depuis 2019 des porteurs de projets engagés dans la Transition Écologique et Solidaire sur le Grand Nancy. Le dispositif repère en amont des besoins non-satisfaits sur le territoire, imagine des solutions pour y répondre, étudie leur opportunité, puis les transmets à des porteurs de projets issus de l’Économie Sociale Solidaire. Retrouvez plus d’informations sur le fonctionnement de La Serre à Projets en vous rendant sur son site internet ou sur cet article.
Ce jeudi 17 mars 2022, Kèpos et France Active Lorraine, qui portent tout deux la Serre à projets, accueillaient les lauréats de la nouvelle promotion pour une journée d’intégration en présentiel. Une première pour le dispositif qui, depuis près deux ans, organisait ses rencontres en visioconférence.
Au programme de cette journée : atelier brise-glace durant lequel les lauréats ont appris à se connaître, présentation des projets et de l’accompagnement proposé par Kèpos et France Active Lorraine, suivie par une formation sur les six étapes de la création (l’idée, l’étude de marché, l’étude financière, l’étude juridique, la recherche de fonds, et enfin l’installation). D’autres formations auront lieu dans les prochaines semaines pour accompagner au mieux chaque activité, et faire monter en compétences les porteurs de projet.
Parmi les lauréats sélectionnés cette année, nous retrouvons une grande variété de projets :
Une recyclerie de matériels numériques portée par l’association ULIS et la société SOS Futur.Une solution d’auto-hébergement informatique libre et écologique par Codatte, jeune entreprise fondée en 2020.Une offre de vélo-taxi et vélo-bus pour une mobilité douce permettant de réduire la pollution liée au trafic automobile en ville.Un centre de médiation équine au service du bien-être des humains et des animaux.Un projet de “Café des enfants”, lieu de vie et de rencontres pour petits et grands.Une Cantine Solidaire avec l’association Le Vert T’y Go, réunissant publics isolés et producteurs locaux.Une recyclerie créative de textile.Une productrice de fleurs locales avec la Ferme Florale du Sânon La collecte et traitement efficaces des biodéchets par l’association AEIM ADAPEI 54
Le dispositif s’étend également depuis cette année sur les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) : “Les Provinces” à Laxou et “Les Nations” à Vandœuvre-lès-Nancy. Sur ces deux secteurs, la Serre va accompagner les projets suivants :
Un projet de Cantine Solidaire porté par l’association KHAMSAUn tiers-lieu dédié à la transition écologique et solidaire par l’association “Si l’on se parlait“
Les lauréats sautent désormais dans le grand bain de l’entrepreneuriat ! Suivez leurs évolutions sur le site internet de La Serre ou depuis sa page Facebook.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
23 février 2022Actualités / Interviews Radio / ProjetsEn compagnie de Chloé Baduel, animatrice de l’émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy, Chloé Lelarge, fondatrice du cabinet de conseil et de formation Frugali, est revenue sur les origines du projet, son champ d’actions mais également les perspectives qui se profilent pour l’année 2022.
Retrouvez son intervention ci-dessous :
Si la transition de votre entreprise vers des pratiques plus responsables vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Frugali via son site internet.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
23 février 2022ActualitésCe lundi 21 février, nous nous rendions dans les locaux de la recyclerie La Benne Idée, situés au 16 rue de la Malgrange à Jarville, en compagnie de plusieurs membres du Jardin d’Entreprises de Kèpos. Un moment convivial hors-les-murs pour faire découvrir les activités de chacun et, par la même occasion, créer du lien. A l’honneur ce mois-ci : l’association de réemploi de mobilier qui a pris le temps de nous expliquer la genèse ainsi que l’avenir du projet.
Lauréate de la Serre à Projets en 2020, l’association collecte des objets destinés à être jetés pour ensuite les vendre à prix solidaire en intégrant de la rénovation et de la création pour valoriser au maximum le mobilier récupéré. A termes, l’équipe espère réemployer 280 tonnes de déchets mobiliers par an grâce à l’accès aux déchetteries du Grand Nancy ainsi que les différents dons de particuliers et professionnels.
A l’initiative de ce projet nous retrouvons trois entrepreneurs engagés : Antoine Plantier, ingénieur géologue, Chloé Geiss, ingénieur agronome et Thomas Henry, anciennement menuisier ébéniste. Tous ont à cœur de mêler utilité sociale, sensibilisation et éco-responsabilité.
Ce projet pour objectif de créer 35 emplois dont une vingtaine en chantier d’insertion. Pour cela, la recyclerie a obtenu, il y a peu, l’agrément d’Atelier et Chantier d’Insertion. Une nouvelle étape pour cette association solidaire qui permettra d’accompagner des personnes dans leur démarche de retour à l’emploi.
Au sein de 5 000m² d’espaces disponibles destinés à devenir une “Cité du Faire”, la recyclerie en occupe actuellement 1 000m². De nouveaux ateliers d’artisans d’art devraient voir le jour dans quelques mois sur l’espace restant.
A terme pourront être menées des actions de sensibilisation à la transition écologique mais également des activités de création de mobilier design.
Découvrez la boutique en ligne
Suivez de près les actualités de l’association en cliquant ici.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
14 février 2022Actualités / Projets / Revues de ProjetsL’agence de communication responsable Comm’ un avenir soufflait sa première bougie le 4 janvier dernier, à cette occasion, nous avons posé quelques questions à sa fondatrice, Anne-Sophie Gall, sur son parcours et les perspectives du projet.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Anne-Sophie Gall et j’ai débuté mon parcours en communication par un DUT Communication des Organisations à l’IUT Charlemagne à Nancy. J’ai ensuite poursuivi en Master Stratégie et Conseil en Communication à la Faculté de Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Lorraine. Ma passion pour le chant et le secteur musical me destinait plutôt à travailler dans cette voie, mais ma progressive prise de conscience des enjeux environnementaux m’a amenée à repenser mes projets professionnels. C’est en 2018 que je commence à m’engager dans diverses associations écologiques, en particulier Greenpeace et La Cantoche. Le besoin de retrouver du sens dans ma vie professionnelle me pousse à quitter mon poste de Chargée de communication à la Ville de Ludres. L’idée de créer un projet en lien avec la transition écologique m’apparaît désormais comme une évidence. Après quelques mois de réflexion, je décide de me lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat en proposant mes compétences en communication aux structures engagées située dans la Métropole du Grand Nancy.
Qu’est-ce que Comm’ un avenir ?
L’objectif premier de ce projet réside dans le soutien que j’apporte aux initiatives vertueuses de mon territoire. Les associations et petites structures souffrent souvent d’un manque de visibilité et de ressources humaines ou matérielles en terme de communication. En les aidant dans leur communication, les structures auront la possibilité de toucher un plus large public et de démocratiser les problématiques d’enjeux climatiques et sociétaux.
En ce qui concerne, le terme « Agence », je suis consciente que ce dernier est connoté. Cependant, Comm’ un Avenir relève d’une réelle alternative aux agences de communication classiques. Ce terme permet de rassembler, en un seul mot, les différents champs d’action sur lesquels je peux intervenir : gestion des réseaux sociaux, communication print, identité visuelle, éco-conception, relations presse mais également la réalisation de plans de communication.
Je travaille pour le moment seule pour différentes structures, telles que day by day, Décor’Jardin, les Fermiers d’ici ou la coopérative anti-gaspi Arlevie. Grâce à la mise en réseau de Kèpos, j’ai également pu œuvrer à la communication de Fibricoop, coopérative de réemploi de textiles usagés issus de blanchisseries industrielles.
Comment en êtes-vous arrivée à imaginer cette nouvelle activité professionnelle ?
Cette idée d’agence responsable vient de mes engagements associatifs. Le manque de moyens en interne, qu’ils soient d’ordre humain, communicationnel ou financier, m’a poussé à créer ma propre entreprise au service de l’intérêt général. Bien qu’il existe une dissonance entre la communication et la transition écologique : l’un agit plutôt dans une vision court-termiste, tandis que le second s’inscrit dans le long terme, j’ai décidé de m’intéresser aux alternatives de la communication responsable. Cette dernière se démarque des messages poussant à la surconsommation ou la production de supports très énergivores. Chacune de mes missions est donc pensée de manière à limiter ses impacts : utilisation de logiciels open source, choix de supports écolabellisés et prestataires engagés, diffusion de messages clairs et transparents en accord avec les objectifs de développement durable, etc.
En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?
Le projet Comm’ un avenir contribue à la transition du territoire nancéien en soutenant des initiatives écologiques et sociales en faveur d’une meilleure intégration du territoire dans les enjeux de demain. Véhiculer des messages de sobriété me tient particulièrement à cœur, la transmission de connaissances est un levier indispensable à la sensibilisation à l’écologie des générations actuelles et futures. C’est pourquoi j’interviens également dans le cadre de la Licence Information et Communication de la Faculté de Lettres de Nancy, afin de partager mes expériences et montrer qu’une synergie entre écologie et communication est possible.
Consciente du manque en interne des associations, je propose un tarif solidaire et engagé de -20 % sur l’ensemble des services proposés. Bien qu’au départ Comm’ un avenir se destinait à la communication des associations, celle-ci s’oriente aujourd’hui vers tout type d’acteur de l’ESS portant des valeurs fortes et se donnant les moyens de les appliquer.
Comment envisagez-vous la suite de l’aventure ?
J’envisage la suite de l’agence à plusieurs. En effet, les propositions de contrats et la charge de travail s’accumulant, il devient de plus en plus difficile de travailler seule. Les demandes se multipliant, le projet tend également à élargir sa zone d’activité à la région Grand Est. J’aimerais, d’autre part, aller plus loin dans la réflexion et la réalisation des supports de communication responsable en creusant tous les aspects de l’éco-responsabilité et renforçant mes liens avec les structures engagées du territoire.
Merci !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
9 février 2022ActualitésCo-porté par Kèpos, France Active Lorraine et Simplon Grand Est, le Crea-Lab vise à accompagner de jeunes entreprises engagées de moins de 3 ans sur le bassin lunévillois.
L’accompagnement de la première promotion a débuté en octobre 2021 en regroupant divers secteurs d’activités : lutte contre le gaspillage alimentaire, restauration biologique et itinérante, dépollution des sols, création d’une librairie éco-responsable ou encore le développement d’un garage solidaire. Autant de projets qui participe à l’économie locale et dynamise son territoire !
Pour cette deuxième saison, le Crea-Lab lance son appel à candidatures pour recruter sur l’ensemble du bassin de vie lunévillois des entrepreneurs prêts à démarrer un programme de 6 mois visant à accélérer leur développement et conforter leur engagements écologiques, numériques et sociétaux .
Vous bénéficierez :
D’un accompagnement personnalisé
D’un diagnostic 360° de la performance de votre entreprise
D’un programme d’ateliers de formation ciblés
Si le projet vous intéresse, rejoignez nous lors d’une réunion d’information en ligne gratuite le jeudi 24 février de 9h30 à 10h30 !
Je m'inscris
N’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse suivante isabelle@kepos.fr ou par téléphone 06 61 48 81 92 si vous avez des questions !Vous avez jusqu’au 25 mars 2022 pour déposer votre candidature en remplissant le formulaire ci-dessous :
Je dépose ma candidature
Alexandra Casas de Kèpos [...]
24 janvier 2022ActualitésNotre chef de projet, Ian Mc Laughlin, répondait aux questions de Chloé Baduel dans son émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy le 20 janvier dernier, concernant l’appel à candidatures 2022 de La Serre à projets
Retrouvez son interview pour en apprendre plus sur ce dispositif et les thématiques retenues pour cette troisième année :
Alexandra Casas de Kèpos [...]
11 janvier 2022ActualitésNous confions aujourd’hui la plume à Damien Peltier, chef de projet de notre tiers-lieu sur le quartier Biancamaria !
Je souhaiterais vous parler des jardins partagés ou collectifs, et pour tout dire, tout particulièrement de celui créé de toutes pièces en partant simplement d’une idée : remettre en valeur une friche urbaine, couplée à l’envie de retrouver un lien avec la terre et le vivant.
Mais avant cela, une petite rétrospective s’impose…
Depuis le moyen-âge, nos villes occidentales sont pensées et conçues sur un modèle d’arrachement à la nature. Plus sûres et plus « civilisées » que jamais, nos cités actuelles nous apportent un confort indéniable : de l’eau potable au robinet, une commode proximité avec toutes sortes de vendeurs de biens et de denrées, la sécurité grâce à la protection apportée par nos portes blindées et nos brigades de police, la facilité d’accès à la culture, aux divertissements et aux soins … Un véritable paradis !
Pourtant, à la fin du XIXe siècle, l’urbanisation effrénée, engendrée par la « révolution industrielle », a reposé la question du rôle et de la place attribués au végétal dans l’espace urbain. C’est en 1919 qu’est apparue la notion « d’espaces libres à préserver », en 1961 que le terme « espace vert » a été introduit pour la première fois dans les textes réglementaires, et aux alentours des années 1980 que le concept de « trame verte et bleue » a été pensé. Enfin, dans les années 1990, les premiers jardins collectifs ont commencé à voir le jour en France. Bref, bien du chemin a été parcouru depuis l’ère industrielle, de l’urbanisme de la fonctionnalité d’hier à l’urbanisme écologique que nous connaissons aujourd’hui.
Mais alors, pourquoi, me direz-vous ? Pourquoi défaire le béton et les paysages stériles si rassurants et aisément praticables que nous avons mis tant de temps et d’énergie à fabriquer ? Pourquoi changer le visage de nos chères villes, devenues plus hautes, plus vastes et plus peuplées que jamais ?
En résumé, pourquoi réintroduire des espaces verts ?
La réponse à ces questions semble peut-être plus évidente avec cette reformulation : combien d’entre nous ont souffert de l’absence d’espace de « nature » en ces temps d’épidémie ?
Mais tout d’abord, peut-être convient-il de se demander : qu’est-ce que la nature ?
Si on en croit le Petit Robert, la nature c’est « tout ce qui existe dans l’univers hors de l’être humain et de son action ».
Cela voudrait dire que, quoique nous fassions, la ville et tous les espaces qui la composent ne peuvent être des espaces de « nature » puisque façonnés par l’homme.
Pire encore, cette définition amène à penser que l’homme lui-même ne fait pas partie de la nature.
Mais alors, sommes-nous destinés à vivre dans un univers parallèle fait de béton et de métal ? Nous sommes-nous tant éloignés de notre nature profonde et de la biosphère au point de nous en émanciper de la sorte ?
Force est de constater que non, si l’on en croit les très nombreuses études listant les bienfaits directs et indirects que ces petits coins de verdures nous apportent : diminution de la pollution de l’air et sonore, réduction du stress, santé préservée grâce à l’activité physique, impacts des vagues de chaleur et des inondations atténués, création de lien social… pour ne citer que ceux-là !
Nous aurions donc, bien malgré nous, besoin de cette nature que nous avons reléguée au rang de simple fournisseur de matière première, sale et insécure.
Pourtant, et ce n’est plus une surprise pour personne, la biosphère va exceptionnellement mal !
Depuis l’ère industrielle, l’activité humaine a provoqué à une vitesse record des changements qui ne se mesuraient jusqu’alors que sur des temps géologiques. De façon générale, nous nous rapprochons toujours plus des limites planétaires à ne pas dépasser si nous voulons éviter les dysfonctionnements globaux des écosystèmes… et il ne semble pas y avoir de changement dans cette tendance là non plus.
Ce qui signifierait que nous accordons moins de valeur à la nature qu’à notre propre bien être, alors qu’ils semblent si étroitement liés…
Mais alors, y aurait-il un souci dans la valeur que l’on donne à la nature ?
Puisque nos modes de vie et notre culture nous incitent à toujours faire un ratio coût/bénéfice pour juger de la juste valeur des choses, l’économiste écologue Robert Constanza a pris la peine de mesurer en 2016 le prix des services rendus par la biosphère : cela représenterait quelques 33 000 milliards de dollars par an…et rien de cela ne pollue ni ne génère de déchets qui ne soient pas valorisés par ailleurs…et tenez-vous bien, tout cela nous est offert ! Cadeau, c’est gratuit !
Oui, vous avez bien lu ! Plus d’un tiers du PIB mondial en services rendus gratuitement, voilà une approche pertinente pour déclencher les décisions de nos dirigeants !
Mais cette valeur a-t-elle véritablement un sens ? Est-ce que tout a un prix utilitaire ? N’avez-vous pas, comme moi, certaines choses dans votre vie qui ont une valeur qui ne puisse être mise en équation ? Votre famille, vos amis, votre santé peut être…
Revenons à notre jardin…
C’est en 2020 que la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Kèpos, la coopérative pour laquelle je travaille, est entrée en contact avec la ville de Vandœuvre-lès-Nancy. La commune avait un terrain, Kèpos les savoir-faire, et nous avions tous cette envie commune de faire évoluer les choses vers plus de bien-être, plus de liens, plus de « vert ».
J’ai failli oublier ! Kèpos est un ensemble d’entreprises et d’associations qui œuvrent à la transition écologique du territoire, et mon job à moi, c’est de coordonner les actions des différents membres de la coopérative. Ils sont aujourd’hui 24 et travaillent sur des sujets comme l’écoconstruction, la transition alimentaire, l’agroécologie, les énergies renouvelables, la science, la mobilité douce, le réemploi, le mieux-vivre et bien d’autres domaines encore… Bref, toutes sortes de compétences spécialisées qui, mises bout à bout, dessinent une forme de circuit logique, holistique et cohérent, où chacun est en mesure d’apporter à l’autre, tout comme dans un écosystème !
Le cahier des charges paraissait simple : créer un jardin partagé pour les habitants du quartier Biancamaria, tout en respectant les codes d’urbanisme et de façon à ce que cela soit bénéfique pour l’environnement. Il fallait donc trouver ce point d’intersection entre les envies et les besoins de chacun, les contraintes physiques et environnementales, les visions des uns et des autres…simple disais-je ?
Nous nous sommes donc concertés, avons réfléchi, nous sommes interrogés, avons réunionné, compilé, reconcerté… chacun a apporté sa pierre à l’édifice : la ville, les membres de la coopérative, les habitants du quartier, moi, l’aménageur, la Métropole… et après une « trouzaine » de réunions, de plans et de plannings en tous genre, nous avions enfin le feu vert pour investir ce terrain de jeu en août 2021.
Et quel terrain de jeu !! Avec Caroline (« Caroline Antoine ») et Aurélie (« Aurélie Marzoc »), qui ont pris en charge la concertation et la conception paysagère, nous partions d’une feuille vierge pour dessiner un lieu écologique, un lieu qui serait la vitrine des savoir-faire de la coopérative, un lieu créateur de lien, un lieu pour nous et pour les autres. Tout ou presque était possible, il suffisait de l’imaginer !
Notre envie principale était de remettre de la vie dans cette friche et de mettre de la vie dans le quartier. Nous n’étions pas seuls à le vouloir ; un groupe de résidents du quartier s’est mobilisé et nous a suivi, aidé, conseillé, appuyé.
On pouvait les compter sur les doigts d’une main au départ : Corinne, Gauthier, Yves et Max (le sympathique pince-sans-rire), de bonnes volontés à qui il convient de rendre hommage.
Créer un jardin prend du temps si on veut le faire dans le respect de l’environnement, et puisque travailler sur « sol vivant » n’est pas possible à coup de granules magiques, il fallait bien préparer ce terrain au sol si pauvre que même de simples patates n’auraient probablement rien donné. Nous avions besoin de bras, de beaucoup de bras.
Dès le départ, nous avons choisi de coconstruire ce lieu. L’évidence était donc d’offrir, aux habitants qui le voulaient, des formations en agroécologie en échange de leurs temps et de leurs efforts, lors de la création des zones de culture et du verger partagé. Du temps contre du savoir, des efforts contre des fruits et légumes.
Le premier atelier a eu lieu en août 2021, le 28 au matin, c’était un samedi.
Ils étaient six habitants en plus d’Enzo et Théo, les deux membres de la coopérative spécialistes des jardins permacoles (« Des Racines et Des Liens »). Malgré mon envie, je n’ai pu m’y rendre ce jour-là, car j’avais contracté ce satané virus qui fait frémir les Etats et met à mal les systèmes de santé depuis deux ans maintenant.
Ce que j’aurais aimé être là ! Des mois de travail pour finalement manquer le jour du lancement, les premières délimitations qui dessinaient enfin l’esquisse de quelque chose de concret ! J’aurais l’occasion de me rattraper…
Six en août, disais-je, puis douze à l’atelier de septembre, respectivement dix-sept et dix-huit, sans compter les oiseaux de passage, lors des ateliers d’octobre, et ça n’a pas désempli depuis. Des nouveaux venus à chaque rencontre, des curieux de passage, des enfants qui sèment et jouent dans les bottes de foin qui nous servent à couvrir les sols, pauses café-croissant, thé-gâteaux maison en fonction de ce que chacun apporte. Tantôt on bêche, tantôt on pioche, plante, pellette, discute, rigole, on échange une recette de cuisine, on raconte une blague, bref on fait connaissance…
Alors c’est ça un jardin partagé ? Un endroit où on noue des liens, où on joue et apprend, où on transpire et cultive plus qu’une simple terre. Un endroit où on donne une autre valeur au temps. Le temps de bien faire, le temps de faire une pause pour raconter sa vie à son voisin, pour écouter la sienne, le temps de laisser faire, le temps d’être ensemble, le temps de prendre le temps tout simplement… Voilà bien une chose dont la valeur n’est intéressante selon aucun calcul, et qui, selon moi, a pourtant une valeur infinie. Eh bien, c’est autant de choses que l’on peut trouver dans un jardin partagé.
Un jardin potager, c’est anthropique (donc pas « naturel » selon le petit Robert), ça produit de la nourriture – qui a une valeur utilitaire mesurable – mais c’est en réalité beaucoup plus que cela si on y ajoute toute la valeur immatérielle qu’il génère. Cette valeur ne dépend que de ce que l’humain est prêt à y mettre pour son prochain, mais aussi pour la faune et la flore qui l’habite et avec qui nous partageons plus qu’une partie de notre génome : un même lieu de vie, une même terre d’accueil.
Cette année, nous poursuivrons les ateliers de jardinage. Nous allons planter un verger partagé, mettre en terre nos premiers plants et récolter nos premiers légumes. Il va sans dire, vous êtes les bienvenus !
Nous allons également accueillir des écoliers à des ateliers de science participative autour du thème des sols et de la biodiversité (avec « Sol &co » et le « Laboratoire Sauvage »), organiser avec du public en insertion des chantiers participatifs autour du thème de l’écoconstruction et des énergies renouvelables (avec « I Wood » et « Energethic »)… Enfin, nous espérons construire un centre de formation à la transition écologique pour lequel ce jardin hybride sera le support pédagogique.
Quel programme ambitieux quand on regarde le cahier des charges de départ !
Ambitieux vraiment ? Oui et non.
Ambitieux oui parce que c’est un projet hybride et complexe, parce qu’ils sont nombreux à s’engager dans cette dynamique (en premier lieu les habitants), ambitieux parce que nous sommes soutenus par la Région, la Métropole, le Département, la Préfecture, la ville de Vandœuvre, et parce qu’on espère que cela rayonne sur tout le territoire…
Et ambitieux non, car au fond, ce n’est qu’un tout petit rien, un lopin de terre infiniment petit à l’échelle de la planète et une action infiniment mince face aux innombrables dégâts que nous avons déjà occasionnés depuis 200 ans. Bref, ce n’est rien qu’un jardin partagé.
Cependant, et si ça donnait envie à d’autres ? Si nous avions la chance de voir une foule de ces petits coins de verdures créateurs de bien-être et de lien naître un peu partout ? En fait, ils sont nombreux à nous avoir précédé – de la MJC Nomade à Racines Carrées, en passant par World in Harmony – et nous mettons déjà notre expérience au service du SIVU du quartier Saint-Michel-Jericho pour la construction d’un jardin intergénérationnel sur l’espace Champlain. Pour autant, cela changera t’il la face du monde ?
Probablement que non, mais chacun de ces lieux nourriciers et anthropiques est un moyen de rendre à la planète un peu de ce qu’elle nous donne et, au regard des changements brutaux qui nous attendent, autant de petits airbags nécessaires à l’Homme pour amortir le choc.
Damien Peltier [...]
4 janvier 2022ActualitésCette année encore, Kèpos anime, en coopération avec France Active Lorraine, le dispositif de la Serre à projets. Celui-ci lance ce mercredi 5 janvier 2022 un appel à candidatures afin d’accompagner sur le sud de la Meurthe-et-Moselle la création de nouvelles activités engagées pour la transition écologique. Les candidats peuvent postuler jusqu’au 9 février via le site de la Serre et sont invités au webinaire d’information le 20 janvier 2022 à 17h30. Retrouvez plus de détails ici.
Pour rappel, le dispositif de la Serre à projets vise à repérer des besoins non satisfaits sur le territoire, à imaginer des solutions pour y répondre, à étudier l’opportunité et la faisabilité des projets qui en sont issus, et à les transmettre à des porteurs de projets de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
6 opportunités d’activités retenues pour 2022
La valorisation de coproduits et déchets brassicolesUne cantine éco-responsable et solidaireLa collecte et le traitement écologique des déchets organiquesLa production et/ou la vente de fleurs coupées, locales et de saisonUne unité de lavage du linge éco-responsableUn système de vélo-bus et/ou vélo-taxi
Les candidats souhaitant s’investir dans la création de l’une de ces activités sont invités à répondre à l’appel à candidatures. Si aucun de ces projets n’a retenu votre attention, nous vous donnons également la possibilité de vous positionner sur le volet blanc, autrement dit proposer votre propre projet.
Quartiers en transition : des thématiques dédiées aux QPV !
La Serre se déploie également dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) du Grand Nancy pour accompagner la création d’activités répondant à 4 besoins recensés dans deux quartiers sélectionnés :
Les Nations à Vandœuvre-lès-NancyCuisine partagée et éco-responsableCantine SolidaireLes Provinces à LaxouRessourcerie “Jouets et enfance”Création d’un tiers-lieu
Qui peut répondre à l’appel à candidatures ?
Les porteurs de projets peuvent être de trois types :
Un ou plusieurs particuliers qui souhaitent s’engager dans un projet entrepreneurial. Les candidatures peuvent être émises par une personne seule ou par un collectif informel.Une association existante.Une entreprise sociale existante. Par entreprise sociale, on entend une entreprise s’inscrivant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire ou dont les activités sont porteuses d’un impact social et environnemental positif pour le territoire.
Les porteurs de projets peuvent ne pas être encore implantés sur le territoire du Sud Meurthe-et-Moselle. En revanche, leur projet doit nécessairement y être principalement localisé.
De quel accompagnement bénéficieront les lauréats ?
Les lauréats de la Serre à projets bénéficieront :
D’un appui méthodologique dans la réalisation de l’étude de faisabilité du projet.De la mise en réseau avec les partenaires de la Serre à projets.D’un ensemble de formations et d’ateliers.D’un accompagnement global sur le montage du projet jusqu’à sa concrétisation.D’un soutien technique et d’un appui dans la recherche de financements.
Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans le cahier des charges de l’appel à candidatures.
Les candidats sélectionnés devront par la suite présenter leur projet à l’oral devant un jury d’experts le 1er avril 2021.
Le décompte est lancé !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
14 décembre 2021ActualitésEn tant que centre de ressources et de formations à la transition, Kèpos veille à vous proposer des éléments de compréhension, méthodes et outils pour enclencher votre propre processus de transformation. Pour vous accompagner, selon vos besoins, dans une démarche d’évolution vers des usages plus sobres et soutenables, retrouvez nos prochaines sessions de formations ci-dessous :
INTRODUCTION A LA COMMUNICATION CONSCIENTE
Acquérir de nouvelles compétences émotionnelles et relationnelles
Public : particuliers et professionnels
Comment s’engager sans s’épuiser ? Comment collaborer dans nos équipes et collectifs de façon sereine et efficace ? La Transition Ecologique une grande intelligence émotionnelle et relationnelle de part l’implication et les transformations nécessaires. Heureusement, l’intelligence émotionnelle ça se travaille ! Guilaine Didier vous propose de découvrir la communication consciente pendant deux journées mêlant théorie et pratique pour des apprentissages concrets et dans la légèreté. Découvrez le programme de la formation sous ce lien.
24 et 25 janvier 2022
Durée : 14hDe 9h à 17h
300€ TTCPossibilité de payer en florains
Plan B51 rue de la République, 54140 Jarville-la-Malgrange
Je m'inscris à la formation
DEVENIR VOLONTAIRE ENVIRONNEMENT
Mettre en oeuvre l’écocitoyenneté au travail
Public : professionnels
Vous avez envie de porter un projet écologique au sein de votre entreprise ? Cette formation certifiante dispensée par le Réseau Feve est faite pour vous ! Frigo solidaire, jardin partagé, comptabilité carbone, paniers de fruits et légumes locaux, autant d’initiatives qui ont permis de changer les organisations de l’intérieur grâce au travail collectif des référents environnement. Sous un format alliant modules e-learning et journées en présentiel, appréhendez les outils et méthodes nécessaires au changement lors d’une formation qui débutera en mars 2022.
Feuilletez le programme en suivant ce lien.
COMPRENDRE ET LEVER LES FREINS AU CHANGEMENT
Public : professionnels et particuliers
Samuel vous guidera dans la compréhension des freins qui nous empêchent de changer, consciemment ou inconsciemment. Au programme : fonctionnement de nos cerveaux et biais cognitifs, aspects psychologiques, sociaux, économiques et mise en pratique collective autour de difficultés rencontrées dans vos activités avec vos clients, fournisseurs, salariés ou partenaires. L’urgence climatique sera le fil rouge mais les thématiques sociétales ou organisationnelles seront aussi les bienvenues. Découvrez le programme de la formation via ce lien.
28 février 2022
Durée : 7hDe 9h à 17h
150€ TTC
Possibilité de payer en florains
Plan B
51 rue de la République, 54140 Jarville-la-Malgrange
Je m'inscris à la formation
L’aspect financier ne doit pas être un frein pour votre formation ! Sollicitez votre OPCO pour une prise en charge et si le financement reste un problème, contactez-nous pour en discuter via formation@kepos.fr.
Je trouve mon OPCO
Alexandra Casas de Kèpos [...]
23 novembre 2021ActualitésAccompagnée de Fibricoop – coopérative de valorisation des déchets textiles industriels – et Frugali – cabinet de conseil et de formation en alimentation durable, Alexandra, notre alternante en communication, s’est rendue dans l’une des trois capitales européennes pour participer au Forum du Développement Durable. La 12ème édition du Forum avait lieu le mardi 9 novembre 2021, sous un format hybride alliant événement physique au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg et sessions décentralisées accessibles en physique ou en ligne depuis Laxou et Châlons-en-Champagne.
Organisé par l’association « Initiatives Durables », engagée au service de la responsabilité sociale, économique et environnementale, le Forum vise à promouvoir la transition écologique et créer des synergies entre professionnels du Grand Est.
L’évènement en quelques chiffres
Depuis 2008, le Forum a rassemblé plus de 7000 participants, 644 intervenants & animateurs, 164 sessions et 20 plénières
Le thème choisi pour cette nouvelle édition était le suivant : « Choisissons nos demains ! ». L’occasion de remettre en question nos modes de consommation post crise sanitaire et de nous questionner sur les solutions concrètes possibles et souhaitables de « demain ».
Au programme cette année
5 parcours thématiques : environnement, coopération, numérique, projection, organisation et management
Des tables rondes
Des ateliers participatifs
Des rendez-vous de networking
La remise des Trophées RSE Grand Est
Autant de thématiques auxquelles Kèpos, en tant que structure de l’Economie Sociale et Solidaire, est attachée et et à la promotion desquelles notre coopérative travaille quotidiennement auprès des collectivités et de la société civile.
Une première table ronde « Anticiper, réagir et s’adapter : vers des territoires plus résilients » nous a permis de rencontrer des acteurs engagés de la région pour qui la notion de coopération représente également une valeur forte. « La résilience est notre horizon quoiqu’il arrive, il n’y aura pas de transformation de territoire sans les entreprises » soulignaient Sebastien Maire, délégué général de France Ville Durable et Pierre Zimmerman, chargé de mission ville en transition à l’Eurométropole de Strasbourg.
La journée a également été ponctuée d’ateliers participatifs sous le signe de l’impact numérique et de ses leviers d’actions. De beaux échanges sur les manières de réduire son impact environnemental par le biais de logiciels OpenSource et des démarches de sobriété numérique. Différents champs d’action sur lesquels Kèpos se positionne déjà depuis la création de la SCIC, en privilégiant des outils libres et une communication responsable.
Une belle opportunité pour notre structure et nos membres d’engager le dialogue avec des entrepreneurs engagés de la Région Grand Est et de favoriser l’échange de bonnes pratiques !
Retrouvez le déroulé de l’évènement sous ce lien !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
2 novembre 2021ActualitésDans la continuité de La Serre à Projets et du Jardin d’Entreprises, Kèpos se déploie sur le bassin lunévillois, afin de développer son offre d’accompagnement et de conseil auprès de jeunes structures du territoire. Isabelle Jeannin a rejoint notre équipe début septembre dans le but de pérenniser ce projet, composé d’un Pôle Crea – regroupant les professionnels de l’accompagnement d’entreprises – et le Crea-Lab – réunissant de jeunes entreprises implantées sur le territoire de Lunéville.
Les enjeux de ce Crea-Lab sont de générer une double dynamique de transformation via huit ateliers co-animés par Kèpos, France Active Lorraine et Simplon.co :
Faire grandir les entreprises en matière de résilience et de durabilitéOrganiser une réponse globale et collaborative aux besoins du territoire.
La première promotion se compose de six structures :
Econick – Ecoplantes : récupéreration de métaux lourds de sols pollués et production de métaux bio sourcésIn Extremis : des produits alimentaires, gourmands, sains et anti-gaspillage !CAE au Cordeau : Coopérative d’Activités et d’Emplois spécialisée dans les métiers du bâtiment, second œuvre et constructionSam’régale les papilles : restaurant mobile proposant une cuisine originale de terroir lorrainLa Grange Motor’s : garage associatif qui permet de se former et prendre en charge l’entretien et les réparations courantes de ses véhicules dans un esprit de solidaritéSabibliothèque : Librairie éco-solidaire et recyclerie de livres
D’autre part, Kèpos accompagne et sensibilise également les professionnels du « Pôle Crea » à l’anticipation et l’accompagnement au changement avec des ateliers sur la thématique des transitions écologiques, sociales et numériques. Au fil des mois, sept ateliers de travail seront dispensés dans le but de développer une communauté de pratiques responsables sur le territoire et pouvoir ainsi proposer un accompagnement adapté aux structures du secteur.
L’appel à candidature pour une promotion 2022 du Créa-Lab aura lieu en Janvier pour un accompagnement à partir du mois de mars. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de France Active Lorraine.
N’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse suivante contact@kepos.fr si vous avez des questions !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
12 octobre 2021Actualités / Interviews RadioImplantée depuis plus de trente ans sur le Plateau de Haye et forte de 57 animateurs bénévoles, Radio Caraib Nancy est un véritable vecteur de cohésion sociale. Créée par une éducatrice et des jeunes de quartier, l’association participe à la vie et aux enjeux de la Métropole du Grand Nancy par le biais de ses programmes.
La radio associative diffuse depuis sa création des valeurs fortes que nous partageons telles que la solidarité et la coopération. Elle donne la voix à ceux que l’on entend peu en créant un dialogue entre les habitants du quartier, les associations et les institutions du Grand Nancy, via une grille d’émissions culturelles, sociétales, musicales, économiques et environnementales. C’est sur cette dernière thématique que Kèpos et RCN ont décidé de s’associer.
L’émission « Bio Diversité » s’engage ainsi à recevoir toutes les deux semaines un membre du Jardin, lauréat de la Serre à Projets ou un partenaire de Kèpos sous la forme d’une interview ou d’un reportage d’une durée de trente minutes. Les émissions pré-enregistrées sont diffusées le deuxième et quatrième jeudi du mois entre 12h et 12h30 sur la fréquence 90.7 FM. Une manière de faire gagner en visibilité les projets de notre communauté et de diversifier nos canaux de communication.
La recyclerie « La Benne Idée » s’est déjà prêtée à l’exercice début octobre ! Vous pourrez retrouver prochainement les émissions sur notre blog mais également sur le site internet de Radio Caraib.
L’émission vous intéresse ? Une actualité importante dont vous aimeriez que nous parlions ? Faites-nous en part n’hésitez pas à également nous consulter si vous avez des questions !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
28 avril 2021ActualitésKèpos et ses membres proposent depuis 2019 des offres de formations et d’ateliers diversifiées et adaptées aux différents publics à former et/ou sensibiliser : salariés d’entreprises ou de collectivités, élus, responsables ou bénévoles associatifs, particuliers, etc. Début 2021, notre nouveau catalogue de prestations vient compléter cette offre afin d’accompagner la transformation écologique des entreprises et territoires.
Riche d’une cinquantaine de fiches, il propose un large éventail de services avec un point commun : la prise en compte des problématiques environnementales et sociales qu’entreprises, associations ou territoires peuvent aujourd’hui rencontrer. Notre but : vous proposer une offre globale de transformation écologique de votre organisation, dans l’ensemble de ses dimensions : management, conception/production, énergie, systèmes d’informations, expertise-comptable, alimentation, aménagements extérieurs, etc.
Vous cherchez un support informatique qui maîtrise les enjeux de sobriété numérique ? Une prestation de communication ou comptable qui prend en compte les questions environnementales ? Un traiteur bio et local ? Un énergéticien pour maîtriser vos dépenses énergétiques ?
Vous les trouverez dans ce nouveau catalogue, aux cotés de nombreuses autres propositions, à télécharger sous ce lien ! Et bien sûr, n’hésitez pas à nous consulter pour toute demande particulière !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
13 janvier 2021ActualitésComme en 2020, Kèpos anime, en coopération avec France Active Lorraine, le dispositif de la Serre à projets. Celui-ci lance ce jeudi 14 janvier 2021 un appel à candidatures afin d’accompagner sur le sud de la Meurthe-et-Moselle la création de nouvelles activités engagées dans la transition écologique.
Pour rappel, le dispositif de la Serre à projets vise à repérer des besoins non satisfaits sur le territoire, à imaginer des solutions pour y répondre, à étudier l’opportunité et la faisabilité des projets qui en sont issus, et à les transmettre à des porteurs de projets de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
6 thématiques retenues !
Cette année, ce sont 6 thématiques qui ont été sélectionnées par le Comité de pilotage de la Serre à projets et qui ont donné lieu à 6 études d’opportunité dont les candidats peuvent s’inspirer :
Un bureau d’études Low-techUn service de verdissement de la VilleUne vélo-écoleUne galerie durableUn service de cyclologistiqueUn service de consigne du verre.
Il est important pour les personnes qui souhaitent postuler à l’appel à candidature de lire les études d’opportunité qui ont été réalisées. Vous pouvez retrouvez l’ensemble des projets de la promotion 2021 ici ! À noter que les variantes sont autorisées.
Comme l’année dernière, les candidats auront également la possibilité de proposer leur propre projet et de se positionner sur le volet blanc.
Qui peut répondre à cet appel à candidatures ?
Les porteurs de projets peuvent être de trois types :
Un ou plusieurs particuliers qui souhaitent s’engager dans un projet entrepreneurial. Les candidatures peuvent être émises par une personne seule ou par un collectif informel.Une association existante.Une entreprise sociale existante. Par entreprise sociale, on entend une entreprise s’inscrivant dans le champs de l’Economie Sociale et Solidaire ou dont les activités sont porteuses d’un impact social et environnemental positif pour le territoire.
Les porteurs de projets peuvent ne pas être encore implantés sur le territoire du Sud Meurthe-et-Moselle. En revanche, leur projet doit nécessairement y être principalement localisé.
Quel sera l’accompagnement de la Serre à projets ?
Les lauréats de la Serre à projets bénéficieront :
D’un appui méthodologique dans la réalisation de l’étude de faisabilitéDe la mise en réseau avec les partenaires de la Serre à projets.D’un ensemble de formations et d’ateliers.D’un accompagnement global sur le montage du projet jusqu’à sa concrétisation.D’un soutien technique et d’un appui dans la recherche de financements.
Comment postuler ?
Les réponses se font uniquement via le formulaire disponible ici. Aucune réponse passée le délai du 28 février 2021 à minuit ne sera acceptée. Pour connaître les modalités de sélection et le contenu du dossier, les candidats sont inviter à consulter le cahier des charges de l’appel à candidatures.
Les candidats sélectionnés devront par la suite présenter leur projet à l’oral devant un jury d’experts le 1er avril 2021.
Le décompte est lancé !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
30 octobre 2020ActualitésLe jeudi 5 novembre 2020 aura lieu en distantiel la grande soirée Start Up de Territoire en Meurthe-et-Moselle, initiée par le Collectif Essenciel 54, dont fait partie Kèpos. Rencontre avec Marie-Pierre Dardaine, partie prenante de ce projet, qui nous explique cette dynamique originale qui vise à imaginer de nouvelles activités engagées sur le territoire.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Après une expérience riche dans l’accompagnement et le financement de start up, je me suis lancée à mon tour dans la formidable aventure de l’entrepreneuriat avec Curionomie, agence évènementielle spécialisée dans la conception et l’organisation d’évènements prenant appui sur la (re)-découverte des territoires et de ses acteurs locaux.
Comment êtes-vous arrivée à vous impliquer dans le collectif Essenciel 54 ?
Dans mon parcours, je me suis impliquée dans de nombreux réseaux associatifs d’entrepreneurs et notamment au sein de la section de Nancy du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD). Ce mouvement d’entrepreneurs est un lieu d’expérimentation qui incite ses membres à ouvrir de nouvelles voies, à initier de nouvelles pratiques dans leurs entreprises : développement durable, RSE, économie de la fonctionnalité, bien-être des collaborateurs, … C’est bien naturellement que le CJD a souhaité être partie prenante du collectif Essenciel54, et s’engager dans une démarche audacieuse mobilisant des citoyens pour inventer les activités et les emplois de demain. Contribuer à faire naître un esprit entrepreneurial responsable et durable a toujours été au cœur de mon engagement professionnel, d’où mon implication dans ce projet.
Qu’est-ce que Start Up de Territoire ?
Start-Up de Territoire est une démarche citoyenne et entrepreneuriale dont l’ambition est de créer des activités à impact social, sociétal et environnemental répondant aux besoins des citoyens et des territoires. C’est une association nationale qui a déjà fait naître de nombreux projets sur différents territoires en France. En Meurthe et Moselle la dynamique est portée par le collectif EssenCiel54.
La démarche est assez simple : favoriser à travers des échanges l’émergence d’idées, puis transformer ces idées en projets, puis en traduire un certain nombre en création d’activités nouvelles sur le territoire. Cette démarche se fait en mode intelligence collective qui mise sur la capacité du groupe à collaborer pour atteindre une construction commune, et qui garantit l’équivalence des participants.
Concrètement, qu’est-ce qu’il va se passer le jeudi 5 novembre au soir ?
Après plusieurs mois passés à identifier des idées d’activités issues des ateliers de créativité organisés un peu partout sur le territoire, la soirée du 5 novembre avait pour but de réunir des centaines de citoyens intéressés à co-construire des solutions pour transformer ces idées en projets.
Les récentes mesures liées à la situation sanitaire ne permettent plus de maintenir la soirée en présentiel. Nous invitons alors tous les participants le 5 novembre à 18H à se retrouver dans une belle dynamique en visio pour découvrir les différents défis et à prendre date pour participer en petit groupe à un atelier « construction de solution » autour d’un défi choisi.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples d’idées qui seront soumises à l’intelligence collective ?
Les défis ont été regroupés au sein de 10 Univers. Un exemple de défi dans l’Univers Alimentation durable : « Deux mains pour un jardin », comment rendre le territoire plus vert grâce à la participation de chacun ? Un autre exemple dans l’Univers Finance solidaire : « Le Florain… chez moi aussi! », comment permettre l’appropriation par le plus grand nombre de la monnaie locale Florain.
Qu’est-ce que vont devenir ces projets une fois passé cette soirée ?
Une fois les ateliers de construction de solutions passés, de nombreux défis seront au stade du plan d’action, prêts à être boostés ! Ils pourront alors être proposés pour une étude de faisabilité et de viabilité économique, à réaliser en mode collaboratif associant les structures de l’écosystème de l’accompagnement à la création d’activité et des collectifs de citoyens. Notre pari est qu’un certain nombre de projets citoyens voient le jour et donnent lieu à de la création d’activités et d’emplois sur le territoire.
Quel retour pouvez-vous nous faire sur cette aventure : satisfaction ressentie ou difficultés rencontrées ?
Depuis son lancement, la démarche a mobilisé de nombreux acteurs d’horizons très différents, tous guidés par la volonté de porter une dynamique collective, porteuse de sens et d’innovation, pour répondre aux défis liés aux mutations sociales, économiques et environnementales. C’est une dynamique très satisfaisante qui s’est mise en place et porteuse d’espoir. Nous nous sommes tous enrichis au contact des uns et des autres, et nous avons souvent été bluffés par l’énergie qui se dégageait à chaque atelier de créativité. Bien sûr, nous avons eu les contraintes liées à la situation sanitaire (ateliers d’idéation en distanciel, report de la soirée initialement prévue le 4 juin, ajustement de la soirée du 5 novembre,…) ; pour autant la démarche ne s’est pas essoufflée et le collectif emmené par l’équipe du Conseil départemental 54 a réussi à faire rayonner la démarche en Meurthe et Moselle. Hâte de voir les premiers projets se concrétiser !
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
31 août 2020ActualitésCaroline Antoine est une artiste plasticienne et paysagiste, parmi les membres fondateurs de Kèpos. Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sis 48 esplanade Jacques Baudot à Nancy, accueille du 17 août au 25 septembre une exposition de ses œuvres, intitulée “Etre paysage / éloge du monde vivant”. A cette occasion, nous vous proposons deux textes qui illustrent ce travail.
« (…) Sous le soleil ou les nuages, en se mêlant à l’eau et au vent, leur vie est une interminable contemplation cosmique, sans dissocier les objets et les substances. (…) » ” La vie des plantes, Emanuele Coccia / Edition Payot et Rivage / p. 17 – 18
« Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » Martin Luther
« Caroline Antoine expose des estampes, carnets, dessins et sculptures éphémères à l’Hôtel du Département jusqu’au 25 septembre pour faire l’Éloge du monde vivant.
Formée à l’École Nationale Supérieure d’Art de Nancy puis ayant étudiée le paysagisme à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, Caroline Antoine crée un art en dialogue avec le monde.
De son expérience personnelle, elle exprime une sensation universelle entre l’être- vivant, charnel, spirituel et l’univers organique auquel il appartient.
Loin d’être en rupture avec la Nature, dans l’art de Caroline, la femme, l’homme, l’animal ou la chimère sont inscrits dans la globalité du monde : Les figures émergent de la glaise, les sujets sont en fusion avec le paysage, tantôt intimiste, tantôt en expansion. Les personnages de l’artiste sont souvent créateurs autant que créations.
Dans l’œuvre de Caroline Antoine, le rapport au végétal s’exprime avec force, tant dans ses écrits que dans ses sculptures. Dans les paysages urbains comme en forêt, l’artiste collecte des vues, des impressions, des éléments naturels (aussi appelés naturalia). À ces éléments glanés dans leurs sommeils : branchages tortueux, graminées et autres inflorescences, Caroline Antoine recrée un sens. Greffés les uns aux autres par de la cire d’abeille, ces naturalias deviennent, à eux seuls, des univers évocateurs, des œuvres parfois minimalistes et pourtant digne d’un cabinet des merveilles.
L’art de Caroline Antoine laisse la place au dialogue intérieur de l’observateur face à l’oeuvre ; mu par la force évocatrice de l’art, il est invité à rentrer en lui-même dans un silence habité et fécond. “
Chloé Pata
« Je vis avec et par les rivières, les forêts, les lacs et les mers.Je voudrais raconter cette co-dépendance entre les êtres et leurs lieux de vie.Il existe un Écoumène, qu’Augustin Berque définit comme un milieu d’interaction entre l’être humain et son espace de vie. Je suis les traces du paysage qui me constitue.Je deviens un être-paysage.Sans le sanctuariser, je vis dedans, je l’habite.En recherche d’harmonie avec mes tâtonnements, mes doutes, face aux grondements du monde, je dessine, je peins, je sculpte. Ces images intérieures me donnent de mes nouvelles.Parfois, je me glisse dans la nature pour m’y régénérer et l’arbre du jardin me donne de la force.Je n’oublie pas ce que je lui dois.Nous sommes un tout.Face au dérèglement climatique, je voudrais agir.Le dessin est mon cri et mon espoir.Je voudrais dessiner et planter ce que je dessine.
Aujourd’hui, j’ai un enfant. Comment lui parler de cet avenir incertain ?J’ai peint durant ma grossesse dans le sens du vivant,dans le sens de ces cellules que nous partageons avec toutes les formes de vie, sur cette planète.Quand l’embryon humain se fait amphibien, nageant dans la matrice maternelle, quel espoir autre que l’allégresse d’être en communion ?Ensemble nous sommes et nous serons.Cœurs à l’unisson avec la vie qui est partout,le regard vers les branches,l’esprit léger comme l’oiseau,l’âme dans la forêt, dans l’humusreconnectés enfinavec nous-mêmes. »
Caroline Antoine, Jeudi 9 juillet 2020
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
18 juin 2020ActualitésA l’occasion de l’Assemblée Générale de la SCIC Kèpos, qui s’est tenue le 12 juin 2020 dans les locaux de l’association Etre Eco LiE à Xirocourt (54), plusieurs médias se sont intéressés à notre coopérative.
Parmi eux, nous avons eu les honneurs de l’émission “Carnet des solutions” sur France Inter, présentée tous les jours de la semaine à la mi-journée par Philippe Bertrand. Trois minutes pour évoquer en quelques traits ce qu’est Kèpos, ses ambitions et son fonctionnement, à écouter ci-dessous.
Dans le même ordre d’idée, les Tablettes lorraines, ont relayés notre AG dans cet article.
Soutenez Kèpos !
Enfin, Kèpos et son “Jardin d’entreprises” ont été retenus par la Fondation Terre solidaire dans la sélection finale du Prix “Ils changent le monde”. Ce prix vise à valoriser des initiatives exemplaires au service d’un changement des modèles économiques, énergétiques ou alimentaires. A la clé, une mise en valeur dans plusieurs médias pour les projets vainqueurs !
Cette sélection est soumise au vote du public du 15 au 25 juin 2020. Nous figurons dans la catégorie “Economie au service de l’humain”. Tous se passe sur cette page ! N’hésitez donc pas à voter et faire voter vos amis, voisins, familles !
Merci beaucoup !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
6 avril 2020ActualitésAlors que l’épidémie de Covid-19 marque à coup sûr un tournant pour tous les acteurs économiques, nous vous proposons un retour sur l’année 2019 à travers ces quelques extraits du rapport annuel de la SCIC Kèpos. L’occasion de relire notre histoire récente pour mieux nous projeter.
Rappel du contexte
Au début de l’année 2019, Kèpos était une association réunissant une douzaine de jeunes entreprises de la région nancéienne engagées dans la transition écologique. L’agenda de la structure était alors le suivant : se transformer en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dans le courant de l’année 2019, au service de sa mission initiale : œuvrer à la transition écologique des entreprises et des territoires. Cette mission se fait aujourd’hui à travers l’animation du collectif des membres du projet, et par le portage d’une offre de conseil et de formation à destination d’entreprises plus mâtures, afin d’initier avec elles de nouvelles feuilles de route stratégiques au service de leur transition écologique et solidaire.
Notre ambition en 2019 était d’être repéré comme un acteur clé de la transition écologique de la région nancéienne. Sa réalisation devait permettre une transformation de l’association en SCIC dans les meilleures conditions. Le but en particulier était que la structure puisse être correctement financée, et bénéficier d’un premier flux de clientèle dès son lancement. Cela a passé par la réalisation d’un site Internet dédié au projet. En outre, Kèpos était très attaché à être perçu comme un outil de développement local thématisé sur la transition écologique, à la disposition du territoire et ses acteurs, qu’ils soient privés ou publics.
Etapes franchies par Kèpos en 2019
Le chemin parcouru par l’association Kèpos a été considérable. Le chantier le plus important était la transformation de l’association en SCIC Société par Actions Simplifiée (SAS) à capital variable. Celle-ci a été décidée en assemblée générale du 27 août 2019. A sa création, la SCIC comptait 44 associés, pour 43900 € de capital. Trois contrats de travail étaient signés dans la foulée, pour 1,4 Equivalents Temps Plein. Dans la foulée, le capital s’est vu consolidé par l’octroi d’une bourse de 7500 € de la Région Grand Est, et une prise de participation de 6000 € du Département de Meurthe-et-Moselle dans la SCIC. Cette opération est la première du genre sur le territoire. La Métropole du Grand Nancy a également été sollicitée sur ce point, et le dossier est toujours en cours à l’heure actuelle. Enfin, des entreprises phares du paysages local de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) de la région nancéienne ont été approchées, et certaines d’entre elles ont ou vont prendre des parts dans le projet (tel par exemple Envie Lorraine, entreprise d’insertion spécialisé dans le recyclage d’électroménager).
Le deuxième chantier était celui de la consolidation du groupe d’entreprises membres. En un an, le nombre de celles-ci a quasiment doublé : aujourd’hui, ce sont presque 20 structures qui sont réunies dans Kèpos, dans des métiers aussi divers que l’alimentation, la mobilité, la construction, le commerce, l’économie circulaire, le conseil, l’informatique, l’éducation, etc. Dans le même temps, la cohésion du groupe a considérablement augmenté : il se réunit tous les mois pour échanger, travailler ensemble et se former, notamment en invitant des universitaires ou des responsables économiques et territoriaux à parler sur des questions clés de la transition écologique. Aujourd’hui, les échanges de biens, de services ou d’informations au sein du groupe sont courants. Pour aller plus loin, Kèpos a obtenu un financement de la Métropole du Grand Nancy pour construire des offres partagées, communes à l’ensemble de ses membres. Par exemple, les professionnels de Kèpos ont conjugué leurs compétences pour créer une offre de sensibilisation à la transition écologique, qui est en train d’être portée auprès des collectivités, des structures d’éducation populaire, des entreprises, etc. Enfin, la consolidation du groupe a été concomitante de la montée en puissance de chaque membre. Chez chacun d’entre eux, des emplois ont pu être créées, des appels d’offres remportés, des financement décrochés, ou des initiatives mises en valeur dans la presse nationale. Cette émulation est très positive pour tous, pris individuellement ou collectivement.
Le troisième chantier avait trait au financement et au lancement d’un dispositif d’incubation, afin de créer de nouvelles activités en lien avec la transition écologique sur le territoire nancéien. Cela s’est fait à travers la création de « la Serre à projets ». Celle-ci est née de la réponse, par Kèpos et France Active Lorraine, à un appel à projets de la Région Grand Est en janvier 2019. Cette appel à projets a été gagné en mai 2019, avec à la clé un financement de 35000 euros par an pendant trois ans pour les deux structures confondues. Peu à peu, le Département de Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand Nancy, la Ville de Nancy, le groupe AG2R la Mondiale et le Crédit Agricole ont rejoint le tour de table, permettant d’atteindre un budget annuel global proche de 80000 €. La mission de ce dispositif est de repérer sur le territoire des besoins non satisfaits, d’imaginer collectivement des solutions pour y répondre, d’étudier la faisabilité de tels projets, puis de les confier à des porteurs de projets issus de l’Economie Sociale et Solidaire. Cet outil, qui appartiendra bientôt à un réseau national connu sous le nom de « Fabrique à Initiatives », est le seul du genre en France à être thématisé sur la transition écologique et solidaire. A ce jour, ce sont sept idées qui sont à l’étude. On peut par exemple citer l’idée d’une conserverie locale, d’une cantine solidaire, d’une recyclerie, d’une trucothèque, ou d’un service de consigne du verre. Le financement et le lancement de ce dispositif est le signe que la notoriété et la crédibilité de Kèpos ont considérablement cru en l’espace d’un an.
Enfin, le dernier chantier était de faire identifier Kèpos comme un prestataire crédible de formation et de conseil sur les questions de transition écologique des organisations. Des progrès ont été faits sur ce point, mais le processus est loin d’être achevé. Ainsi, une première formation sur le thème « Comprendre les enjeux et initier sa transition écologique » a été faite auprès d’un hôtel 4* de la région parisienne, permettant de passer au révélateur les intuitions de Kèpos en matière de sensibilisation et de formation. Cette séance d’une journée a permis de trouver la bonne formule pour faire prendre conscience à des dirigeants des enjeux énergie-climat et biodiversité, afin de susciter l’envie d’agir à l’échelle d’une entreprise. Aujourd’hui, des devis pour des interventions analogues sont en cours. Mais il est bien clair que la réforme à venir de la formation professionnelle va considérablement complexifier les choses pour un acteur comme Kèpos. Dans le même temps, de premières prestations de conseil ont commencé à être menées, avec plutôt de bons retours. La démarche est toujours la même : faire mettre la transition écologique à l’agenda des entreprises et des territoires. Car c’est là une manière d’anticiper des risques, de répondre à des attentes sociales, d’impliquer ses collaborateurs ou encore d’exercer sa responsabilité sociétale.
Perspectives 2020
L’épidémie de Covid-19 qui sévit depuis quelques semaines en France et en Europe, et ses conséquences, sont un facteur de fragilisation très fort pour le projet que nous portons. Mais c’est en même temps un révélateur des lignes de faille contemporaines que nous avons collectivement repérées depuis longtemps, en particulier sur ce blog. En ce sens, cette crise sanitaire nous invite à renforcer nos actions, pour les porter de manière beaucoup plus engagée. Car notre credo réside dans la relocalisation des flux, la simplicité technologique, la sobriété énergétique, la décélération drastique du rythme des échanges, la réallocation des ressources vers les vrais besoins, et ce manière plus inclusive et égalitaire. Pour cela, nous agirons en trois directions : le renforcement de nos fonds propres, pour financer notre changement d’échelle ; l’adaptation de nos offres, pour les rendre plus ambitieuses et plus globale ; l’accentuation de notre effort de communication, car nous devons, avec d’autres, gagner la bataille des idées sur la nécessité absolue de la transition écologique.
La crise actuelle est un avertissement : c’est le moment de rentrer en transition, tous et complètement. Il n’y aura pas de deuxième chance : continuer à agir as usual signifiera une chute globale certaine, beaucoup plus violente que cette épidémie.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
24 février 2020Actualités / Interviews RadioLa SCIC Kèpos et son fondateur Emmanuel Paul, ont pu, ces derniers temps, faire l’objet de plusieurs reportages à la radio. Voici quelques unes de ces émissions à écouter, pour découvrir plus en profondeur les principes et modalités de ce projet.
Le 7 février 2020, “Les TPE, actrices de la transition écologique”, dans l’émission “Commune Planète” animée par Anne Kerléo sur l’antenne nationale de RCF :
Le 8 décembre 2019, “Kèpos et la transition écologique”, dans l’émission “Durablement Vôtre” d’Eric Mutschler, sur une quinzaine de radios locales du Grand Est :
le 28 octobre 2019, “Des entreprises au service de la transition écologique”, dans l’émission “Citoyens de demain”, animée sur RCF Nancy par Patricia Cartigny et Denys Crolotte, du Mouvement pour une Alternative Non-Violente (MAN) :
En juillet 2019, débat sur le thème “Développement durable ou décroissance contrôlée, quelle espérance pour demain? ” à Paray-le-Monial avec Jean-Philippe Pierron, philosophe, retransmis à la radio sur l’antenne nationale de RCF :
Bonne écoute !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
21 janvier 2020ActualitésKèpos anime, en coopération avec France Active Lorraine, le dispositif de la Serre à projets. Celui-ci lance le 20 janvier 2020 un appel à candidatures afin d’accompagner sur le sud de la Meurthe-et-Moselle la création de nouvelles activités engagées dans la transition écologique.
Qu’est-ce que la Serre à projets ?
La transition
écologique est un enjeu majeur pour nous tous ! Ensemble,
il nous faut œuvrer à un changement très profond de nos modes de
vie vers la sobriété et la durabilité. Pour cela, il est essentiel
de faire preuve d’imagination pour créer et développer de
nouvelles activités qui permettent au territoire d’opérer sa
transition. C’est ce que propose la Serre à projets !
Ce dispositif, animé par France Active Lorraine et la SCIC Kèpos,
vise à repérer des besoins non satisfaits sur le territoire, à
imaginer des solutions pour y répondre, à étudier l’opportunité
et la faisabilité des projets qui en sont issus, et à les
transmettre à des porteurs de projets de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS).
Il s’agit donc bien d’une méthodologie d’entrepreneuriat
inversé, où l’on part des besoins du territoire, et non pas des
porteurs de projets ! Particularité unique en France de cet
outil de développement territorial : il est thématisé sur la
transition écologique !
Comment travaille la Serre à projets ?
L’action
de la Serre à projets se déroule en 5 étapes, renouvelées chaque
année :
Détecter
des besoins sociaux et des opportunités socio-économiques via un
réseau de capteurs d’idées.
Inventer
des réponses
collectivement,
et valider leur pertinence et leur viabilité grâce à une étude
d’opportunité.
Transmettre
le projet à un entrepreneur qualifié ou à une entreprise sociale
existante via un appel à candidatures.
Accompagner
les porteurs de projets jusqu’à la création de l’entreprise
sociale, après validation des projets grâce à une étude de
faisabilité.
Lancer
la nouvelle activité.
Bénéfices de la Serre à projets pour les porteurs sélectionnés
La
Serre à projets propose aux lauréats de l’appel à candidatures :
La réalisation en cotraitance de l’étude de faisabilité
technico-économique du projet.
Le suivi du projet par l’ensemble des partenaires publics,
parapublics et privés de la Serre à projets.
Un ensemble de formations et d’ateliers pour les porteurs de
projets.
Un accompagnement jusqu’à la concrétisation du projet.
Une mise en valeur mutualisée.
Les
lauréats signeront une charte d’accompagnement qui précisera les
modalités de l’engagement de chacun.
A qui s’adresse cet appel à porteurs de projets ?
Les
porteurs de projets peuvent être de trois types :
Un ou plusieurs particuliers qui souhaitent s’engager dans un
projet entrepreneurial. Les candidatures peuvent être émises par
une personne seule ou par un collectif informel.
Une association existante.
Une entreprise sociale existante. Par entreprise sociale, on entend
une entreprise s’inscrivant dans le champs de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) ou dont les activités sont porteuses d’un
impact social et environnemental positif pour le territoire.
Les
porteurs de projets peuvent ne pas être encore implantés sur le
territoire du Sud Meurthe-et-Moselle. En revanche, leur projet doit
nécessairement y être principalement localisé.
Sur quel territoire doivent se trouver les projets soutenus ?
La
Serre à projets déploie son action sur le Sud de
Meurthe-et-Moselle : la Métropole nancéienne, et les trois
bassins de vie de Pont-à-Mousson, Toul et Lunéville. Les projets
sélectionnés devront nécessairement y être localisés sous la
forme d’un établissement. Les projets qui seront capables de se
déployer directement à cette échelle seront valorisés. Les
projets permettant de créer des synergies entre ces différents
bassins seront évalués positivement.
Quels sont les projets sur lesquels se positionner ?
Sept idées ont été retenues dans le cadre d’un processus d’étude des besoins du territoire en matière de transition écologique. Il est recherché des porteurs de projets sur chacune de ces sept idées. Des études d’opportunité, disponibles sur le site de la Serre à projets, ont été réalisées pour chacune d’entre elles. Il est nécessaire de s’y référer avant de déposer toute candidature.
Ces
sept idées sont les suivantes :
Un
tiers
Lieu de la transition écologique.
Une
conserverie locale.
Une
cantine solidaire.
Un
dispositif de sensibilisation à l’alimentation
responsable.
Une
recyclerie.
Une
trucothèque.
Un
service
de consigne du verre
Les
variantes sont autorisées, et il est possible de ne se référer
qu’à tout ou partie des éléments de l’étude d’opportunité.
Les réponses collectives, montées par plusieurs acteurs, sont
encouragées. De même, les articulations qui pourront être trouvées
entre les différentes idées seront valorisées positivement. Enfin,
la Serre à projets peut, à titre exceptionnel, accompagner un ou
plusieurs projets qui ne seraient pas issus du processus d’idéation
précédemment décrit. Il
vous est donc possible de répondre avec votre propre projet !
Modalités pratiques
L’appel
à candidatures est lancé le lundi 20 janvier 2020 et se clôture le
dimanche 15 mars 2020 à minuit. Un
afterwork est prévu le jeudi 13 février afin que les porteurs de
projets intéressés puissent se rencontrer et poser toutes leurs
questions aux animateurs du dispositif.
A vous de jouer !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
24 décembre 2019ActualitésLa question de l’éducation et de la sensibilisation est au cœur des enjeux de la transition écologique. Celle-ci ne concerne pas seulement les enfants, mais toute personne, dans sa vie personnelle et professionnelle, à tout âge de la vie. Le discours sur la crise écologique est prégnant dans les médias, mais force est de constater qu’il n’engendre pas nécessairement une volonté de changement, et ce tant à l’échelle individuelle que collective. Pour aller plus loin, il est nécessaire que les questions écologiques ne restent pas en surface, mais soient capables de mettre en route tout un chacun en conscience. Car ensemble, il nous tout changer, et complètement. La capacité à être mû en profondeur est donc essentielle.
C’est dans cette esprit que Kèpos et ses membres ont conçu une offre partagée d’ateliers de sensibilisation à la transition écologique. Celle-ci s’adresse aux acteurs de l’éducation (nationale ou populaire), aux collectivités, aux organisateurs d’événements, aux entreprises, ou encore aux structures de l’action sociale. Chacun pourra y trouver des propositions d’ateliers d’une heure trente, une demi-journée ou une journée, adaptées à tous les contextes.
Découvrir le monde pour mieux le protéger, se former pour peu à peu changer ses modes de vie, créer et s’émerveiller pour faire surgir la poésie : autant de possibilités offertes par les ateliers que propose ce répertoire, tous animés par des professionnels. Tout un chacun (enfant, adulte, professionnel, personne en situation de fragilité) pourra ainsi découvrir le fonctionnement d’un sol, la vie d’un potager, le travail de la laine ou du bois, ou encore les clés d’une alimentation responsable. Ou comment se mettre en route par une autre relation au monde !
Quels que soient vos besoins, les membres de Kèpos seront heureux de mettre à votre disposition leurs compétences et leur enthousiasme, au service de la formation de tous.
Téléchargez ici l’offre partagée d’ateliers de sensibilisation à la transition écologique de Kèpos !
Illustration : Caroline Antoine, tous droits réservés
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
6 septembre 2019ActualitésLe 10 juillet 2019 se tenait au Verger de Vincent ,à Xirocourt (54), le premier événement organisé par Kèpos sur le thème «Ruralité et urbanité en transition», réunissant une centaine de personnes. L’objectif : faire dialoguer habitants des villes et des campagnes sur les nécessaires changements de modes de vie à opérer dans la perspective de la transition écologique. Au départ de cette initiative était la volonté des membres de Kèpos de créer des espaces de contribution pour les citoyens, à l’heure où chacun constate des pertes de cohésion majeures entre et dans les territoires. Car c’est bien là une lecture possible de la crise dite « des gilets jaunes ».
Pour cela, l’événement incluait la tenue de six forums ouverts, co-animés chacun par une personnalité du monde rural, et une personnalité du monde urbain. Parmi les acteurs ayant accepté cette proposition se trouvaient des élus, des chefs d’entreprises, des responsables associatifs, des syndicalistes, de simples citoyens… Chaque participant, qu’il vienne de la ville ou de la campagne, était invité à s’exprimer. Voici les six thèmes transversaux retenus, décrivant globalement et sans hiérarchie les uns par rapport aux autres, ce qu’on appelle des modes de vie :
Se nourrir
Naître, grandir, vieillir
Travailler
Se déplacer
Faire société
Habiter
Pour chacun, une trame de réflexion était proposée en trois temps :
Quelle est la situation actuelle ?
Vers quoi faudrait-il aller dans la perspective de la transition écologique ?
Quelles actions mettre en place collectivement ?
En trois quart d’heure, chaque groupe était invité a rentrer dans une logique de contribution, en sortant des postures de réclamation qui sont trop souvent celles que l’on constate dans les médias. Nous vous proposons ici une synthèse des fruits de ces discussions.
Se nourrir
La question de l’alimentation cristallise des différences fortes entre ville et campagne. Ainsi, il est paradoxalement plus difficile de trouver des produits fermiers locaux en campagne qu’en ville, tout simplement parce que les circuits de distribution ne sont pas en place en zone rurale pour ce type de produits. Les marchés de producteurs se trouvent plutôt en ville : en zone rurale, la faible densité de population gène la rentabilité de telles installations. A cela s’ajoute une situation locale propre à la Meurthe-et-Moselle, où le pourcentage de produits locaux ne représente que 2 % de la consommation alimentaire sur le sud du département. A l’opposé, on constate en ville un éloignement de la terre, qui se traduit par exemple par la pratique de plus en plus recherchée du jardinage.
Comment réamorcer une dynamique vertueuse qui permette à la fois aux citadins de se réapproprier le lien à la nature, et aux ruraux de bénéficier des fruits du travail de la terre réalisé à la campagne. La réflexion du groupe s’est ici attardée sur la questions des jardins partagés, tels qu’il en existe un à Ognéville, village en transition proche de Xirocourt. Ce type de lieu permet tout d’abord le partage et la transmission des savoir-faire. Il répond donc à un besoin social. Dans le même temps, c’est un endroit d’ouverture à de nouvelles pratiques culturales, par exemple issues de la permaculture, répondant à un enjeu de formation. C’est enfin un lieu de production alimentaire, qui permet collectivement de se poser le question de la nourriture : qu’est-ce que se nourrir ? A quel coût ? Avec quelle qualité ? Ainsi, à travers un jardin partagé se crée un réseau de proximité qui répond à la question de l’isolement, qui est un problème qui gangrène notre société. On apporte alors une réponse collective à une question qui n’est d’habitude abordée que de manière individuelle, à travers des comportements de consommation. Cela est rendu possible par une mutualisation des temps et des compétences. Le collectif rend les choses plus faciles : le jardin partagé est davantage entretenu que celui individuel, car il y a toujours quelqu’un pour y travailler. On répond ainsi à un enjeu clé de la transition : passer de l’individuel au collectif, en prenant le temps de la construction collective. Ce temps est plus lent, mais il solidifie les projets. Enfin, cette approche collective est visible : être ainsi regardé valorise l’action menée et stimule les acteurs au travail.
Sur les territoires fleurissent ainsi les initiatives de ce type, œuvrant à une réappropriation collective de l’alimentation. On en retrouve un certain nombre dans les Programmes Alimentaires Territoriaux (PAT). Toutes montrent que se nourrir est un acte social. La balle est donc dans le camp des citoyens, pour imaginer, mutualiser, construire…
Naître, grandir, vieillir
Le panel de participants à ce forum, d’origine géographique et sociale très diversifiée, faisait, sur cette question des âges de la vie, le constat d’une double fracture : territoriale et générationnelle. Ce qui frappe, aussi bien en ville qu’à la campagne, c’est l’absence de lieux de rencontre qui permettraient de sortir de l’entre soi (générationnel, social ou territorial). Il devient donc crucial, à l’heure de la transition écologique, de concevoir et animer des lieux ou des temps où les contraires puissent se rencontrer : jeunes et vieux, urbains et ruraux, classes favorisées et défavorisées… C’est une condition pour arriver à une réelle égalité des chances. En ce sens, l’éducation populaire a un rôle très important à jouer.
On observe bien une carence des lieux de connexion : cafés, parcs, jardins… Il en résulte un partage social et une transmission intergénérationnelle qui ne se font plus. De même, citadins et urbains n’ont plus l’impression d’habiter leur territoire. Pour répondre à ces enjeux, il conviendrait que chacun puisse connaître son territoire, pour le faire sien, en le partageant avec les autres. Ainsi, toute personne serait mise en demeure de mutualiser avec les autres : temps, compétences, ressources, dans une logique de transmission intergénérationnelle. La culture de l’écoute est à insuffler dans toutes les structures collectives, pour que chacun soit dans une posture de contributeur à la mesure de ses moyens et de ses besoins, selon une logique donnant-donnant. Cela est bien sûr encore plus vrai dans les structures éducatives. Enfin, cela questionne le développement des tiers lieux : comment les définir et les concevoir ? Comment en imaginer l’essor et l’affirmation ?
Travailler
Dans ce forum sur le travail sont rapidement convoquées deux références clés :
L’expérimentation « Territoires Zéro chômeurs de longue durée » à Colombey-les-Belles, à quelques kilomètres de Xirocourt : deux Entreprises à But d’Emploi (EBE) y ont embauché 70 chômeurs de longue durée, en utilisant comme base de leur salaire leurs indemnités chômage.
Le principe du “temps choisi” expérimenté dans les années 90 à Grenoble. Des salariés estimant trop travailler y décidèrent de passer à temps partiel, laissant donc à une personne en recherche d’activité le surplus de travail libéré. Dans le même temps, les personnes à temps partiel faisaient le choix d’un engagement social fort, par exemple dans le secteur associatif.
Si ces expérimentations interpellent le groupe ici réuni, c’est qu’elles parlent du sens du travail, à l’heure où les logiques productivistes, gouvernées par les nombres, semblent déposséder les travailleurs précisément du sens de leur activité. Les personnes présentes issues du monde agricole peuvent en témoigner. Pour conjurer cela, une participante affirme ainsi toujours parler de ce qu’elle « fait de sa vie », plutôt que de ce qu’elle « fait dans la vie ». Les participants sont alors interpellés par le mouvement de reconversion qu’opère un certain nombre de professionnels arrivés à mi-carrière. Mais est-ce là quelque chose de marginal, ou de réellement structurel ?
Ces réflexions viennent alors questionner ce à partir de quoi une valeur est donnée au travail. Ainsi, il est mieux considéré d’avoir un emploi nuisible (ingénieur dans l’armement ou publicitaire) que de ne pas avoir d’emploi et de s’investir socialement. La considération est donc très liée aux salaires et à l’argent que génère une activité. Mais abandonner un métier nuisible n’est pas chose aisée, tant l’équilibre est difficile à trouver entre le travail comme pourvoyeur de revenus indispensables, et l’engagement social comme vecteur de sens. Il convient donc de mieux cerner ce qui confère de la valeur au travail, pour en réévaluer sa place dans nos sociétés et nos vies.
Pour les personnes présentes, c’est alors le travail comme commun qui est à construire : non pas comme lieu de réalisation individuelle ou pire d’application de processus, mais bien comme réalisation collective pour le bien de la société. D’où la nécessité d’une compréhension fine de ce que sont les réels besoins de celle-ci. Pour cela, il est essentiel de pouvoir expérimenter de nouvelles solutions innovantes pour créer de la richesse sur les territoires.
Se déplacer
Se déplacer revêt une réalité très différente selon que l’on habite en ville ou à la campagne. Mais ce qui frappe d’abord les participants au forum, c’est que ces deux mondes ne sont pas étanches : les rurbains, qui expliquent l’essentiel de la croissance démographique des zones rurales, passent leur temps à faire des allers-retours entre ville et campagne. Or, ce type de déplacements est très prisonnier de la voiture, les transports collectifs peinant à trouver une rentabilité dans les zones d’habitat diffus. Cette dépendance est factrice d’une fragilité financière des ménages, très dépendants des prix des carburants. Or, on est passé en quelques décennies d’un monde où le litre d’essence coûtait 1 franc, à un monde où il coûte 1,50 euros, soit 10 fois plus. Mais cela n’a eu aucun effet sur la croissance des déplacements. Augmenter les tarifs n’est donc pas un moyen suffisant pour réguler l’usage de la voiture.
Se déplacer en voiture est facteur de coûts très importants, pour un ménage pris en particulier, ou pour la société toute entière : on mobilise de l’énergie, du temps et des infrastructures. A rebours des politiques qui prévalent depuis très longtemps, il ne faut donc pas faciliter le déplacement, mais chercher à le limiter. En effet, si l’on peut plus facilement se déplacer, l’on sera toujours incité à habiter plus loin, à voyager plus vite, à se déplacer plus longtemps, en une fuite en avant nourrie par l’effet rebond. Mais limiter les déplacements va à rebours d’une tendance naturelle de l’homme à vouloir se déplacer. L’enjeu devient donc bien de relocaliser les lieux d’activités à proximité des lieux d’habitation, en desserrant la contrainte dans les villes : chercher à sortir de la concentration dans les métropoles. Il devient essentiel de distribuer les activités sur le territoire. Quelque part, cela invite à ne plus privilégier les logiques d’attractivité et d’accumulation de richesses en un seul endroit. En augmentant la diffusion et la diversité des activités sur un territoire, on le rend plus résilient, en une sorte de permaculture territoriale. Dans le même ordre d’idée, il convient de chercher à optimiser le système en surenchérissant le mésusage de la voiture, et non pas son utilisation en général. Car l’enjeu est bien celui d’un retour à une forme de sobriété en questionnant le sens de son déplacement, et en sortant de l’immédiateté. On retrouvera alors avec profit un sens perdu de l’organisation : accepter de passer du temps à organiser son trajet, pour en limiter les impacts. Et collectivement, urbains et ruraux auront à questionner une nouvelle fois la notion de tiers lieux, comme réponse aux enjeux de déplacements comme de sociabilité.
Faire société
Ce forum part d’un diagnostic partagé : opérer la transition écologique est une nécessité, mais celle-ci doit être juste au niveau social, sans quoi, comme le montre l’épisode des « gilets jaunes », la société y perdra sa cohésion. Faire société recoupe des réalités différentes en ville et à la campagne : pour certains, dans les petits villages c’est plus facile du fait de la proximité, mais les difficultés sont aussi nombreuses (départ des jeunes, peu de mélange intergénérationnel, peu d’étrangers au territoire, problème des services publics…). Dans le même temps, les déplacements sont, dans la ruralité, liés à la voiture : la communication physique qui peut nécessiter de se déplacer en est altérée. En outre, on observe des différences de sociabilité entre néo-ruraux, qui peuvent être là pour « trouver du confort moins cher », et gens du cru. En ville, espace par définition très anonyme, comme à la ca
mpagne, l’individualisme est un frein pour faire société. Comment donc redonner du sens ? Comment donner l’envie de s’engager ? A rebours de ce qu’il faudrait, un sentiment d’impuissance s’immisce dans la société, alors que des leviers sont là pour agir. Mais cette conscience est peu partagée. C’est dans ce contexte qu’il va falloir modifier radicalement nos modes de vie, les éco-concevoir. Ce peut être le projet global auquel chacun pourrait se rattacher. Mais on en est très loin pour le moment.
Habiter
Pour les citoyens engagés présents à ce forum, la situation actuelle se caractérise d’abord par la prééminence de la maison individuelle, avec artificialisation des sols. Dans le même temps, de nombreux logements ne correspondant pas à ce modèle sont vides. Pour l’un des participants, « l’habitat individuel est la base du système de consommation ». Comment, dès lors, sortir d’un système qui crée des déséquilibres écologiques majeurs, et fragmente notre société.
La clé d’entrée est bien la question du collectif dans l’habitat. L’urgence écologique nous inviterait à davantage mutualiser les ressources, les espaces… Mais dire que la transition, c‘est l’habitat collectif est par définition clivant : ceci peut paraître une négation de l’individualité. Dans le même temps, c’est sans doute une voie possible pour recréer du lien dans un contexte de fragilisation économique et sociale. Cela revient à transformer une vulnérabilité en prenant le parti de l’humanité et du partage.
A ce moment, la question devient alors : comment sensibiliser ? Puis convaincre ? Les citoyens ici présents veulent croire que leurs initiatives peuvent entraîner les décideurs publics et privés derrière eux. Mais pour cela, l’écologie n’est qu’une accroche possible. Il faut surtout arriver à se donner des défis communs, qui mettent en route, en donnant envie à chacun de se saisir des problèmes qui les concernent.
En conclusion
De ces échanges soutenus, plusieurs idées très riches émergent. Elles ont trait à la place des communs dans notre société : recréer des espaces, des temps, des modes d’existence partagée, en se saisissant des leviers de l’expérimentation et de l’engagement. Ce projet n’est pas écrit à l’avance : il est à construire et à découvrir ensemble. Car la transition ne pourra être que dans un sursaut du collectif, permettant, pour reprendre les mots d’un participant, de « créer un éco-système plus sobre autour de la vie » !
Crédits photos : Samuel Faure et Guillaume Rambour
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
13 juillet 2019ActualitésLes six derniers mois ont été très riches pour Kèpos, avec de nombreuses étapes franchies, et des perspectives qui se dégagent, avec en vue la création de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Le projet est d’abord devenu plus visible, à travers notamment la création de son site Internet, réalisé par L’assembleuse, financé par une subvention de la Fondation Amar y Servir, et conçu pour être le plus sobre possible. La vie de ce blog s’est affermie, et son audience s’est consolidée. Enfin, nous sommes sortis du bois au niveau local, en organisant un événement nommé “Ruralité et urbanité en transition”, le 10 juillet dernier au Verger de Vincent, à Xirocourt, qui a été un succès avec une centaine de personnes présentes. Nous avons également été présents au colloque du Ceras “Quel travail pour une transition écologique solidaire ?” au mois de mai, à la convention d’affaires transfrontalières des achats responsables organisé par le Cluster ESS de la Grande Région au mois de juin, ainsi qu’à l’événement Start Up de Territoire à Strasbourg début juillet. Bref, Kèpos est de plus en plus présents dans les réseaux de la transition et de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), en Grand Est et ailleurs.
Un printemps 2019 profitable
En même temps qu’il gagnait en visibilité, notre projet a noué des partenariat de plus en plus étroits avec des acteurs clés du territoire. Ainsi en a-t-il été avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, France Active Lorraine et le Plan B, avec qui un projet de Fabrique à initiatives a été déposé auprès de la Région Grand Est, accepté par cette dernière le 17 mai 2019. Cette Fabrique sera opérationnelle en septembre 2019, et sera nommée “la Serre”. Elle vise à repérer sur le territoire des besoins non satisfaits, à imaginer des solutions en réponse et à en étudier la faisabilité, avant de confier ces projets à des porteurs issus de de l’ESS. Ce dispositif sera le seul du genre en France thématisé sur la transition écologique. Avec cette action, Kèpos se positionne donc sur l’émergence de nouvelles activités liées à la transition.
Parallèlement, le collectif des membres de Kèpos s’est étoffé, jusqu’à atteindre plus de 15 jeunes entreprises ou associations, et s’est aussi diversifié pour couvrir une réelle diversité de métiers. Ces entreprises engagées ont dans le même temps passé des seuils de manière très satisfaisante : gain de marchés publics importants, investissement dans de nouveaux locaux, accélération du rythme des commandes, accès facilité à des financements… L’étape actuelle de la vie du collectif vise maintenant à mettre en synergie les compétences des uns et des autres pour monter des offres partagés. Pour ce faire, Kèpos s’est positionné avec une de ses membres, Aurélie Marzoc, designer indépendante, pour répondre à l’appel à projet Tango & Scan. Celui-ci a été gagné le 14 juin dernier, permettant à Kèpos et Aurélie Marzoc de bénéficier d’un financement de la Métropole du Grand Nancy pour mener une opération de design de services permettant de construire ces offres partagées dans un dialogue avec leurs futurs utilisateurs.
Enfin, ce semestre a été mis à profit pour mettre sur pied un programme de formation dédié à la transition écologique des organisations, notamment construit par une future collaboratrice de Kèpos, Laure Hammerer. Cette offre de formation modulaire s’intitule “Initiez votre transition écologique” et a pu être testée avec succès auprès d’un hôtel 4* de la région parisienne. A coup sûr, entreprises et territoires sont beaucoup plus mûrs pour profiter de telles formations qu’il y a 10 ou 15 ans, où le concept clé était celui de développement durable.
Ouverture du capital de la SCIC Kèpos
Aujourd’hui, Kèpos en est à une étape clé de sa jeune histoire, puisque sa transformation en SCIC est imminente, prévue pour le 27 août 2019. Différents partenaires ont permis d’avancer sur ce chemin : l’Union Régionale des SCOP Grand Est, qui a apporté son ingénierie juridique, France Active Lorraine pour les aspects financiers, de même que la société financière de la Nef. L’été est consacré à la réunion des fonds nécessaires au lancement de l’entreprise.
Pour cela, votre concours est essentiel, car une SCIC comme Kèpos est avant tout un projet collectif, ouvert à la participation de chacun ! Un des meilleurs moyens de nous soutenir est de prendre des parts dans notre SCIC. Associés à la gouvernance du projet selon le modèle un homme = une voix, vous devenez partie prenante de son ambition, en contribuant à son financement et à sa mise en œuvre concrète par, pourquoi pas, le partage de vos compétences ou de votre réseau. Notre volonté est bien d’associer le plus largement possible notre projet aux hommes et femmes qui veulent s’engager.
En souscrivant, vous serez affectés à un collège d’associés soutenant le projet, avec d’un côté les personnes morales, et de l’autre les personnes physiques. Chacun de ces collèges dispose de 10% des droits de vote en assemblée générale. En outre, si vous souscrivez à titre personnel, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18% du montant investi.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez consulter notre brochure pour les investisseurs. Et surtout, rendez-vous donc sur la page “Nous soutenir” du site Internet de Kèpos ! Et à bientôt pour faire avancer ensemble la transition écologique, ici et ailleurs !
Photo : Ruralité et urbanité en transition, crédit : Guillaume Rambour
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
20 juin 2019ActualitésA l’heure où la transition écologique est plus que jamais une nécessité dont s’emparent des pans entiers de la société, Kèpos a souhaité organiser un événement qui permette de réfléchir à l’articulation entre ville et campagne dans la perspective de la transition. En effet, les enjeux énergétiques et écologiques sont gros de problèmes de cohésion territoriale entre espaces ruraux et urbains. D’où la volonté d’initier un dialogue autour de ces questions à l’occasion d’un événement festif qui puisse inspirer acteurs publics, privés et grand public. Notre souhait est ici de faire dialoguer, de permettre à chacun d’expérimenter et de jouer, et de célébrer les initiatives positives qui naissent sur nos territoires.
Quand ? Le mercredi 10 juillet 2019 de 17h à 22h
Où ? Au Verger de Vincent, à Xirocourt (54), non loin du cimetière du village
Au programme :
L’objectif de cet événement est de créer un temps d’échange sur notre façon d’aborder la transition écologique. Ainsi, à partir de 17h30, les festivaliers pourront échanger lors de forums ouverts sur leur manière d’être en transition, que ce soit pour leur choix alimentaires, leur mobilité, ou leurs modes de vie en général… Ces témoignages permettront de prendre conscience de ce que chacun met en œuvre tant dans la vie rurale que dans la vie urbaine afin de tendre vers la sobriété.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de pratiquer la transition écologique. Des ateliers, accessibles à tout âge, permettront de découvrir comment il est possible de donner une seconde vie au plastique, de jardiner au naturel, de tendre vers le zéro déchet, ou encore de cuisiner de façon autonome, etc…
Après 19h30, il sera l’heure de déguster bières et burgers locaux et bio tout en profitant d’un bœuf musical.
Pour réserver le repas, il suffit de s’inscrire : https://www.billetweb.fr/ruralite-et-urbanite-en-transition
Au plaisir de vous retrouver pour célébrer ensemble la vie heureuse !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
2 janvier 2019ActualitésLes six premiers mois (de janvier à juin 2018) de Kèpos ont permis de tester l’idée. Ce test a pris la forme d’un premier collectif d’entreprises, qui ont pu ensemble définir la vision qui présidait à leur rassemblement. Dans le même temps, l’idée a été présentée à un certain nombre d’acteurs, qui ont pu apporter leur éclairage sur les facteurs clés de succès d’une telle démarche. Au mois de juin 2018, la feuille de route était donc considérablement éclaircie, permettant de définir les enjeux auxquels il s’agissait de répondre, les objectifs de la démarche, les outils et méthodes à utiliser et les modalités de financement à mobiliser. A partir de là, le deuxième semestre 2018 allait être le temps de la structuration.
D’un point de vue juridique, cette structuration s’est faite en deux temps. Tout d’abord, Kèpos a été accueilli au sein de la Coopérative d’Entrepreneurs Synercoop, une SCIC autogérée basée en Meuse. Celle-ci a permis que Kèpos puisse facturer, et surtout a ancré le projet au sein d’un écosystème de l’Economie Sociale et Solidaire très favorable. Ceci s’est également traduit par le transfert de méthodes et de compétences, de Synercoop vers Kèpos, notamment quant aux questions de gouvernance partagée. Cela étant, ce n’était pas Kèpos en tant que collectif qui était accueilli au sein de Synercoop, mais plutôt son coordinateur, ce qui limitait les marges de manœuvres. En particulier, il était de plus en plus demandé, de la part du cercle de partenaires en train de se construire autour de Kèpos, que le collectif se dote d’une personnalité juridique propre. A moyen terme, l’objectif était bien que celle-ci soit créée sous le format d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Afin de progresser petit à petit, les membres de Kèpos ont choisi de passer par une étape associative. C’est ainsi que l’association de préfiguration de la SCIC Kèpos a été créée le 11 décembre 2018. Il s’agit là d’une phase transitoire, celle-ci devant se transformer en SCIC avant l’été 2019. Ce type de processus présente l’avantage qu’il y a continuité de la personnalité morale quand l’association se transforme en SCIC : les conventions passées par l’une sont conservées par l’autre. C’est d’ailleurs, à notre connaissance, le seul cas où une association peut se transformer en entreprise.
Le deuxième chantier de cette phase de structuration concernait le financement de l’initiative. De premiers jalons ont été posés en la matière. Tout d’abord, les membres du collectif ont commencé à contribuer à son fonctionnement. Calculée en fonction de la marge brute de chaque entreprise, une participation est demandée à chacun trimestriellement. Cette contribution est bien sûr appelée à croître au fur et à mesure que les activités des membres vont se développer. Une deuxième source de financement a été initiée, à travers la réalisation de prestations pour les membres du collectif. En l’occurrence, il s’est agi de prestations d’assistance dans la recherche de financements, ainsi que de services de facilitation commerciale. Enfin, un premier essai de demande de financement auprès d’une fondation a été réalisé. Ce galop d’essai, auprès de la Fondation Amar y Servir, abritée par la Fondation Terre Solidaire, a été couronné de succès. La somme récoltée permettra de professionnaliser la communication du projet. Dans le même temps, un certain nombre de contacts a été pris dans la perspectives de soutiens publics ou privés, financier ou non, permettant d’envisager avec confiance les prochaines étapes : la création et la structuration de la future SCIC.
Enfin, le dernier axe de structuration du projet durant ce deuxième semestre 2018 a concerné la cohésion du collectif. Celui-ci s’est d’abord étoffé de nouveaux membres, qui ont permis de diversifier et renforcer ses compétences. L’objectif est d’arriver le plus tôt possible à une vingtaine de membres engagés de manière pérenne et déterminée. Ensuite, les interactions entre les membres se sont développées. Cela a pu prendre la forme de collaborations, ponctuelles ou plus durables, au service de la résolution de problématiques des uns ou des autres. Cela est encore émergent, mais les promesses sont là. Autre point de satisfaction : la cohésion du groupe monte en puissance. Chacun connaît mieux l’autre et ressent l’effet positif de prendre part à un groupe qui partage les mêmes valeurs et engagements. Il est de plus en plus clair que chacun prend du goût à la rencontre avec l’autre. De plus, des projets communs commencent à émerger. Ceux-ci concernent pêle-mêle la création d’un pôle d’activités de la transition écologique à Nancy, la mise en route d’une halle commerciale dédiée à la transition, la commercialisation commune de prestations auprès des entreprises du territoire, l’organisation d’une exposition d’art contemporain, ou encore l’élaboration d’une dispositif de préincubation des entreprises de la transition, dans le cadre de l’Appel à projets de la Région Grand Est « Fabrique à projets d’utilité sociale ». Enfin, l’intégration de Kèpos dans son environnement socio-économique se conforte, dans la foulée de discussions fructueuses avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, ou encore le Plan B.
Bref, l’enthousiasme est là ! Nous tous, membres de ce projet, vous en souhaitons autant pour cette nouvelle année 2019 ! Puissions-nous tous être des acteurs engagés et joyeux au service des autres, du monde et de notre planète !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
Projets
6 septembre 2022Projets / Revues de ProjetsEn circulation depuis 2017, le Florain souffle sa cinquième bougie en 2022. Beaucoup de temps a passé depuis la première interview que nous avions dédiée à cette initiative. Le 8 octobre 2022, l’association fêtera dignement cet événement dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Nancy ! Cette date marquera aussi le lancement du Florain numérique, que chacun est invité à soutenir via un financement participatif. Pour parler de tout cela, nous rencontrons Virginie Hacquard, coordinatrice du projet et salariée de l’association.
Faisons connaissance : qui êtes-vous ? Comment en êtes-vous venu à participer au développement d’une monnaie locale ?
Salariée depuis juillet 2019, j’ai le rôle de coordinatrice au sein de l’association. Je suis pour le moment la seule salariée de la structure et j’occupe diverses missions avec l’appui d’autres bénévoles : la comptabilité, la participation aux groupes de travail et la mise en relation des bénévoles avec ces derniers, l’approvisionnement des comptoirs de change ou encore la gestion du stock de Florains. On peut dire que j’ai une vision globale de l’association. Avant de devenir salariée, j’ai eu connaissance du projet suite à une reconversion professionnelle qui m’a permis de découvrir le paysage associatif nancéien. Mes principales aspirations se sont tournées vers le mouvement climat avec les associations RAP Nancy, ANV COP21, Racines Carrées entre autres. C’est au bout de six mois d’aventure associative que je décide de postuler au Florain.
Quelles sont les principales évolutions vécues par le Florain depuis votre arrivée ?
Depuis mon arrivée il y a trois ans, j’ai pu assister et participer à de nombreux changements. Le réseau s’est très bien développé sur le territoire, touchant désormais tout le Sud de la Meurthe-et-Moselle, Lunéville ainsi que les côtes de Meuse. Nos partenaires se sont également multipliés : trois collectivités, les Villes de Nancy et Malzéville, et le Département de Meurthe-et-Moselle ont rejoint la monnaie. C’est une très bonne nouvelle pour nous et les habitants du territoire qui pourront payer dans un avenir proche les services publics en Florains.
De plus, notre projet de numérisation arrive enfin à terme cet automne, le 8 octobre 2022. Nous avions voté cette initiative lors de notre Assemblée Générale de 2020, ce qui représente plus de deux ans de travail. Derrière cet outil, nous avons pour objectif de toucher 1% des habitants du territoire, et de continuer à faire bouger les choses au plus près du terrain. Il nous permettra également de nous développer auprès des professionnels, et de rendre la circulation de la monnaie plus facile. En complément de toutes ces nouvelles activités, nous nous sommes rapprochés du mouvement SOL – réseau des monnaies locales complémentaires – à l’issue d’un appel à projets national. Nous avons candidaté et le résultat s’est révéler positif. En tant que lauréat, nous bénéficierons d’un accompagnement humain et financier sur trois ans.
Combien de Florains sont actuellement en circulation ? Chez combien de commerçants pouvons-nous les retrouver ?
Il existe à l’heure actuelle 82 monnaies locales en France, parmi lesquelles setrouve l’Eusko – monnaie du Pays basque – qui compte l’équivalent de plus de 3 millions d’euros en circulation. Début 2022, de notre côté, nous comptions 180 000 Florains en circulation sur le territoire Lorrain. Concernant les partenaires, nous en sommes à 206, de tous types : maraichers, boulangers, brasseurs, épiceries, petits commerçants, etc. Ils se regroupent autour de domaines d’activités très hétérogènes.”
Du point de vue interne, combien comptez-vous de bénévoles aujourd’hui ? Comment s’organise l’association ?
Nous comptons 25 bénévoles actifs, en légère augmentation ces derniers mois après l’organisation de plusieurs évènements sur la Metropole du Grand Nancy. La plupart viennent de milieux engagés liés aux mouvements écologiques et solidaires. Nous regrettons, cependant, de ne pas toucher plus d’étudiants car la moyenne d’âge est, pour le moment, au dessus de la trentaine.
Comment transformer ses euros en Florains ? Quelle est la démarche à suivre ? Ou pouvons-nous vous retrouver ?
Il faut être adhérent à l’association et se rendre dans un comptoir de change. Nous les avons répertoriés sur notre site internet. Pour rappel, un euro est égal à un Florain. Nous sommes par exemple tous les vendredis et tous les dimanches sur le marché de Vandoeuvre-lès-Nancy et le troisième vendredi du mois sur l’autre marché de Nancy près de l’Octroi. De manière ponctuelle, nous participons à différents évènements tels que “Jardins de Ville, Jardin de Vie”, qui se tiendra les 24 et 25 septembre prochain au domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange. Nous tenons notre site et nos réseaux sociaux à jour concernant les divers évènements sur lesquels nous avons l’opportunité d’avoir un stand.”
6. Quelles sont les perspectives à venir pour le projet ?
Plusieurs objectifs sont à relever ces prochaines années : un million de florains en circulation sur le territoire d’ici à 5 ans, embaucher une deuxième personne sur un poste de chargé de développement, travailler avec plus de collectivités, développer les groupes locaux et créer d’autres antennes de bénévoles sur des territoires autres que Nancy.
Alexandra Casas, Kepos [...]
27 juillet 2022Interviews Radio / ProjetsChloé Baduel met en lumière dans son émission radio les talents artistiques de Caroline Antoine, plasticienne et paysagiste membre de Kèpos. L’artiste a plusieurs cordes à son arc, que nous vous laissons découvrir dans cet interview réalisé dans l’émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy :
Vous pouvez retrouver ses œuvres, profondément inspirées par la poésie et le vivant, sur son site internet. Mais nous vous invitons également à découvrir son art le long des rives de Meurthe, dans le quartier des Grands Moulins à Nancy, en compagnie de la troupe artistique Melocoton. Notez dans votre agenda les prochains rendez-vous !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
6 juin 2022Interviews Radio / ProjetsAu tour de la SCIC Energéthic, de se rendre dans les studios de l’émission “Bio diversité” de Radio Caraib Nancy. Face au constat des limites et impacts des énergies fossiles, Dominique Isler, fondateur de la coopérative, a fait le choix de se tourner vers les énergies renouvelables. Retrouvez des exemples de projets réalisés et à venir dans l’interview accordé à Chloé Baduel, animatrice de l’émission :
Suivez de près l’actualité de la SCIC. Des conférences sont régulièrement données sur la Métropole du Grand Nancy.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
27 avril 2022Interviews Radio / ProjetsOphélie Benito, fondatrice de la SARL Mollis, spécialisée dans la conception et fabrication d’équipements bio-sourcés pour le soin des personnes fragiles, répondait aux questions de Chloé Baduel dans son émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy. Découvrez les engagements sociétaux de cette jeune entreprise du bassin nancéien :
Si cette nouvelle manière d’appréhender le soin des personnes vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’entreprise à l’adresse suivante : contact@mollis.fr. [...]
20 avril 2022Projets / Revues de ProjetsNous rencontrons aujourd’hui Chloé Lelarge, fondatrice de l’association Frugali, cabinet d’expertise en pratiques et alimentation durable. Elle revient sur la genèse du projet et ses missions en matière d’alimentation durable.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Chloé Lelarge, j’ai débuté mes études par une prépa littéraire et j’ai ensuite poursuivi en sciences sociales avec un master en géographie de l’Alimentation et des Cultures Alimentaires à La Sorbonne. Mes études m’ont permis d’acquérir une vision globale des pratiques alimentaires. Après l’obtention de mon diplôme, j’ai travaillé pour la restauration collective sur les questions d’alimentation durable en Ile-de-France. C’est à mon retour à Nancy, à la fin de mon contrat, que se développe ma prise de conscience écologique. Je participe à des événements autour du Zéro Déchet et c’est à ce moment que je rencontre Anais Streit.
Anais est formée en neurosciences et gestion de projets, nous comprenons rapidement que nos profils se complètent. Notre objectif, celui de relier nos convictions écologiques et compétences professionnelles dans le but de faire évoluer les pratiques en entreprise sur les questions alimentaires, se dessine doucement. C’est grâce à La Serre à Projets que le projet est officiellement lancé. Lauréates de la première promotion en 2020, le dispositif nous a permis de nous structurer et envisager la suite avec plus de clarté. Pendant un an, nous avons porté Frugali à bout de bras, moi en salariat à temps plein, Anaïs bénévole à mi-temps. Aujourd’hui Anais m’a rejoint à temps plein.
Qu’est-ce que Frugali ?
Les missions de Frugali sont multiples : nous proposons, d’une part, notre offre de formations aux organisations sur la Transition Ecologique et Alimentaire tout en les accompagnant vers une transformation de l’existant. Nous construisons des programmes de formations afin d’introduire des concepts et modes d’innovation frugaux au sein des entreprises. Ces formations ont pour objectif de développer les compétences professionnelles et ainsi faire le lien avec des pratiques responsables au sens culturel, écologique et social. Nous accompagnons les entreprises dans leur structuration interne ainsi qu’au diagnostic de leur activité.
Nous intervenons pour le moment auprès de collectivités et nous déployons actuellement des offres avec les mutuelles mais également de grands groupes engagés sur les questions de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et de transition. Nous sommes déjà référencés sur des plateformes de formations, ce qui nous permet d’être sollicitées par des organisations en France Métropolitaine.
Comment en êtes-vous arrivée à imaginer cette nouvelle activité professionnelle ?
La création de Frugali est un mélange entre coup de chance et opportunités. A l’époque, Kèpos avait réalisé un sondage sur les activités manquantes du Grand Nancy. Ayant déjà le projet en tête, j’ai pu à plusieurs reprises en discuter avec Emmanuel Paul, fondateur de Kèpos, pour réaliser un diagnostic de territoire. Ce dernier révélait le manque d’un acteur qualifié en matière d’alimentation durable et porteur d’une offre de formation sur le bassin nancéen. Nous avons, par conséquent, profité de cette opportunité pour déposer un dossier de candidature à La Serre à Projets.
En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?
Comme je l’évoquais un peu plus haut, le projet Frugali comporte différentes strates :
Une première qui représente le noyau dur de notre activité : un travail de lobbying auprès des organisations privées, publiques et associatives sur la modification de leurs pratiques.La deuxième réside dans le changement du fonctionnement et pratiques professionnelles via un travail de sensibilisation et formation.
Nous avons à cœur de ne jamais juger les structures que nous accompagnons et travaillons avec bienveillance pour comprendre les besoins de nos clients. Plus le dialogue sera fluide, plus les organisations seront disposées à mettre en place les nouvelles pratiques responsables que nous leur conseillerons.
Comment envisagez-vous la suite de l’aventure ?
Nous travaillons, en 2022, à rechercher l’équilibre économique, tout en pensant à l’intégration en salariat d’Anaïs.
A moyen et long terme, nous aimerions élargir nos partenariats et pouvoir créer des permanences juridiques dédiées aux salariés sur la transition alimentaire au sein des entreprises.
En ce qui concerne nos engagements chez Kèpos, nous participons à la construction d’un PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique) sur le territoire du Grand Nancy. Parmi les différents groupes de travail, nous avons fait le choix de rejoindre celui dédié à la RSE.
Merci ! [...]
6 avril 2022Interviews Radio / ProjetsL’émission “Bio diversité“, animée par Chloé Baduel sur Radio Caraib Nancy, accueille Fabien Potiez, coordinateur de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Fibricoop. L’occasion de revenir sur le changement de statut de l’association, qui œuvre à la récupération de déchets textiles industriels pour leur offrir une seconde vie.
Si vous êtes à la recherche de sacs résistants issus de l’économie circulaire, n’hésitez pas à contacter Fibricoop via son site internet ! [...]
22 mars 2022Projets / Revues de ProjetsA l’occasion du changement d’échelle de plusieurs membres du Jardin d’Entreprises, au capital desquels la CIGALES Mirabelle a pris des parts, Samuel Colin, qui est également salarié de Kèpos, nous explique le fonctionnement de ces clubs d’investisseurs engagés dans la transition écologique. A noter qu’il est d’ailleurs partie prenante dans l’association régionale des CIGALES du Grand Est.
Faisons connaissance : qui êtes-vous ? Comment en êtes-vous venu à participer à une CIGALES ?
Je suis impliqué de longue date dans différents projets en lien avec la transition écologique (création d’une AMAP, mouvements associatifs de protection de l’environnement). Par ailleurs, mes études en école de commerce m’ont permis de me former à la gestion financière. Au delà de la vision promue par ces écoles, j’ai peu à peu découvert les impacts négatifs majeurs de la finance sur l’environnement. En d’autres termes, mon épargne placée dans une banque “traditionnelle” pouvait servir, à mon insu, à financer des projets particulièrement polluants, tels que l’extraction d’énergies fossiles, la fabrication d’armes, etc. Peu de temps après cette prise de conscience, j’entends parler du mouvement des CIGALES dans un article de l’Est Républicain. J’assiste à une réunion d’information organisée à la MJC Bazin de Nancy et j’y rencontre les futures personnes avec qui la CIGALES Mirabelle sera créée !
Pouvez-vous nous présenter l’association des CIGALES du Grand Est ?
Par définition, une CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) est un regroupement de particuliers mettant en commun une partie de leur épargne pour financer des entreprises qui se lancent ou se développent. Chaque CIGALES est composée de 5 à 20 personnes. Ces dernières interviennent, la plupart du temps, en prenant des parts dans les entreprises ou en réalisant des prêts quand la prise de parts n’est pas possible. On compte aujourd’hui 13 CIGALES actives en Grand Est.
Notre association régionale les fédère et a pour principales missions :
D’accompagner les CIGALES locales.De faire vivre le mouvement en interne.D’élargir le mouvement en favorisant la création de nouvelles CIGALES et en recrutant de nouvelles personnes.
En ce qui concerne le département de Meurthe-et-Moselle, nous comptons actuellement 5 CIGALES en activité.
Comment rejoindre une CIGALES ?
Sur ce point, chaque CIGALES est autonome et fixe ses règles. La meilleure façon de se lancer est de créer sa propre CIGALES. Prenons l’exemple de la CIGALES « Coup de pousse », initiée par Laure Hammerer, également salariée chez Kèpos, et Franck Magot, qui avait lui même été financé par deux CIGALES au lancement du projet “Les Fermiers d’Ici“. Voici ce que dit Franck :
“A la création de l’entreprise, j’ai ouvert le capital à deux clubs d’investisseurs (des CIGALES) et une personne physique. C’est sûrement le choix dont je suis le plus satisfait. Cela me permet d’échanger avec eux, de prendre du recul et de progresser. Sans ce partage, l’entreprise n’en serait pas là où elle en est en ce moment.“
Si cette idée vous tente, le premier pas à réaliser est de contacter l’association régionale pour qu’elle vous donne toutes les clés et vous accompagne à la création d’une CIGALES. Les étapes sont globalement simple, et en un rien de temps le projet sera lancé !
Quels sont ses champs d’action et en quoi le projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ? A quels types de projets a déjà participé la CIGALES Mirabelle ?
L’objectif d’une CIGALES est d’aider à faire naître sur un territoire des projets qui auraient plus de mal à émerger sinon. Les CIGALES favorisent et interviennent dans le champ plus général de l’Economie Sociale et Solidaire en apportant de l’argent « frais » au capital des structures. Les CIGALES défendent dans leurs investissement les valeurs de la Charte des CIGALES. Chaque club choisi, de façon indépendante, ses valeurs principales, qu’elles soient écologiques, sociales ou culturelles. Dans la CIGALES Mirabelle, nous sommes très attachés aux questions écologiques. Nous accompagnons actuellement pas moins de 13 projets différents, dont plusieurs font partie du Jardin d’Entreprises de Kèpos : Les Fermiers d’Ici, Mollis, Energéthic, le restaurant-coopératif Arlevie, la brasserie de bières biologiques et artisanales La Grenaille, l’épicerie Court-Circuit, Fibricoop, Vêt Ethic, la Grande Epicerie Générale (GEG) ou encore l’épicerie animée PAMBio à Pont-à-Mousson…
Au delà de l’apport financier, les cigaliers peuvent participer, si la structure le souhaite, aux réunions stratégiques et grandes réflexions sur l’avenir de l’entreprise. La CIGALES sert également de relais de communication, favorise la mise en réseau et soutient le porteur de projet lorsqu’il en a besoin.
Quelles sont les limites de ce type d’initiative ?
Le mouvement des CIGALES est nécessaire mais ne sera jamais suffisant pour financer la transition écologique. Il doit s’accompagner d’établissements financiers éthiques tels que la Nef et du changement de pratiques des banques conventionnelles. Toutefois, les CIGALES représentent un outil intéressant pour la finance au service d’une économie concrète, de proximité, réellement écologique et solidaire.
Comment envisagez-vous la suite de l’aventure CIGALES ?
La durée de vie légale d’une CIGALES est de 5 ans. Au bout de ces 5 ans, les CIGALES doivent décider si elles souhaitent se renouveler ou non. De notre côté, la dynamique est bonne chez Mirabelle et nous aimerions que le projet continue encore sur de nombreuses années. En ce qui concerne l’échelle régionale, j’aimerais que la dynamique de nouvelles créations de CIGALES accélère et qu’à terme les CIGALES se réunissent pour financer des projets à plus grande échelle !
Merci !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
23 février 2022Actualités / Interviews Radio / ProjetsEn compagnie de Chloé Baduel, animatrice de l’émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy, Chloé Lelarge, fondatrice du cabinet de conseil et de formation Frugali, est revenue sur les origines du projet, son champ d’actions mais également les perspectives qui se profilent pour l’année 2022.
Retrouvez son intervention ci-dessous :
Si la transition de votre entreprise vers des pratiques plus responsables vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Frugali via son site internet.
Alexandra Casas de Kèpos [...]
14 février 2022Actualités / Projets / Revues de ProjetsL’agence de communication responsable Comm’ un avenir soufflait sa première bougie le 4 janvier dernier, à cette occasion, nous avons posé quelques questions à sa fondatrice, Anne-Sophie Gall, sur son parcours et les perspectives du projet.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Anne-Sophie Gall et j’ai débuté mon parcours en communication par un DUT Communication des Organisations à l’IUT Charlemagne à Nancy. J’ai ensuite poursuivi en Master Stratégie et Conseil en Communication à la Faculté de Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Lorraine. Ma passion pour le chant et le secteur musical me destinait plutôt à travailler dans cette voie, mais ma progressive prise de conscience des enjeux environnementaux m’a amenée à repenser mes projets professionnels. C’est en 2018 que je commence à m’engager dans diverses associations écologiques, en particulier Greenpeace et La Cantoche. Le besoin de retrouver du sens dans ma vie professionnelle me pousse à quitter mon poste de Chargée de communication à la Ville de Ludres. L’idée de créer un projet en lien avec la transition écologique m’apparaît désormais comme une évidence. Après quelques mois de réflexion, je décide de me lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat en proposant mes compétences en communication aux structures engagées située dans la Métropole du Grand Nancy.
Qu’est-ce que Comm’ un avenir ?
L’objectif premier de ce projet réside dans le soutien que j’apporte aux initiatives vertueuses de mon territoire. Les associations et petites structures souffrent souvent d’un manque de visibilité et de ressources humaines ou matérielles en terme de communication. En les aidant dans leur communication, les structures auront la possibilité de toucher un plus large public et de démocratiser les problématiques d’enjeux climatiques et sociétaux.
En ce qui concerne, le terme « Agence », je suis consciente que ce dernier est connoté. Cependant, Comm’ un Avenir relève d’une réelle alternative aux agences de communication classiques. Ce terme permet de rassembler, en un seul mot, les différents champs d’action sur lesquels je peux intervenir : gestion des réseaux sociaux, communication print, identité visuelle, éco-conception, relations presse mais également la réalisation de plans de communication.
Je travaille pour le moment seule pour différentes structures, telles que day by day, Décor’Jardin, les Fermiers d’ici ou la coopérative anti-gaspi Arlevie. Grâce à la mise en réseau de Kèpos, j’ai également pu œuvrer à la communication de Fibricoop, coopérative de réemploi de textiles usagés issus de blanchisseries industrielles.
Comment en êtes-vous arrivée à imaginer cette nouvelle activité professionnelle ?
Cette idée d’agence responsable vient de mes engagements associatifs. Le manque de moyens en interne, qu’ils soient d’ordre humain, communicationnel ou financier, m’a poussé à créer ma propre entreprise au service de l’intérêt général. Bien qu’il existe une dissonance entre la communication et la transition écologique : l’un agit plutôt dans une vision court-termiste, tandis que le second s’inscrit dans le long terme, j’ai décidé de m’intéresser aux alternatives de la communication responsable. Cette dernière se démarque des messages poussant à la surconsommation ou la production de supports très énergivores. Chacune de mes missions est donc pensée de manière à limiter ses impacts : utilisation de logiciels open source, choix de supports écolabellisés et prestataires engagés, diffusion de messages clairs et transparents en accord avec les objectifs de développement durable, etc.
En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?
Le projet Comm’ un avenir contribue à la transition du territoire nancéien en soutenant des initiatives écologiques et sociales en faveur d’une meilleure intégration du territoire dans les enjeux de demain. Véhiculer des messages de sobriété me tient particulièrement à cœur, la transmission de connaissances est un levier indispensable à la sensibilisation à l’écologie des générations actuelles et futures. C’est pourquoi j’interviens également dans le cadre de la Licence Information et Communication de la Faculté de Lettres de Nancy, afin de partager mes expériences et montrer qu’une synergie entre écologie et communication est possible.
Consciente du manque en interne des associations, je propose un tarif solidaire et engagé de -20 % sur l’ensemble des services proposés. Bien qu’au départ Comm’ un avenir se destinait à la communication des associations, celle-ci s’oriente aujourd’hui vers tout type d’acteur de l’ESS portant des valeurs fortes et se donnant les moyens de les appliquer.
Comment envisagez-vous la suite de l’aventure ?
J’envisage la suite de l’agence à plusieurs. En effet, les propositions de contrats et la charge de travail s’accumulant, il devient de plus en plus difficile de travailler seule. Les demandes se multipliant, le projet tend également à élargir sa zone d’activité à la région Grand Est. J’aimerais, d’autre part, aller plus loin dans la réflexion et la réalisation des supports de communication responsable en creusant tous les aspects de l’éco-responsabilité et renforçant mes liens avec les structures engagées du territoire.
Merci !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
1 février 2022Interviews Radio / ProjetsChloé Baduel, animatrice de l’émission « Bio diversité » sur Radio Caraib Nancy, fait intervenir chaque mois des membres du Jardin d’entreprises de Kèpos et des Lauréats de la Serre à Projets.
Retrouvez aujourd’hui le restaurant-associatif La Cantoche en compagnie d’Arnaud Maujean, membre du Conseil d’Administration et Isabelle Dollander coordinatrice salariée de l’association. Son objectif : lutter contre le réchauffement climatique en sensibilisant à une alimentation saine et durable !
Retrouvez leur intervention ci-dessous :
Alexandra Casas de Kèpos [...]
18 janvier 2022Interviews Radio / ProjetsDans le cadre de notre partenariat avec Radio Caraib Nancy, Chloé, l’animatrice de l’émission « Bio diversité », intervient sur des sujets liés à la transition écologique.
C’est au tour, cette fois-ci, de Day by Day : première épicerie 100% vrac gérée par Cécilia Gana au Faubourg des trois Maisons, à Nancy. Son mot d’ordre : moins d’emballage, moins de gaspillage et plus d’économies !
Retrouvez ci-dessous l’interview de Cécilia :
Alexandra Casas de Kèpos [...]
4 janvier 2022Interviews Radio / ProjetsDans le cadre de notre partenariat avec Radio Caraib Nancy, Chloé, l’animatrice de l’émission « Bio diversité », intervient sur des sujets liés à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’environnement.
La recyclerie La Benne Idée, située à Jarville-la-Malgrange, s’est prêtée au jeu en retraçant les origines et le développement de cette association de réemploi spécialisée dans les objets de l’habitat : meubles, décoration, vaisselle et bricolage
Retrouvez l’interview d’Antoine Plantier, co-fondateur du projet :
Alexandra Casas de Kèpos [...]
20 décembre 2021Projets / Revues de ProjetsA l’occasion de la transformation de l’association Fibricoop en coopérative, nous avons interviewé Fabien Potiez, coordinateur de ce projet de valorisation des déchets textiles !
Qu’est-ce que Fibricoop ?
C’est une coopérative qui collecte et transforme le textile au rebut qui provient de blanchisseries industrielles. Nous créons des sacs avec différents types de textile : vêtements de travail colorés et linge plat blanc. En ce qui concerne notre gamme, nous commercialisons pour le moment des totes bags. Des cabas, sacs à langer, trousses d’école et de toilette, sacoches à vélo et des sacs à bières verront bientôt le jour ! On peut en faire des choses avec des anciens vêtements de travail ! Notre stock de matières premières va devenir plus conséquent dans les mois à venir : nous allons travailler avec des chiffonniers, prestataires de notre blanchisserie partenaire, ce qui nous permettra d’étendre notre gamme et répondre à la demande.
En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?
Parce que c’est un projet 100% local et très peu énergivore avec un impact environnemental positif : les vêtements sont réutilisés par Fibricoop au lieu de partir à la poubelle. Nous les transformons très peu, nous avons seulement besoin d’un peu de découpage pour créer les produits finaux, et cela sans aucun traitement chimique contrairement à ce qu’il est courant de voir dans l’industrie du textile. D’autre part, nous travaillons exclusivement avec des partenaires de la région : APF Entreprise pour l’atelier de couture, les produits sont floqués à Laxou, les vêtements viennent d’une blanchisserie à Malzéville et la collecte et l’acheminement du textile pourrait bien être réalisé prochainement en vélo cargo par la coopérative Les Coursiers Nancéiens ! Cette rencontre a d’ailleurs été organisée par Kèpos, nous vous remercions ! Le fait d’être passé d’une association à une SCIC renforce notre impact positif sur le territoire, puisque nous avons la garantie que le projet sera non-délocalisable et d’utilité sociale pour les habitants.
Pourquoi être passé du statut d’association à celui de coopérative ?
Notre projet a une visée commerciale et une production semi-industrielle, ce que ne permet pas le statut associatif. Maintenant pourquoi une SCIC ? Parce que nous voulons que chaque partenaire ait un intérêt à nous suivre, faire en sorte que toutes ces entreprises travaillent avec nous et ne soient pas en concurrence. Le projet de se transformer en SCIC nous est apparu évident parce que nous répondons à un besoin d’utilité sociale et notre projet fait partie intégrante de l’Économie Sociale et Solidaire. Les principes d’une SCIC sont les suivants : contribuer à l’impact positif d’un territoire, engager toutes les parties prenantes de la coopérative, créer un projet non délocalisable, et n’être rentable que dans l’objectif de pouvoir réinvestir en retour dans le projet. A l’inverse du système capitaliste, la prise de part au capital ne permet pas de s’enrichir ou de prendre possession de l’entreprise !
Comment se déroule le lancement de la souscription au capital ? Quels sont les retours ? Combien de sociétaires avez-vous actuellement ?
Tout se passe plutôt bien, plusieurs entreprises ont pris des parts mais pas encore de collectivités pour le moment. Nous visons les 15 000 euros avant la fin d’année. Nous comptons parmi nos sociétaires : la société COMPAS, l’épicerie de vrac Court-Circuit, APF entreprise, différents membres du Jardin d’entreprises de Kèpos, mais aussi de nombreux particuliers. La SCIC sera effective dès le 1er Janvier 2022. Il reste possible de prendre des parts tout au long de la vie de la coopérative.
Comment envisagez-vous la suite de l’aventure ? Si tout se passe bien, comment vous voyez-vous dans 5 ans ?
Si tout se passe pour le mieux, nous aimerions multiplier les produits et élargir notre gamme. Nous pourrons, par conséquent, proposer un catalogue fourni à toutes les entreprises que nous irons démarcher. Du point de vue des Ressources Humaines, nous souhaitons recruter un designer textile sur une durée indéterminée et pourquoi pas des apprentis dans les deux années à venir. A terme, l’idéal serait d’essaimer le projet sur d’autres territoires. APF a des ateliers de couture un peu partout en France, tandis qu’il y a également des blanchisseries industrielles dans tout le pays, ce qui nous laisse donc la possibilité de dupliquer notre projet.
Retrouvez toutes les actualités de Fibricoop ici et n’hésitez pas à contribuer au lancement de sa coopérative !
Alexandra Casas de Kèpos [...]
2 septembre 2021Projets / Revues de ProjetsA l’occasion du lancement de son financement participatif, la Benne Idée, nouvelle recyclerie créative sur la Métropole du Grand Nancy membre de Kèpos, répond à quelques unes de nos questions !
La Benne Idée, c’est quoi ? C’est qui ?
La Benne Idée c’est toi, c’est elle, c’est lui, c’est moi, c’est tout ceux qui veulent contribuer à diminuer la prolifération des déchets, et le faire de manière solidaire. Concrètement c’est une association qui collecte, valorise et vend à prix solidaires les objets de l’habitat (mobilier, bibelots, vaisselles, bricolage, …). L’association fonctionne grâce à l’implication de bénévoles, de réseaux partenaires (Le Plan B, le Florain, Kepos, le Réseau National des Ressourceries), et de son premier salarié !!
En quoi est-ce que votre projet contribue à la transition écologique et sociale du territoire ?
Nous y contribuons, modestement, en donnant une deuxième vie à des objets destinés à être jetés. Cela présente deux avantages: éviter la production d’un nouvel objet, et éviter la production d’un déchet. La recyclerie a également un impact social puisque nous vendons à prix solidaire. Cela permet aux personnes en difficultés de s’équiper. Nous allons également mettre en place un atelier chantier insertion, et ainsi créer des emplois pour sept personnes d’ici la fin d’année. Enfin en communiquant, en faisant des ateliers, on contribue à changer les modes de consommation.
Vous aviez été interviewés il y a un an environ, quand vous intégriez la Serre à Projet. Que s’est-il passé depuis ?
Aahhhh, ça semble loin maintenant !!! Beaucoup de sueur a coulé sous les ponts depuis. On a finalisé notre étude de faisabilité et elle a été validée par l’ensemble des partenaires du projets. Ca nous a permis de commencer l’activité collecte et rénovation en test dans la grande halle de l’Octroi. Grace à la mairie de Jarville, on s’est aussi installés dans un grand local au 16 avenue de la Malgrange. Ca nous a pris pas mal de temps de le nettoyer et le mettre en état avec des aménagement sommaires avant l’été. Depuis cet été on a commencé les ventes à prix solidaires via le site internet. Enfin, on assure maintenant des permanences les mercredi (10h-17h) et samedis (10h-13h). C’est top, on voit plein de monde qui à la fois apporte des objets et en achète. On reçoit plein de soutien, ca fait plaisir de voir qu’on rend service. L’activité créative démarre petit à petit, on va renouveler un partenariat avec l’Ecole de Design (ENSAD) et ainsi accueillir un groupe d’étudiants qui va développer des projets pendant un an. On a également démarré un projet avec l’atelier de tapisserie DM pour la valorisation d’éléments d’assise.
Quelle progression ! Si tout se passe comme dans un rêve, à quoi ressemblera la Benne Idée dans 5 ans ?
Dans un rêve, on n’existerait plus parce qu’il y aurait plus de déchets à collecter et plus personne en difficulté. Mais bon, on y croit pas, donc on va se contenter d’une version réaliste: dans 5 ans on sera toujours à Jarville, dans un beau local intégré à la futur cité des métiers d’art, avec une chouette équipe de bénévoles et des anciens salariés en insertion qui viennent nous rendre visite pendant la pause de leur nouveau boulot. L’activité créative se sera bien développée et on pourra proposer des objets créatifs en partenariat avec des artisans locaux qui se vendront en Florains 😉
Vous avez lancé une campagne de financement participatif qui prend fin le 30 septembre. A quoi va vous servir l’argent collecté ?
L‘argent collecté va nous servir à acquérir un camion, lequel nous permettra d’effectuer des collectes, de participer à des évènements, et exceptionnellement effectuer des livraisons. Pour nous c’est une première cette campagne. Elle part très bien, et au delà du montant, ça donne vraiment un gros coup de boost de recevoir autant de soutien. On se dit que le projet a vraiment du sens et qu’il est bien accueilli.
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ces questions, avez-vous un mot de la fin ?
On va vous souhaiter une très Benne journée 🙂
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
16 décembre 2020Projets / Revues de ProjetsLaurie Targa est l’initiatrice du Laboratoire sauvage, association spécialisée dans la promotion des sciences participatives. Elle nous explique ce que cette expression revêt, et les missions de l’association.
Qui êtes-vous et comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux sciences participatives ?
Je m’appelle Laurie Targa. J’ai terminé un doctorat en biologie cellulaire il y a un an. Au cours de ce travail, j’ai pu faire des formations qui m’ont fait découvrir la médiation scientifique, la zététique, les problématiques d’intégrité scientifique ou encore l’entrepreneuriat.
J’ai été intéressée par de nombreuses ressources invitant à prendre du recul sur les pratiques de recherche, mais il y a un tel écart entre les recommandations que l’on trouve, et la réalité de ce que l’on fait lorsqu’on s’insère dans un grand système déjà lancé, que cela m’a amené à imaginer d’autres moyens de permettre à ces nouvelles pratiques de trouver leur place. J’ai aussi pris conscience que le temps humain était plus précieux et rare que les investissements financiers.
Je suis par ailleurs engagée dans le milieu associatif depuis plusieurs années. J’ai réalisé progressivement qu’il était possible de faire de plus en plus de choses dans des cadres différents avec des valeurs qui pouvaient mieux me correspondre. C’est aussi pour cela que j’ai rejoint Kèpos dès ses débuts. Les sciences participatives se sont alors présentées comme le meilleur compromis pour rendre possible une recherche engagée au sein de la société civile. Après avoir lancé plusieurs projets, je me concentre maintenant sur le développement de l’association Laboratoire Sauvage.
Qu’est-ce que les sciences participatives exactement ?
Les sciences participatives regroupent les projets de recherche qui bénéficient de la participation active de citoyens qui ne sont pas chercheurs de métier, dans au moins une des étapes du projet. Cela se distingue de la sensibilisation, de la vulgarisation ou de la médiation. Nous apprenons les uns des autres en avançant ensemble sur des projets qui nous rassemblent. Il y a de nombreuses façons de participer, tout dépend du projet en question et de l’implication que l’on y met. Cela peut aller d’une co-construction dès la définition du problème à traiter, à une participation qui ne prendra que quelques minutes au cours d’une expédition pour la collecte de données par exemple.
Une des étapes clé est la définition de la question que l’on se pose :
La question peut venir de chercheurs et les citoyens sont sollicités pour soutenir l’effort de recherche.Il est aussi possible que les citoyens sollicitent les chercheurs pour travailler sur un sujet qui les préoccupent et qui n’est pas déjà traité. C’est dans ce cas qu’une réelle dynamique de co-construction est possible. Les sciences participatives sont d’ailleurs vues par les Français comme un moyen de renforcer les liens entre le grand public et la recherche (selon un sondage Ipsos de 2016).
A l’occasion de la crise du Covid, on sent dans la société une forte défiance vis à vis de la science. En quoi les sciences participatives sont une réponse à cela ?
Malgré la crise, la majorité des Français garde une certaine confiance en la science, même s’il semble que la proportion d’individus plus méfiants ait légèrement progressé (cf Baromètre Science et Société – Vague #1Ipsos 2020). La défiance semble plus forte quand la science est mêlée à la politique. Le souci peut aussi être qu’elle est considérée comme difficilement accessible et élitiste. Les sciences participatives, en favorisant l’implication des citoyens à différents niveaux dans des projets de recherche, pourraient permettre de démystifier la démarche scientifique en s’y exposant, en la pratiquant soi-même.
La méthode scientifique n’est pas infaillible, mais elle s’est révélée très puissante pour innover. Elle permet d’arriver au niveau de précision et de nuance nécessaires à certaines réalisations. Alors comment se l’approprier ? C’est un vaste sujet, mais l’éducation à l’esprit critique, à l’analyse de l’information ne me semblent pas suffisantes en l’état actuel. Les projets de sciences participatives me paraissent ainsi de bonnes occasions d’utiliser des ressources scientifiques pour ouvrir de nouveaux horizons et rendre la démarche plus désirable.
Avec le Laboratoire Sauvage, nous utilisons les sciences participatives en mettant la priorité sur ce que peuvent en retirer les participants. Nous acceptons de prendre le temps nécessaire, le temps de partager, d’expliquer, d’apprendre les uns des autres, de faire rigoureusement, d’apprécier une activité stimulant notre curiosité et notre émerveillement. Cet investissement nous semble nécessaire pour de meilleurs résultats à long terme.
Quel est l’intérêt de cette pratique scientifique dans la perspective de la transition écologique ?
Dans transition écologique, on retrouve la notion d’écologie. Pour moi c’est d’abord une science riche et complexe qui a beaucoup à nous apporter. Cette science peut parfois pâtir de son association avec l’écologie politique et le militantisme, alors que des efforts de recherche rigoureux depuis de nombreuses années amènent à des résultats forts qui restent encore trop méconnus.
Le problème que j’y vois c’est que, même si l’on a de bonnes intentions, le manque de méthode augmente le risque de faire fausse route, et surtout de ne pas s’en rendre compte. Pour bâtir des actions plus solides pour permettre la transition écologique, il me semble nécessaire d’équiper le plus grand nombre avec des outils assez puissants, comme la démarche scientifique, pour nous attaquer à des problèmes aussi complexes.
La pratique des sciences participatives permet à la fois :
d’amener à mieux prendre en compte les travaux déjà réalisés, mieux intégrer les résultats de la recherche et mieux appréhender les enjeux,de tisser des liens entre recherche et société, de sortir d’une approche descendante pour aller vers la co-construction,de sortir des idées reçues qui sont nombreuses en matière de transition écologique,d’apporter de nouveaux savoirs, mesurer l’impact de nos actions, identifier les actions les plus pertinentes à mettre en place,de tirer de meilleurs fruits de nos expériences, de moins perdre d’informations et améliorer son partage,de devenir acteur de la production de savoirs et de la manière dont ces savoir sont utilisés,de mieux répondre aux besoins locaux.
De nombreux projets de sciences participatives proposent déjà des outils accessibles pour suivre des questions en lien avec la transition écologique, par exemple sur le suivi de la biodiversité, de la qualité de l’air, de l’eau. Malgré leur vocation à toucher le plus grand nombre, ils sont eux aussi encore peu connus.
Dans ce contexte, quelles sont les missions et les ambitions du Laboratoire Sauvage ?
La mission première de l’association est d’amener une diversité de personnes à s’intéresser aux sciences participatives et à y contribuer. Pour cela, l’association compte créer des groupes d’échange et multiplier les rencontres conviviales. Nous proposons par exemple des ateliers de découverte chaque semaine. Ces ateliers sont l’occasion de se rendre compte de la diversité des projets existants que chacun peut rejoindre. Pour certains projets, il est possible de contribuer depuis chez soi en réalisant des tâches comme la résolution de puzzles, le classement d’images, l’analyse de textes. Nous organisons aussi des sorties. Un exemple d’action en extérieur est de réaliser des observations d’animaux, de végétaux, du paysage, en suivant des protocoles simples au choix parmi de nombreux programmes bien rodés que nous présenterons. Ce type d’activité nous permet de redécouvrir notre environnement, de faire des suivis, des comparaisons localement, tout en contribuant à un projet de plus grande échelle où seront rassemblées les observations de milliers de participants. Ces approches sont particulièrement importantes en écologie.
En accompagnant divers publics à contribuer sur ces exemples de projets, notre intention est de rendre les travaux scientifiques plus familiers, de les démystifier. Nous tentons aussi au cours de l’atelier d’expliciter la démarche scientifique et l’intérêt de se l’approprier. Nous proposons ces rencontres actuellement dans le secteur de Vandoeuvre à la Médiathèque et à la MJC Centre Social Nomade, mais nous souhaitons étendre notre champ d’action dans tout le Grand Est. Il est aussi prévu d’investir les FabLabs locaux pour y construire du matériel pour faire des expériences, comme des capteurs pour mesurer la qualité de l’air. Il existe également un laboratoire ouvert tout équipé pour des analyses chimiques et biologiques à Champenoux, nommé « Tous Chercheurs », avec lequel nous souhaitons créer des liens.
Nous accordons une attention particulière à adapter ce que l’association propose aux besoins des personnes intéressées par la démarche, que ce soit au niveau de la thématique, du lieu ou de l’horaire (cf questionnaire cité à la fin de cet entretien).
L’association anime aussi une communauté de pratiques, qui souhaite partager ses compétences pour rendre plus efficaces les projets utilisant les démarches scientifiques et participatives. Nous souhaitons aussi accompagner la création de nouveaux projets. L’association développe d’ailleurs aussi elle-même certains projets portés par ses membres. Ils concernent actuellement principalement l’alimentation et la biodiversité.
Plus globalement, l’association a pour ambition d’accroître la capacité d’agir des participants, par leur implication mais aussi par les savoirs produits. Pour permettre à plus de monde de faire de la recherche autrement, nous poussons également à l’émergence d’un nouveau modèle économique en développant des emplois atypiques de « chercheurs animateur ». L’idée avec le Laboratoire Sauvage, ce n’est pas d’entrer dans la course effrénée à la collecte de données, aux publications à multiplier, à l’innovation creuse. C’est justement de prendre le temps de faire ensemble, de se poser plus de questions, et surtout donner envie d’imaginer, d’investiguer, d’expérimenter et de partager.
Quel peut être l’apport de vos activités pour des acteurs comme des entreprises, des associations ou des collectivités ?
Le Laboratoire Sauvage souhaite faire mieux connaître les sciences participatives aux collectivités, entreprises et association et les encourager à les développer. Nous souhaitons également soutenir des projets de recherche déjà en place. Nous proposons ainsi un accompagnement à la carte pour :
analyser les informations disponibles,concevoir des protocoles,conduire des expériences et des analyses,aider dans la prise de décision,et surtout intégrer les citoyens.
Nous proposons des ateliers qui peuvent être organisés selon les besoins de la structure demandeuse. Nous comptons aussi développer des formations pour permettre à d’autres structures de déployer des activités autour des sciences participatives.
Pour aller plus loin, nous proposons un questionnaire pour mieux cibler les besoins des particuliers intéressés. Nous vous invitons à le compléter.
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
16 novembre 2020Projets / Revues de ProjetsRendre les nouvelles technologies accessibles à tous, et ce de manière écoresponsable. Telle est l’ambition de SOS Futur, société de services informatiques basée à Nancy et membre de Kèpos. Pour en parler, nous vous proposons une rencontre avec Martin Thiriau, son dirigeant et fondateur.
Qui êtes-vous ?
Je suis Martin Thiriau, cofondateur de SOS Futur. Diplômé de l’ICN Business School et de l’École des Mines de Nancy, j’ai souhaité dès ma sortie d’école réduire la fracture numérique et aider ceux qui ont le plus de mal avec les nouvelles technologies. En effet, très attiré par les nouvelles technologies dès mon plus jeune âge, j’ai très vite remarqué que l’évolution fulgurante de celles-ci allait poser beaucoup de problèmes à de nombreuses personnes. Au début très éloigné des questions environnementales et énergétiques liées à ces technologies, je suis maintenant pleinement conscient de ces problématiques et m’efforce de concilier le numérique avec l’éthique et l’utilisation écoresponsable.
Pouvez-vous nous raconter l’histoire de SOS Futur ?
SOS Futur est né officiellement en juillet 2016, notamment grâce à des structures comme l’École des Mines et le PeeL (Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine). Au début nous étions deux et tournés essentiellement sur de l’assistance à distance et un peu de développement logiciel, depuis un petit bureau à l’École des Mines. Nous avons progressivement agrandi notre champ d’action avec de la réparation en atelier et de l’intervention à domicile. Les locaux devenant trop petits et trop compliqués d’accès, nous avons déménagé là où nous sommes encore actuellement, dans le quartier des III maisons à Nancy. C’est à partir de là que nous avons véritablement enclenché la croissance et la diversification de notre activité: assistance, réparation, vente, location, formation, infogérance, gestion de parc informatique, fournisseur d’accès internet et télécoms, éditeur de logiciel web (type CRM, logiciel de caisse, gestion de caméras de sécurité…), hébergement de serveurs et de solutions informatiques, développement web et logiciels et dernier né, un studio photo/vidéo avec prestation d’enregistrement et de diffusion en direct audio/vidéo d’évènements et de conférences. Nous sommes maintenant 8 personnes.
Comment définissez-vous la mission de SOS Futur ?
Depuis le départ, SOS Futur veut vulgariser les nouvelles technologies à tous afin que plus personne ne « subisse » ces technologies. En effet, les nouvelles technologies sont un véritable atout au quotidien si on sait les utiliser, et surtout si on sait les utiliser correctement, c’est-à-dire de manière éthique et écoresponsable. Nous sommes donc là pour accompagner les personnes et les organisations en trouvant des solutions à leur besoin en matière de numérique, en proposant notamment une formation pratique, éthique et responsable à l’utilisation de ces solutions.
Quels sont selon vous les grands enjeux énergétiques et écologiques du numérique ?
Longtemps ignorés, les conséquences environnementales du numériques ne sont plus à prouver. Mais si certains en doutaient encore, il suffit d’aller voir les différentes études du Think Tank « The Shift Project » pour voir l’impact croissant de ce secteur dans des pollutions diverses. Deux aspects sont à différencier, la consommation énergétique liée à la production d’un côté, et celle liée à l’utilisation de l’autre. La seconde a dépassé la première depuis peu en termes de pourcentage (55% vs 45%). Au vu du développement toujours plus soutenu du numérique, il est indispensable de réfléchir et d’agir sur ces 2 aspects, car ce rythme actuel n’est pas tenable sur le moyen terme.
Vous travaillez de plus en plus sur la question du numérique responsable. De quelle manière ?
SOS Futur s’efforce de travailler sur les deux tableaux.
D’un côté, pour diminuer « la production », plusieurs actions sont réalisées. La première chose est d’analyser précisément les besoins clients et de choisir des solutions PROPORTIONNÉES, MODULAIRES, ÉVOLUTIVES et FACILEMENT RÉPARABLES ! En effet, notre société à une forte tendance à vendre des solutions beaucoup trop performantes pour les besoins, et les clients n’utilisent qu’une faible partie des capacités des machines. De même, certains constructeurs rendent de plus en plus difficile, voire impossible, la réparation de leur appareil ou l’évolution de certains de ses composants. Du coup, à chaque panne, il faut changer d’appareil… Mais l’obsolescence programmée est aujourd’hui en partie logicielle, c’est aussi pourquoi nous favorisons quand cela est possible des systèmes libres et durables dans le temps. Ensuite, nous essayons de reconditionner au maximum les matériels afin de diminuer l’utilisation de composants neufs. Nous sommes également là pour conseiller au mieux les organisations dans leurs approvisionnements en matériels numériques sur toutes ces questions éthiques et responsables.
Concernant « l’utilisation », nous avons une grosse brique formation sur les conséquences des usages du numérique, et notamment du mail par exemple. Répondre à un mail groupé est-il nécessaire ? Garder un mail vieux de 3 ans est-il pertinent ? Il y a énormément de choses « basiques » sur lesquelles on peut jouer. Les gens non formés ne se rendent pas compte de l’impact de ces actions prétendument « dématérialisées ». Il est donc très important de faire de la prévention là-dessus. De même, nous essayons de privilégier des solutions logicielles adaptées, susceptible d’être plus « légères » sur les serveurs et moins énergivores. Enfin, pour lutter contre l’obsolescence logicielle, nous utilisons quand cela est possible des logiciels libres.
Vous avez déployé pour Kèpos un système d’information partagé open source nommé Nextcloud. Quel est le l’intérêt d’un tel outil ?
En effet, cet outil est une plateforme collaborative qui permet de regrouper beaucoup de fonctionnalités en un seul endroit : drive personnel et partagé, gestion des contacts et des calendriers, accès aux mails, solutions d’édition de documents, de tableurs et de présentations collaboratives, et plein d’autres outils pour la gestion de projets en équipe. Le fait d’utiliser une solution libre représente beaucoup d’avantages.
D’une part, d’un point de vue éthique. Le principal avantage est que l’on auto-héberge les données, c’est-à-dire que l’on a la maîtrise totale de l’endroit où sont stockées nos données. Elles nous appartiennent et seules les personnes autorisés y ont accès. Les grosses entreprises du secteur n’en font donc pas ce qu’elles veulent. Ensuite, cette licence AGPL permet d’être sûr que cet outil ne sera jamais commercialisé ni propriétaire. Nous avons donc l’assurance que l’on pourra toujours maîtriser cette solution.
D’autre part, d’un point de vue pratique. Cette solution est collaborative, donc n’importe quel développeur peut proposer des améliorations et des nouvelles fonctionnalités. C’est une solution modulaire, c’est-à-dire qu’on n’active et on n’installe que ce qui est nécessaire.
Enfin, d’un point de vue énergétique, cette solution est beaucoup moins gourmande que les solutions propriétaires type Google Drive, Amazon ou Microsoft, et la consommation du serveur est entièrement gérée par nos soins. Nous ne mettons donc que l’essentiel, et le serveur est basé en France. Nous maîtrisons donc toute la chaîne.
La crise sanitaire et les mesures restrictives de type confinement viennent renforcer l’intérêt du numérique pour maintenir du lien, notamment via le déploiement du télétravail. Comment intervenez-vous en support de ces nouveaux usages ?
Le numérique est indispensable aujourd’hui, et encore plus dans une situation comme celle que l’on rencontre actuellement. SOS Futur accompagne les particuliers, notamment les seniors, en les formant sur des outils de type tablettes, pour qu’ils puissent utiliser les applications de messagerie instantanée afin qu’ils restent en contact avec leur famille et leurs proches. Nous mettons également en place des systèmes rapides de réparation ou d’amélioration des machines. La location de matériel est également favorisée durant cette période.
Pour les professionnels, SOS Futur les accompagne dans la mise en place de solutions de télétravail, avec la mise à disposition de matériel supplémentaire, l’installation de solutions collaboratives propriétaires ou open-source, avec un fort accent sur la sécurisation des données.
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
22 septembre 2020Projets / Revues de ProjetsVêt Ethic est une boutique de commerce équitable vestimentaire, à Nancy, qui vient de fêter ses 10 ans en emménageant dans un nouveau local. A l’occasion, cette SCIC lance un financement participatif avec l’appui des équipes de Kèpos L’occasion de découvrir l’histoire et l’action de ce pionnier de la mode durable en Grand Est avec son dirigeant, Pascal Didier.
Qu’est-ce que Vet Ethic ?
Vêt Ethic est une boutique coopérative (Société Coopérative d’Intérêt Collectif – SCIC) qui diffuse du textile issu du commerce équitable. Une mode éthique qui respecte ses producteurs et qui leur permet de vivre décemment de leur travail, qu’ils produisent en Inde ou dans les Vosges. L’entreprise appartient à un collectif de sociétaires, qu’ils soient salariés, usagers, bénévoles ou partenaires.
Quelle est son histoire ?
L’aventure Vêt Ethic a démarré en 2008, lorsqu’une petite bande d’amis se lançait dans un pari qui semblait un peu fou : créer et faire vivre une boutique dédiée au commerce de vêtements équitables sur Nancy. L’objectif était de démontrer qu’il est possible de concilier mode vestimentaire et respect des travailleurs et de l’environnement. Le choix d’un statut coopératif s’impose naturellement : il permet une gouvernance qui associe salariés, clients coopérateurs et partenaires, tout en garantissant que le respect des valeurs passe avant les bénéfices financiers. Avec 103 sociétaires en 2020, le pari est largement rempli.
La boutique fête ses 10 ans en 2020 et déménage en plein centre ville dans un local de plus de 100m². Cette énergie collective ne sera pas de trop pour relever les défis que l’équipe s’est fixée : profiter de la surface de vente supplémentaire pour étoffer l’offre en vêtements et alimentaire solidaire. Et nous menons de front nos autres projets, comme l’organisation avec le COLECOSOL Grand Est (Collectif pour la Promotion du Commerce Equitable et de la Consommation Responsable) du marché de noël équitable de Tomblaine, qui aura lieu les 19 et 20 décembre 2020. Nous sommes donc ouverts depuis le 5 septembre au 109B rue Saint-Dizier.
Comment percevez-vous les attentes des consommateurs en matière de mode durable ?
Les attentes sont ambivalentes, et parfois difficilement conciliables, par exemple la conjonction d’une matière écolo, d’une fabrication française éthique et d’un prix bas. Il y a donc encore un gros effort pédagogique à faire, nous sommes bien un acteur d’éducation populaire.
Vous tentez d’allier commerce équitable, souci pour la planète, gouvernance partagée : jusqu’à quel point cela est-il conciliable ? Peut-on tout faire à la fois ?
On a essayé d’être le plus cohérent possible, c’est pour cela que nous avons opté pour le statut coopératif. Le commerce équitable se décline en 2 versions : Nord /sud avec des matières écolos, mais des déplacements longs et peu écologiques, et de l’autre côté le commerce équitable France, avec des produits fabriqués plus près de chez nous, mais pas toujours avec des matières saines et une gouvernance capitaliste.
Vous emmenagez dans une nouvelle boutique à Nancy ? Parlez-nous un peu de ce projet !
Nous sommes déjà dans notre nouvelle boutique au 109B rue Saint-Dizier depuis le 5 septembre 2020. Nous avons trouvé un local plus spacieux et plus visible pour pouvoir élargir nos gammes de produits et mieux mettre en valeur les vêtements. Nous étions très attachés à l’ancien magasin, mais il était temps d’évoluer. Cette année nous avons fêté les 10 ans de la coopérative, l’emménagement est donc une belle façon de fêter notre anniversaire !
Pour financer cette étape importante, vous menez une campagne de financement participatif. Pourquoi ?
Nous avons lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Zeste pour financer tous les frais liés au projet de déménagement de la boutique. Le local rue Saint-Michel faisait environ 40m² et nous passons aujourd’hui à plus de 100m² de surface de vente. Il nous faut donc faire les travaux (électricité, peinture, sécurité, etc), acheter du mobilier, se mettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite et aménager correctement le nouveau magasin. Cette campagne nous évite d’avoir recours à l’emprunt bancaire et nous permettra d’évoluer, d’agrandir nos gammes de produits équitables et de proposer toujours plus de mode éthique à Nancy et dans la région. Le financement à débuté le 18 août et prendra fin le 29 septembre prochain.
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
13 juillet 2020Projets / Revues de ProjetsOphélie Benito est une jeune designer, conceptrice de la Collection Mollis, une gamme d’objets enveloppants dédiée au soin. Membre de Kèpos, elle nous expose sa vision du design comme étant au service des hommes et des territoires.
Qui êtes-vous ?
Je suis Ophélie Benito. Je suis designer de formation et ce qui m’anime, c’est de pouvoir mettre ma créativité et mes compétences au service de l’humain pour améliorer son quotidien. Par ailleurs, le fait de développer des solutions en circuit court et avec des matériaux naturels du territoire est un enjeu important dans chacun de mes projets.
Je suis, depuis 2017, créatrice de la Collection Mollis, une gamme d’objets enveloppants et apaisants composés en majeure partie de laine de mouton biologique de lorraine. Diplômée en design de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design (ENSAD) de Nancy, j’ai également un master de design global spécialisé dans les procédés de fabrication et les matériaux. Ces deux formations, ainsi que les stages que j’ai pu effectuer, notamment chez MateriO à Paris, m’ont permis d’apprendre à créer et fabriquer des projets qui remettent l’utilisateur au centre des réflexions, ainsi qu’à engager les ressources les plus adaptées, dans des conceptions durables et respectueuses de l’environnement.
Comment
en êtes-vous arrivée à imaginer la Collection Mollis ?
La Collection Mollis est née d’une réflexion qui a débuté lors d’un atelier étudiant collectif nommé « Care », centré sur l’éthique dans les lieux de soin. À cette occasion, j’ai visité un institut médico -éducatif qui accueillait des enfants atteints de troubles du spectre autistique, et ai observé leur quotidien dans l’établissement. J’ai découvert, dans ces lieux de vie et de soin souvent froids et aseptisés, un réel besoin de soutien et de solutions humanisantes pour les professionnels et les habitants.
Les enfants entraient régulièrement en crise liées à divers facteurs, aggravés par un environnement anxiogène. Toutes les solutions qui leurs étaient proposées étaient curatives et souvent situées dans des salles accessibles uniquement sur rendez-vous. Ainsi a débuté, avec les soignants, une réflexion sur la création de solutions préventives plus accessibles et plus résilientes pour réhumaniser ces lieux d’accueil, au sein desquels les matières naturelles sont absentes et manquent. Avec les premières recherches et les premiers essais en équipe, j’ai réalisé que l’enveloppement et la compression apaisait efficacement ces bénéficiaires. Puis, j’ai recherché les ressources humaines et matérielles du territoire à même de répondre à ces problématiques. C’est en rencontrant la Filière laines ainsi que différentes entreprises locales et chantiers de réinsertion professionnelle que les objets ont vu le jour. La découverte des qualités techniques et sensorielles de la laine de mouton a été déterminante pour la naissance du projet, c’est sur ces caractéristiques que s’appuie aujourd’hui la Collection Mollis.
Qu’est-ce
que propose la Collection Mollis, et à qui s’adresse-t-elle ?
La Collection Mollis est une gamme d’objets « mous », enveloppants, doux et lourds, qui tendent à améliorer la qualité de vie de personnes fragiles par un accompagnement physique et psychique grâce à des ressources locales et naturelles telle que la laine de mouton. Envelopper avec ou sans compression, entourer le corps et l’humain pour apaiser par une étreinte contrôlée, tels sont les modes de fonctionnement des coussins et supports de la Collection Mollis. Chaque objet est conçu pour s’adapter à toutes les postures et pour être utilisé seul ou avec les autres solutions de la gamme.
Elle s’adresse en tout premier lieu aux personnes fragiles vivant ou étant de passage dans des lieux d’accueil du secteur médico-social (MAS, IME, EHPAD), mais également au grand public. En effet, au fil du développement du projet, j’ai remarqué que les solutions low tech que je met en place ont un impact positif sur la santé et le quotidien de personnes en perte d’autonomie ou avec des particularités, mais intéressent aussi beaucoup le grand public et peuvent l’accompagner au quotidien.
La Collection Mollis existe également pour s’adapter aux besoins spécifiques. C’est pourquoi je suis en capacité de proposer des prestations de design d’espace ou d’objets, ainsi que des animations, afin d’adapter un lieu à recevoir les solutions de la Collection, ou d’adapter les objets à des besoins très précis.
Tous vos matériaux sont bio-sourcés et produits en local : quel est l’intérêt d’une telle démarche ?
La démarche de faire appel à des ressources humaines et matérielles locales a été la mienne pour plusieurs raisons. La première réside tout simplement dans mes convictions. La Collection Mollis a pour fondation la notion de Care (éthique du soin). Ne pas prendre soin des humains et du territoire dans mon développement aurait été contraire à l’éthique du projet. Aussi, je crois au fait que tout créateur de produit, peu importe sa visée, doit, et cela fait partie de son travail de recherche et développement, penser à la durabilité, au choix des matériaux les plus adaptés et les plus accessibles, ainsi qu’à l’impact environnemental de sa solution. Cela fait partie du travail de création.
J’ai utilisé la laine, le blé et le textile de coton des Vosges, non pas uniquement pour faire avec les ressources naturelles du territoire, mais également parce qu’elles correspondaient à ce que je voulais développer, même s’il faut garder à l’esprit que certains matériaux d’origine naturelle peuvent parfois avoir une durabilité et un impact carbone plus négatifs que d’autres ressources.
L’intérêt de cette démarche est à la fois de créer de l’activité locale pour soutenir l’économie, mais également de valoriser ou revaloriser des ressources qui sont souvent méconnues ou sous exploitées sur le territoire. Pour ma part, la connaissance de la Filière laines et du fait qu’il y a encore 5 ans, 99% des dizaines de tonnes de laine de mouton produites dans la région étaient considérés comme des déchets ou vendues à des grossistes à des prix dérisoires pour être exportés en Asie m’a beaucoup touchée. Découvrir la Filière laines et toutes les démarches éthiques mises en place dans la Grande Région a fini de me convaincre d’utiliser ce matériau qui avait déjà les qualités techniques recherchées.
Pour finir, le contact humain direct avec ses fournisseurs et ses fabricants me semble primordial pour développer une solution maîtrisée. Le circuit court est alors, en plus de son faible impact carbone, le meilleur choix.
Comment
voyez-vous le rôle du design dans la conduite des transformations de
modes de vie et de production impliquées par la transition
écologique ?
Les designers d’aujourd’hui sont formés pour repenser les modes de vie et ont toujours été créateurs de nouvelles façons de faire ou de voir les choses. Ils peuvent instiguer le changement. Ce métier a d’ailleurs pour objectif de trouver des solutions, des facilitations et des transformations autour des humains en observant tout un écosystème. Or, si l’on observe les écosystèmes pour trouver des solutions, il me semble difficile de faire ce métier sans être impliqué dans la transition écologique, cela me parait presque obligatoire.
De mon point de vue, les designers ont donc un rôle important à jouer dans la transition écologique puisqu’ils sont à la fois à même de créer de nouvelles solutions pensées pour les humains et dans un environnement, mais également parce que le design est là pour améliorer l’existant. Faire avec l’existant permet de prolonger la durée de vie des objets, des matières et des espaces, ce qui à mon sens est un enjeu primordial. Comme je le disais auparavant, le choix des matériaux, des méthodes et des fabricants fait partie du travail du designer, qui, s’il les maîtrise, peut avoir un rôle important dans la conduite des changements des modes de vie et de production. Je pense enfin que les designers peuvent jouer un rôle important dans la transition en sensibilisant leurs clients, qui peuvent être des grands groupes ou des collectivités. Ils se transforment alors en vecteurs de changements à grande échelle.
Quelles
sont les perspectives pour vous et la Collection Mollis ?
Pour moi et pour la Collection Mollis, l’avenir se préfigure entre vente d’objets, prestations de design d’objets, d’espaces et d’éléments graphiques au service du mieux vivre et pour tous. J’envisage un nouveau statut et d’ouvrir une entreprise pour faire changer d’échelle la Collection, afin de pouvoir la proposer plus largement au grand public, aux professionnels et dans les lieux de soin. Cette étape débutera dès la rentrée scolaire, bien que je sois déjà à même d’entamer des opérations dès aujourd’hui. La certification en dispositif médical est également une perspective d’avenir importante pour la Collection, afin d’améliorer son accessibilité.
J’aimerais par ailleurs faire évoluer la Collection Mollis pour la rendre encore plus accessible, l’étoffer et développer de nouveaux produits dédiés à de nouveaux usages ou à des publics précis tels que les mamans et leur bébés. Les solutions créées seront toujours pensées au plus proche des futurs utilisateurs, pour être utiles, flexibles et pour durer au sein de l’habitat.
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
18 mai 2020Projets / Revues de ProjetsFranck Magot, gérant des Fermiers d’Ici, traiteur travaillant quasi-exclusivement avec des produits Bio et locaux à Nancy, avait été interviewé sur ce même blog il y a un peu moins de trois ans. Aujourd’hui, l’entreprise se lance sur de nouveaux marchés (drive fermier, conserverie). L’occasion de faire un point sur le développement de l’activité.
Nous vous avions interviewé il y a plus de deux ans. Quel chemin ont parcouru les Fermiers d’Ici depuis ?
Depuis deux ans, Les Fermiers d’Ici parcourent toujours le même chemin, celui d’une alimentation bio et locale. Deux nouveaux compagnons de route nous ont rejoint, l’équipe des Fermiers d’Ici est désormais constitué de 5 personnes. Ces arrivées ont été nécessaires du fait du développement des l’entreprise. En effet notre activité de traiteur a doublé, nous travaillons maintenant pour des collectivités comme le Département de Meurthe et Moselle ainsi que la Région Grand Est. A cela s’ajoute de nouvelles entreprises du secteur privé.
Depuis 2018, nous avons renforcé nos ambitions liées à la transition écologique. Des efforts supplémentaires vers le zéro déchet ont été réalisée. Et nous privilégions aujourd’hui des viandes provenant d’herbivores qui favorisent la présence de prairies (source de biodiversité et de stockage de carbone).
Quelles sont vos principales fiertés ?
Les Fermiers d’Ici œuvrent à une meilleure cohésion sur le territoire. En se développant, nous offrons aux producteurs des débouchés de plus en plus importants. Nos clients sont très attentifs à cela. Je suis très touché de constater qu’ils y portent un grand intérêt. En effet, lorsque sur un buffet ou lors d’un mariage, nous présentons la ferme d’où vient tel ou tel produit, et les convives s’y intéressent beaucoup.
En revanche, quelles difficultés vous ont marqué ?
La difficulté principale est la structuration d’une jeune entreprise, sans avoir d’expérience dans ce domaine. Les journées et les semaines sont longues, cela peut-être épuisant.
Vous êtes un des fondateurs de Kèpos. Que vous a apporté cette SCIC depuis sa création ?
Kepos, est pour moi, un réseau d’entraide. Tout d’abord entre entrepreneurs, nous pouvons partager de bonnes idées. C’est aussi du soutien de la part de l’équipe de salariés, qui peut répondre à nos questions/ nos doutes. En ce qui concerne Les Fermiers d’Ici, c’est aussi des compétences complémentaires fiables. Que ce soit chez les entrepreneurs membres ou via les prestations que proposent la SCIC, nous sous-traitons en toute confiance une partie des missions pour lesquelles nous ne sommes pas compétents.
Aujourd’hui, les Fermiers d’Ici se lancent sur de nouvelles activités. Pouvez-vous nous en parler ?
Nous avions dans nos cartons un projet de conserverie. Idée que nous avons mise en route durant la crise du Covid. Nous sommes accompagnés en cela par la Serre à projets. A ce jour, il s’agit de cuisiner des plats préparés (tajine d’agneau, risotto au quinoa….) et de les pasteuriser en bocal. Ces bocaux sont d’ailleurs consignés. Nous avons conçu des recettes adaptées à un régime flexitarien et végan. Nous sommes en cours de labellisation Bio. Pour une, deux ou trois personnes, ces bocaux artisanaux sont idéaux pour se faire plaisir tout en respectant ses valeurs. Vous n’avez qu’à ouvrir le bocal, mettre à réchauffer et déguster ! A ce jour, il est possible de commander nos bocaux via notre site internet. Bientôt, nous espérons proposer ces bocaux dans des magasins spécialisés comme Biocoop, ou encore Day by Day .
Par ailleurs, durant le confinement lié au Covid, nous avons été appelés pour réaliser des livraisons de légumes, fruits, produits carnés et laitiers. Nous avons donc mis en place un service de drive et de livraisons, accessible également depuis notre site internet. Nous y proposons les produits de nos producteurs.
Plus globalement, comment appréhendez-vous votre activité dans le contexte du Covid et de sa suite ?
La crise du Covid a durablement affecté notre activité de traiteur, qui était lié à de plus ou moins grosses réunions de personnes (mariage, réunion de travail, réception…). Nous sommes dans l’obligation de repenser notre métier. Mais durant le confinement lié au covid, j’ai néanmoins pu constater que les drives de producteurs ont bien fonctionné. Cela prouve un intérêt grandissant pour le type de produits Bio et locaux avec lesquels nous travaillons.
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
20 avril 2020Projets / Revues de ProjetsAurélien Stoky est le créateur de la société Holimaker, mambre de Kèpos, qui propose des micro-solutions industrielles de revalorisation de la matière. Une offre tout à fait pertinente pour œuvrer à la transition dans l’industrie !
Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Aurélien Stoky, j’ai 28 ans, je suis le dirigeant de l’entreprise HoliMaker. Je pense me définir comme un rêveur pragmatique. J’ai toujours plein d’idées dans la tête qui partent dans tous les sens, mais j’arrive néanmoins à me canaliser, prendre du recul et passer à l’action pour que ces idées deviennent réalités. Je suis un grand adepte du « pourquoi pas » : essayer des solutions qui semblent impossibles, prendre des décisions en conséquence et repousser les limites. Enfant et adulte à la fois, j’aime beaucoup rire, je suis très curieux et je suis un grand fan de l’émission « C’est pas Sorcier ».
Quel est votre
parcours : comment en êtes-vous arrivé à créer HoliMaker ?
J’ai toujours été fasciné par le travail des matériaux. Etant petit, je démontais tous les objets autour de moi pour comprendre comment ils fonctionnaient, comment ils avaient été fabriqués (et je ne savais pas toujours les remonter). J’ai désiré allier mes études avec le travail manuel en réalisant un BAC STI en Génie des Matériaux au lycée Loritz à Nancy. Ces 2 années m’ont permis de découvrir la céramique, la fonderie, les composites, mais également l’injection plastique. Suite à ce diplôme, je souhaitais travailler car j’avais quelques difficultés à me concentrer sur la théorie scolaire. Je rêvais de devenir « soudeur ». J’ai donc décidé de réaliser un BTS en Chaudronnerie par alternance au CFAI de Maxéville (54) ainsi que dans l’entreprise Fives Cryo à Golbey (88). Ayant la soif d’apprendre d’avantage la fabrication des objets, j’ai poursuivi mon alternance dans cette entreprise en réalisant un diplôme d’Ingénierie de la Conception de l’Ecole des Mines de Nancy à l’InSIC de Saint-Dié-des-Vosges (88). L’alternance a été pour moi une réelle opportunité qui m’a permis de travailler sur des sujets passionnants. J’ai ensuite continué l’aventure chez Fives Cryo en tant qu’ingénieur dans le bureau d’étude.
En 2016, j’ai commencé à m’intéresser à la permaculture, à la relation possible des éléments dans un écosystème, et j’ai passé un diplôme en design de milieu permaculturel en parallèle de mon travail. J’ai eu à ce moment l’idée de développer un « parc d’expérimentation » en permaculture que j’ai présenté devant la Chambre d’Agriculture. J’ai failli passer un BP REA (Responsable d’Exploitation Agricole) jusqu’au moment où je me suis rendu compte que je pouvais apporter plus efficacement ma pierre à l’édifice grâce à un domaine qui me passionne : le travail des matériaux.
Parmi les
matériaux, vous vous intéressez plus spécifiquement au plastique.
Pourquoi ?
La matière plastique est pour moi une matière formidable : l’alliance entre la légèreté, la résistance mécanique et chimique, et modelable à la forme souhaitée. Cependant, cette matière provient en grande partie d’une ressource fossile qui est le pétrole, qui met plus de 60 millions d’année pour être fabriquée par notre planète (nous consommons aujourd’hui une ressource qui date de la disparition des dinosaures !) et qui est au centre de certaines guerres. En parallèle, la France à elle seule produit chaque année plus de 3,7 millions de tonnes de déchets plastiques qui ne sont pas recyclés, cela représente à peu près 3 fois la taille de la pyramide de Khéops en ressources non valorisées !
Mais pourquoi
cette matière n’est-elle pas plus recyclée ?
Le plastique est actuellement peu recyclé pour de nombreuses raisons comme les coûts de transport des déchets, la difficulté de gérer des milliers de gisements différents, l’apport énergétique intéressant lié à sa combustion,… Une autre de ces raisons est la méconnaissance du fonctionnement de la transformation de cette matière, qui est difficile à appréhender, et donc difficile à réaliser localement : 10 000 fois plus visqueuse que l’eau, il ne suffit pas de la verser pour fabriquer un nouvel objet ! Suite à ce constat, j’ai décidé de fabriquer une machine pour sensibiliser au recyclage de la matière plastique et montrer que l’économie circulaire est possible. J’ai ainsi quitté mon emploi dans cette entreprise qui m’a accompagné durant 7ans en août 2016 afin de me consacrer à plein temps à HoliPress : une presse à injection plastique manuelle.
Pouvez-vous nous
présenter HoliPress ? Quel est son intérêt ?
HoliPress est un appareil qui fond la matière plastique et l’injecte dans un moule grâce à la force manuelle. Elle permet de prototyper et de produire en petites séries des pièces de qualité industrielle dans de nombreux domaines :
Ingénierie et design de produit (mécanique, horlogerie, automobile, électronique,…) Santé et industrie pharmaceutique Communication Education et formation
HoliPress combine la productivité et la qualité de l’injection plastique industrielle avec la flexibilité de l’impression 3D. Très simple à utiliser, elle permet de passer rapidement de l’idée à l’action tout en revalorisant la matière plastique usagée.
Comment
définiriez-vous le métier d’HoliMaker ?
Tout d’abord, HoliMaker vient de « Holi », la vision holistique de notre environnement, l’interdépendance des éléments, la diversité des matières autour de nous. « Maker », c’est le mouvement du « Faire », du passage à l’action, de la fabrication. HoliMaker est une entreprise implantée dans le tiers-lieux Bliiida à Metz et accompagnée par l’incubateur régional The Pool. Chez HoliMaker, nous développons et commercialisons des solutions de micro-industrie permettant de revaloriser différents types de matières. Une de ces premières matières est le plastique via notre solution : HoliPress. Nous proposons également l’animation d’ateliers concernant la revalorisation des matériaux.
Comment
voyez-vous les enjeux industriels liés à la transition écologique
et aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 ?
Selon moi, les enjeux de la transition écologique passent par plusieurs étapes :
Réduire notre consommation en ayant des produits de qualité (contrer l’obsolescence programmée) Réduire notre consommation d’énergie en optimisant nos processus industriels Fabriquer localement pour limiter les transports Réutiliser les matières qui sont sur nos territoires
Avec HoliMaker, nous souhaitons répondre à ces enjeux en proposant des machines robustes, éco-conçues, optimisées énergétiquement grâce à un bureau d’étude spécialisé, et permettant de revaloriser les matières (notre broyeuse manuelle permet de broyer la matière plastique pour l’insérer dans HoliPress).
Concernant l’épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement, je pense qu’il est important d’être unis, mais agiles également, en relocalisant au maximum nos productions mais également nos développements. Cela est possible via la multiplication de micro-unités industrielles afin d’être plus résilient et gagner en réactivité.
Je crois que nous pouvons tous être acteurs face à la transition écologique mais également face à cette épidémie. Nous devons construire ensemble le « après » mais aussi le « pendant ». Cela s’est d’ailleurs démontré depuis ces dernières semaines où des « makers » fabriquent des masques, des visières de protection et d’autres accessoires aux quatre coins du monde pour lutter contre la propagation du virus.
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
17 mars 2020Projets / Revues de ProjetsYohan Blanche est l’initiateur d’EcoPlacement, une solution d’épargne immobilière qui vise à rendre possible l’éco-rénovation du parc locatif privé. Il nous présente l’intérêt d’une telle démarche pour démocratiser l’habitat durable.
Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Yohan Blanche. J’ai 31 ans pour quelques jours encore et papa d’une petite de fille de 4 ans. Je suis également reconnu travailleur handicapé depuis 2012 du fait d’un handicap dit « invisible ». Depuis une douzaine d’années, je me suis impliqué en tant que porteur de projet, créateur d’entreprises ou d’associations, ou encore salarié dans plusieurs domaines de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) qui couvrent tous les âges de la vie. Au fur et à mesure des années, des valeurs fortes se sont ancrées en moi, et m’ont amené à repousser avec force les injustices et le non-sens. Aujourd’hui, il est vital, à mon sens, d’affronter les problèmes que rencontre notre société, parce que « notre maison brûle et nous regardons ailleurs » : urgence climatique, réduction de notre consommation énergétique, fracture entre les générations, mise en marge de la société des plus fragiles, sentiment de déclassement social…
Quelle est
l’histoire d’EcoPlacement ?
EcoPlacement est une histoire commune. C’est l’histoire de deux expériences de vie, celles de Patrick Henry et moi-même, qui ont convergé vers cette belle idée. Tout commence par un constat réalisé au sein de l’association Un Toit Partagé : l’absence d’offre immobilière adaptée à la colocation entre « seniors ». C’est là que l’idée commence : comment créer une offre immobilière qui réponde aux attentes des 55 ans et plus et qui s’inscrit dans nos valeurs ? Ce que l’on savait, c’est qu’il fallait un ou plusieurs logements de colocation de 2 personnes, dans un immeuble à taille humaine, à proximité des services, accessible, adapté, et dont le coût soit accessible au plus grand nombre. Et à cela, nous nous sommes ajoutés des contraintes supplémentaires : pas d’expansion urbaine, sauvegarder le patrimoine existant, une très haute performance énergétique de l’habitat, une réduction de son impact carbone ou encore un budget logement moins élevé que le marché local. Il nous a fallu près de 5 années pour développer un modèle qui fasse consensus.
Quels sont selon
vous les grands enjeux de la transition écologique en matière
d’habitat ?
À mon sens, deux enjeux prédominent. Le premier enjeu se résume en une phrase de Thierry Salomon : « L’énergie la plus propre est celle que l’on évite de consommer ». Alors quand je vois que l’on peut obtenir des subventions pour changer de chaudière sans avoir réalisé, au préalable, des travaux d’éco-rénovation, ou encore que la laine de verre, dont les propriétés thermiques sont valables 10 ans, est subventionnée lors de travaux d’éco-rénovation, je me dis qu’on est encore loin de réussir cette transition. Il serait temps de développer une vision à long terme de la transition écologique de l’habitat.
Le second enjeu est la transition énergétique du parc résidentiel locatif. En effet, les propriétaires occupants ont accès à de nombreuses subventions, en comparaison des propriétaires bailleurs. Entre le surcoût des prix de l’immobilier et le montant des travaux à charge, l’équation est impossible. Pourtant, ce sont les plus fragiles qui en font les frais : les locataires.
Quel est le
concept que vous proposez avec EcoPlacement ?
EcoPlacement a pour volonté de développer une offre nouvelle d’habitat locatif durable, intergénérationnel et à budget logement accessible. Un habitat éco-rénové avec des matériaux biosourcés, et où se mêlent toutes les générations : seniors, actifs et étudiants, à l’image des structures familiales d’avant-guerre.
Pour créer cet habitat, EcoPlacement offre deux types de placements :
Un placement patrimonial à terme : Éco Patrimoine Un placement de rente : Éco Rente
Pour proposer ces placements, EcoPlacement utilise le mécanisme du démembrement de propriété temporaire.
Quel est
l’intérêt de ce type de montage pour l’investisseur ?
Pour ce qui concerne l’usage du démembrement, et contrairement à beaucoup d’opérations de ce type, nous nous basons sur les valeurs du marché local et non sur une surévaluation. Le mécanisme du démembrement de propriété temporaire, 12 à 15 ans, permet de spécialiser l’attente d’un placement immobilier :
Se constituer un patrimoine qui correspond à la nue-propriété. Se constituer un cash-flow qui correspond à l’usufruit.
La valeur des placements sont proportionnels à la valeur totale future du bien :
60% pour la nue-propriété, ce qui permet de voir son patrimoine se valoriser automatiquement grâce à la décote appliquée 40% pour l’usufruit, ce qui permet de booster le rendement par un investissement moindre
Pouvez-nous
parler de votre première opération ?
Encore un peu de patience et nous pourrons communiquer sur la première opération ?. Un petit indice : elle se fera dans un département à l’est de la Meurthe-et-Moselle !
Merci !
Dans le même ordre d’idée vous consulterez avec profit notre article à propos de Clairlieu Eco-défi, une initiative originale qui imagine des solutions au service de la rénovation du parc privé de propriétaires occupants dans le quartier de Clairlieu, à Villers-lès-Nancy.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
2 mars 2020Projets / Revues de ProjetsAurélie Marzoc est une jeune professionnelle du design, qui axe sur son travail sur les interactions entre l’homme et la nature. Elle lance une série de jeux pédagogiques en bois pour faire connaître le jardinage naturel et sensibiliser à la biodiversité : Les cultivés ! Elle nous présente son activité.
Qui êtes-vous?
Je suis Aurélie Marzoc. Depuis ma tendre enfance, je suis passionnée par la nature, et tout particulièrement par le jardinage. J’ai obtenu en 2018 un double master designer/ingénieur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design (ENSAD) de Nancy, ce qui me permet aujourd’hui d’exercer une activité professionnelle proche de mes convictions personnelles. J’ai 25 ans et vis sur le territoire lorrain, où grandit peu à peu mon activité de designer.
Pouvez-vous nous présenter votre activité :
Je suis designer indépendante basée entre Nancy et les montagnes vosgiennes. Mes axes de travail cherchent à valoriser la biodiversité, les interactions nature/humain, ainsi que la place de l’écologie dans les stratégies de territoire. Je spécialise mon activité dans la conception d’objets et de jeux pédagogiques, dont les objectifs ont à voir avec la diffusion des savoirs sur la biodiversité. Mes méthodes de conception prennent en compte l’analyse des flux et la place de l’usager, et privilégient des matériaux durables, produits localement et issus de filières de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Qu’est-ce que « Les cultivés » ?
Les cultivés sont quatre jeux pédagogiques et ludiques en bois pour découvrir la biodiversité dont je suis l’auteur :
Qu’est-ce ? Les joueurs sont invités à trier une soixantaine de jetons. Quatre catégories s’offrent à eux : aromate, légume, fleur et fruit. Pour affiner ce tri, le jeu propose une seconde sélection selon les morphologies des végétaux. Est-ce une racine ? Une tige? Un fruit à noyau ou à pépins ? Une fleur simple ou multiple ? Les saisons : chaque mois de l’année, le jardin offre différentes récoltes et activités. Ce jeu aborde ainsi l’organisation d’un potager en mettant en avant la diversité des pratiques durables en fonction des saisons et des récoltes. Qui mange qui ? Ce jeu invite à découvrir les différents êtres vivants qui peuplent le jardin, et les interactions qui existent entre eux, tout en sensibilisant à la notion d’écosystème. Les légumes copains : Grâce à de simples additions, découvrez les associations de légumes et de végétaux propices à un potager abondant. Le jeu vous initie ainsi à une notion importante de la permaculture.
Comment cette idée a-t-elle germée ?
Lors de mon master à l’ENSAD de Nancy, deux pistes de réflexion m’ont fait aboutir à ce projet :
L’écriture
d’un mémoire rassemblant mes réflexions sur ce que le designer
peut apporter dans les pratiques de soin à partir de plantes
spontanées (qui se développent sans la volonté de l’Homme).
Des
interventions dans une école primaire, dans laquelle j’ai conçu
un potager pédagogique. Lorsque le jardin a
été créé,
j’ai réalisé que les enseignants ainsi que les enfants
manquaient de connaissance sur le jardinage. Effectivement, je me
suis rendue compte que les éditeurs de livres et supports
pédagogiques spécialistes
à l’éducation proposaient
très peu d’outils d’éducation
à l’environnement. Par
ailleurs, les
associations d’éducation à l’environnement développent des
outils en interne , mais
les diffusent
très peu en externe.
Les jeux Les cultivés sont une solution ludique et pédagogique pour transmettre les connaissances sur le jardin, et sensibiliser à l’importance de la biodiversité.
Où en êtes-vous du montage de ce projet, et quelles sont ses perspectives?
Après 2 ans de travail de conception et de test avec différents publics, j’ai lancé le 25 février 2020 les premières préventes . L’objectif est de réunir le fonds de roulement nécessaire pour rémunérer les différentes entreprises prestataires de ce projet. Cela représente une cinquantaine de jeux à vendre sous la forme d’un financement participatif.
J’ai pour projet d’éditer trois à quatre jeux à destination de l’éducation à l’environnement chaque année. A côté de cela, je souhaite intégrer des collectifs de projets en lien avec la transition écologique, afin de mutualiser des compétences professionnelles, notamment en collaborant avec les autres membres de Képos.
En quoi le design peut être un outil intéressant à mobiliser dans la perspective de la transition écologique?
Le design que j’exerce questionne les relations entre l’humain et la biodiversité. Mes compétences sont celles de la conduite d’un projet de design, de sa conception à sa réalisation. Ma démarche s’appuie sur des observations et des analyses d’un territoire, ses flux et ses usagers. Des outils de consultations (discussions, échanges, questionnaires et retour d’expériences) me permettent d’élaborer des projets. Sous-traitant la fabrication de mes objets et réalisant des séries en petites quantités, le design que j’exerce active le territoire dans lequel le projet est ancré. L’ensemble de ces critères et ces méthodologies me permettent de poursuivre mes engagements au service de la protection de l’environnement.
Les outils et les approches propres à la discipline du design questionnent ce qui est déjà construit sur un territoire. Les conceptions apportés par les designers aboutissent certes à de nouveaux services et objets, mais ceux-ci sont capables d’accompagner une forme de décroissance, par exemple en remettant au goût du jour d’anciens usages, tels que le jardinage familial et l‘autosuffisance alimentaire.
Pour répondre aux défis du réchauffement climatique, il faut réfléchir aux nouvelles manières de produire et de consommer, et se questionner sérieusement sur nos véritables besoins. Et si nous commencions par voir le dérèglement climatique non pas comme une fatalité, celle d’un système en train de s’effondrer, mais comme une opportunité, celle d’un monde entier à réinventer ? Le design, comme bien d’autres méthodes ou valeurs humaines, a les compétences pour instruire les usages de demain et proposer des outils pour des modes de vies plus respectueux de l’environnement.
Quelques mots pour finir sur ce que vous apporte Kèpos, et sur votre rôle dans la coopérative ?
Képos me permet d’être entourée d’entrepreneurs et petites entreprises partageant la même ambition d’agir dans la transition écologique. Echanger et se réunir enrichit mes connaissances sur le territoire, et m’encourage à faire vivre mes valeurs dans mes activités professionnelles et personnelles. Souhaitant intégrer des collectifs de projet, et répondre à des appels d’offres en commun avec d’autres entreprises, Képos est le meilleur écosystème pour faire grandir mon projet entrepreneurial.
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
9 janvier 2020Projets / Revues de ProjetsCe samedi 11 janvier 2020 se tient à Xirocourt la journée Portes Ouvertes d’Etre éco lié. Rencontre avec Pierre-Antoine Phulpin, un des fondateurs de ce tiers lieu au pied de la colline de Sion !
Qui
êtes-vous ?
J’ai
trente-quatre ans. Je suis né à Nancy, j’ai grandi en région
parisienne, en Côte d’Ivoire et au Gabon, en gardant à l’esprit
mes racines lorraines dans le Saintois où j’ai toujours passé mes
vacances. Un peu plus tard, j’ai rejoint Epinal pour un diplôme
d’ingénieur
ENSTIB
(technologies et industries du
bois) qui m’a amené à exercer pendant trois ans comme cadre de
production dans le domaine du bâtiment agricole en bois du côté de
la Normandie puis de la Loire. Ces expériences professionnelles ne
m’ayant pas pleinement satisfait, c’est après trois mois de
marche du Puy-en-Velay à Compostelle que je décide de créer I
Wood, une menuiserie participative, dans le village familial de
Xirocourt. Depuis, j’explore les approches coopératives, les
logiques de commun, avec une fibre particulière pour l’activation
par le faire.
Comment
en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la question des tiers
lieux ?
Entreprendre
à la campagne peut facilement déboucher sur de l’isolement. C’est
ce qui m’est arrivé et j’ai rapidement eu besoin de retrouver du
contact, de développer mon réseau professionnel. A l’époque,
c’était l’émergence du coworking, avec un espace à Nancy, la
Poudrière, qui m’a permis de me familiariser avec ces logiques
de travail et de partage d’espace. C’était aussi l’occasion de
faire le parallèle avec ce qui se passait à l’atelier, en
particulier la mise en œuvre de l’apprentissage par le faire,
développée dans les fablabs.
Une
fois ces différents éléments mis en relation, a savoir bureaux et
ateliers partagés, vous arrivez très vite au concept des tiers-lieu
que j’ai plaisir à explorer ici et ailleurs depuis. Je retiens
deux éléments essentiels : l’agilité dans la définition
des besoins ou des réponses apportées, et la plus-value du faire
ensemble, d’où naît toujours des idées et des concrétisations
insoupçonnées.
Qu’est-ce
que Etre éco lié ?
Etre
éco lié est une association issue de la rencontre entre deux
acteurs spécialistes de l’habitat léger et de l’animation de
chantiers participatifs, I Wood et Vit
Tel
Ta Nature, qui partagent leurs locaux depuis le printemps
2019. A l’instar d’autres bâtiments publics
désormais inoccupés à la campagne, nous sommes installés dans
l’ancienne école du village de Xirocourt.
Nous contribuons ainsi à la pérennité de ce bien public en
l’entretenant et en l’aménageant.
Nous
souhaitons faire de ce lieu une « fabrique de territoire »
spécialisée sur les questions de l’habitat léger et des basses
technologies (ou low-tech), autrement dit un espace de fabrication
donnant la capacité aux individus et acteurs du territoire de penser
et mettre en œuvre des solutions autour de ces thématiques. Cette
fabrique a vocation à rapprocher initiatives privées, publiques et
professionnelles sur des temps ou évènements particuliers. Nous
imaginons des résidences d’artisans ou artistes dès le printemps
de cette année, de même que des chantiers ouverts au public pour
l’aménagement du lieu.
Que
représente le fait de se trouver en zone rurale pour un tiers lieu
comme Etre éco lié ?
A
certains égards, c’est une forme d’engagement. Le constat étant
que l’essentiel des investissements ou de l’attention des élus
sont portés vers les agglomérations, au détriment des territoires
isolés. Je crois que le plus pénalisant pour nous est le sujet des
transports publics.
A
d’autres égards, c’est une réelle opportunité. Il y a beaucoup
de surface disponible pour des prix très inférieurs à ceux que
l’on trouve en ville. Il y a également beaucoup de matériaux ou
de matériel facilement mobilisables et une culture de la débrouille,
du faire soi-même, de la coopération typique de la campagne.
L’enjeu serait de rapprocher des jeunes à la recherche de
savoir-faire, et des anciens isolés ayant l’envie de partager les
leurs. Les lieux de rencontre ont presque disparu et il y a une
réelle attente pour des alternatives, autant concernant les locaux
que les citadins en recherche d’un bol d’air frais.
Vous
travaillez notamment sur la question de l’habitat nomade. Quel est
l’intérêt de telles installations ?
On
pourrait aussi parler d’habitat réversible, ou léger, ou
minimaliste, et même insolite. Concrètement chez nous, ça se
traduit par des cabanes enterrées ou dans les arbres chez Vit Tel Ta
Nature, et des yourtes ou charpentes légères chez I Wood. Avec Etre
éco lié, nous souhaitons développer le concept d’habitat
minimaliste autonome et réversible, avec deux terrains
d’expérimentation, l’un sur le parc à cabane de Vittel, l’autre
sur le Verger de Vincent, un verger partagé à Xirocourt autour de
l’abondance vivrière.
Il
y a différents intérêts à ces installations. Le premier est
qu’elles sont réversibles, c’est dire qu’elle ne dégradent
pas le terrain sur lesquelles elles sont implantées. On peut les
retirer sans laisser de traces. Le second est justement qu’elles
sont mobiles. C’est une excellente façon de répondre à la
contrainte de l’habitat lorsque l’on est de passage, de quelques
mois à quelques années, de même que pour un projet d’habitation
pérenne où l’habitation légère va permettre d’occuper tout de
suite et confortablement l’espace et d’engager les travaux
sereinement. Nous privilégions des techniques appropriables par
tous, plutôt avec les matériaux naturels ou de réemploi
disponibles, pour faciliter la construction et l’entretien. Et sans
que ce soit au détriment du confort ou de la durabilité, bien au
contraire !
Quelles
sont les perspectives à venir pour vous et Etre éco lié ?
Dès ce samedi 11 janvier 2020, à partir de 10h30, les portes ouvertes du tiers lieu au 22 rue du Commandant Dussaulx à Xirocourt. De mon côté, je vais basculer mes activités professionnelles sur des sociétés coopératives, dont Kepos pour des prestations de service, et Vit Tel Ta Nature pour la construction. Une part de mon temps sera consacré au local, notamment avec le développement d’Etre éco lié, une autre à des déplacements sur des projets d’occupation temporaire qui m’apportent toujours une bonne dose d’inspiration.
Pour Etre éco lié, nous rencontrons sur le Saintois et alentours depuis novembre les futurs partenaires et contributeurs du tiers lieu. Nous souhaitons monter d’ici au mois de juin un projet solidement ancré sur le territoire en vue d’une labellisation nationale « Fabrique de territoire » qui nous doterait de moyens non négligeables pour l’activation de ce lieu.
A
partir du mois de mars, nous proposerons différents chantiers
participatifs. Il y aura une première tranche d’aménagement des
locaux, la fabrication d’un zome (une structure énergétique), et
celle d’un « village nomade ». Ces chantiers sont un
support pour fédérer une communauté autour du lieu, partager des
savoirs faire, faire la démonstration des possibilités associées à
une fabrique de territoire.
Merci et bon vent !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
18 novembre 2019Projets / Revues de ProjetsLa Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Energéthic a pour mission le développement des énergies renouvelables en Grand Est. Son dirigeant, Dominique Isler, nous présente son activité et ses projets.
Pouvez-vous nous présenter la SCIC Energéthic ?
Energéthic est une coopérative créée par des entrepreneurs qui souhaitent promouvoir les énergies renouvelables sur le territoire lorrain, et la région Grand Est.
Pourquoi avoir créé cette activité sous la forme d’une SCIC ?
Ce statut permet de regrouper les collectivités, la population, et tous les acteurs d’un territoire dans un pacte d’associés, afin de se donner colectivement les moyens de développer les Energies renouvelables (ENR) sur nos territoires. En bref, rassembler les ressources de tous les acteurs d’un territoire au service des ENR.
Vous installez votre première centrale photovoltaïque. Pouvez-vous nous présenter cette opération ?
C’est une centrale photovoltaïque de 36 kWc (KiloWatt crête), qui va produire 34 500 kWh (Kilowatt heure), soit l’équivalence de la consommation annuelle de 12 pavillons. Nous installons les panneaux sur la toiture du foyer rural de la commune de Lelling. Nous avons signé une convention d’occupation de la toiture sur 30 ans à titre gratuit. La commune de Lelling nous rejoint au capital et co-développe le projet avec nous.
Quel est l’intérêt d’ouvrir le financement d’une telle opération au grand public ?
Il y a un double intérêt :
Une finance circulaire par laquelle le financement par la population permet le développement économique des projets et la création d’emplois, ce qui entraîne création de valeur et redistribution des bénéfices au bénéfice de la population.Le programme Climaxion, porté par la Région Grand Est et l’ADEME, subventionne des projets coopératifs de ce type.
Quel est le rôle des énergies renouvelables dans la transition énergétique ?
Il y a deux impératifs :
L’absolu nécessité de réduire nos émissions de carbone : les ENR ont un bilan carbone non nul, mais bien meilleur que les énergies fossiles . La baisse des ressources en énergies fossiles : les ENR sont renouvelables par définition, les techniques maîtrisées, et il n’y a donc pas de pénurie à prévoir.
Quelles sont les limites des énergies renouvelables, en particulier du solaire photovoltaïque, dans la perspective de la transition énergétique (intermittence, recyclage…) ?
L’intermittence est un sujet qui pose encore un problème. Il n’y pas encore de solution de stockage suffisamment fiables et peu coûteuses en fabrication. C’est pourquoi nous ne vendons pas du rêve en promettant une indépendance énergétique à 100 %. Nous proposons plutôt une mixité des énergies, afin de réduire immédiatement les émissions de CO2. Les clients se protègent également de la monté des prix de l’énergie, car ils ont acquis une part d’ENR dont le prix n’augmentera pas dans le temps. Nous arrivons en fonction de la sobriété des bâtiments jusqu’à 80 % d’autonomie avec les énergies solaires.
Pour le recyclage, la filière s’organise, car la ressources commencent à devenir intéressante pour un industriel. Il n’y pas de problème technique, mais les premiers panneaux arrivent seulement maintenant en fin de vie. Le rendement de production est aujourd’hui garanti 25 ans pour des panneaux de qualité, avec une durée de production d’énergie autour de 40 ans.
Intervenez-vous également sur la question de la sobriété énergétique, des économies d’énergie ?
La bataille des émissions de CO2 se gagnera si on arrive à maîtriser nos consommations énergétiques. Pour maîtriser il faut les connaître précisément, et non pas seulement savoir sa consommation annuelle. Nous installons du comptage low tech afin de détailler le type de consommations (éclairage, chauffage, ventilation, équipements ménagers ou industriels, etc.. ) afin de vérifier la bonne utilisation de l’énergie, et donner les connaissances aux clients, pour qu’ils chassent le gaspillage énergétique et deviennent acteurs de la transition. Ces comptages sont adaptés pour l’habitation, les copropriétés, les bâtiments publics, les bureaux, les commerces et jusqu’à l’industrie.
Quels sont vos projets de développement ?
Ils sont de trois ordres :
Développer un outil de création d’alertes automatiques de surconsommation, qui arriveront chez le client et nos services de comptage, afin de pouvoir intervenir immédiatement. Développer les centrales de production citoyenne. Nous avons gagné un appel d’offre de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) pour une centrale photovoltaïque sur un hangar agricole de 1100 m² en Moselle. Nous le financerons avec les citoyens et les collectivités au premier semestre 2020. Et nous avons des projets d’achat d’éoliennes, et de co-développement d’usine de méthanisation. Nous souhaitons en plus de nos prestations d’installations, et de conseils, développer deux centrales de productions ENR par an. Nous engendrons beaucoup trop de déchets lors de nos travaux d’installations. Nous souhaitons mettre en place avec nos fournisseurs pour la fin de l’année 2020 un programme de réduction et/ou de valorisation de nos déchets
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
4 juin 2019Projets / Revues de ProjetsL’assembleuse est un collectif de développeurs web engagés dans la transition écologique. Kèpos lui a confié la réalisation de son site Internet. Son initiatrice, Claire Zuliani, nous présente sa démarche au service de la sobriété numérique.
Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Claire, bretonne de naissance, myope, trentenaire, jeune mère et professionnelle du web engagée. Après avoir travaillé dans l’associatif, je me suis reconvertie il y a quelques années dans le développement web, en cherchant à insuffler à ma pratique du code un supplément d’âme.
Qu’est-ce que l’Assembleuse ?
L’assembleuse, c’est une agence informelle, un collectif de professionnel·les du web qui a pour ambition d’outiller les projets issus des mouvements de transition (écologique, sociale, solidaire…). Pour l’expliquer rapidement : la plupart des sociétés capitalistes et destructrices ont les moyens de s’équiper d’outils, notamment numériques, de haute volée. Elles peuvent communiquer à large échelle, automatiser leurs processus, faire développer les outils qui leur permettent d’être encore plus efficaces. Ce n’est généralement pas le cas des alternatives, plus petites, plus fragiles ou plus soucieuses d’éthique, qui sont pourtant les projets que je souhaite voir gagner en ampleur. Alors, à son échelle, l’assembleuse accompagne et outille ces initiatives pour les rendre plus fortes. L’assembleuse, c’est en quelque sorte le vaisseau à partir duquel se déploie le projet politique (au sens large du terme) que je souhaite allier à ma pratique professionnelle !
Comment définiriez-vous votre approche du développement informatique ?
En quête de sobriété et de responsabilité ! Pour moi, les outils informatiques doivent rendre autonome et non dépendant, tout en étant le moins néfaste possible pour la planète et le vivant. Cela passe par ne développer que les briques logicielles strictement nécessaires, faire en sorte que les sites développés soient accessibles sur un maximum de terminaux (pour lutter contre l’obsolescence programmée), construire des services web aussi léger que possible (se passer de serveur quand c’est possible, minimiser le nombre de requêtes, être vigilant sur le poids des images, etc), éviter autant que possible de recourir aux services de Google, Amazon, Facebook et consorts et publier du code ouvert !
Comment en êtes-vous arrivée à vous poser la question de la sobriété numérique ?
Avant de travailler dans le web, j’ai passé quelques années dans le secteur associatif et culturel, et j’ai gardé pendant ma reconversion la fibre engagée qui m’avait fait aller initialement vers l’associatif. Une fibre écologiste s’est ajoutée au fil des ans, face à des perspectives d’effondrement de plus en plus palpables. Il se trouve que je ne suis pas très forte pour faire pousser des arbres, par contre je sais créer des sites et des applications web;) Alors pour le moment, je continue à le faire, mais en faisant en sorte de minimiser autant que possible l’impact négatif de mon activité numérique. La question de la sobriété numérique est donc venue assez naturellement ; et j’ai pu m’appuyer pour améliorer mes pratiques sur les travaux que mènent depuis déjà plusieurs années des professionnels réunis autour de l’écoconception web (voir le collectif numérique responsable Green It ou la veille faite par le même Green It, par exemple). Merci à ces communautés d’exister !
Quels sont de votre point de vue les grands enjeux écologiques du numérique ?
Ne pas se tromper de combat ! Améliorer la performance des sites, minimiser le poids des images, mettre en cache un maximum de contenus… c’est bien. Mais en fait, c’est l’extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des ordinateurs et téléphones qui est la plus destructrice écologiquement (voir les conclusions du rapport du Shift Project à ce sujet) ! La priorité pour moi est de contribuer à réduire la fabrication des terminaux, en améliorant leur durée de vie (ne pas mettre en ligne un site qui nécessite la puissance du tout dernier smartphone pour être utilisable par exemple) et en les rendant moins indispensables.
Gardons en tête que l’outil numérique le plus sobre est encore celui qu’on ne créée pas:) A mon sens, il faut avant tout lutter contre le solutionnisme technologique, cette croyance qu’il suffit d’un site web, un service en ligne, des robots ou des fusées, pour résoudre tous les problèmes de la terre. C’est en travaillant à changer les mentalités et les usages qu’on arrivera petit à petit à se défaire du numérique, et c’est là que son empreinte sera la plus minime.
Dès lors, quelles sont les pratiques à privilégier ?
Il y a des pratiques qui sont de bonnes pratiques numériques individuelles, tout comme couper le robinet quand on se brosse les dents est une bonne pratique. Plutôt transmettre par mail un lien vers une pièce jointe que la pièce jointe (surtout si le mail est adressé à de nombreux destinataires), privilégier quand c’est possible l’écrit sur l’image et la vidéo pour économiser la bande passante… Pour les professionnels du numérique, le livre Ecoconception Web est une bonne référence pour les bonnes pratiques.
Je crois que ce qui aura plus d’impact, c’est une action à un niveau plus collectif, plus systémique, tout ce qui nous permet d’utiliser moins et/ou plus intelligemment le numérique : limiter son usage des GAFAM, soutenir les alternatives numériques (logiciels libres, Framasoft, Chatons, fournisseurs d’accès associatifs…)… Soutenir toutes les initiatives qui visent à promouvoir un autre modèle de société, où les stratégies numériques de captations et revente des données des utilisateurs, de tracking de leur activité, de monétisation du temps passé devant un écran seront rendues caduques.
Pouvez-vous nous préciser les grands partis pris qui ont été retenus pour le développement du site de Kèpos ?
Pour le site de Kèpos, c’est Jekyll, un générateur de site statique historique, qui a été utilisé. Le site est statique, c’est à dire uniquement constitué de pages html qui ne sont pas générées dynamiquement au fur et à mesure qu’un utilisateur visite le site, mais une bonne fois pour toutes au moment où le site est déployé sur un serveur. C’est un retour au web des origines ! Il n’y a pas de base de données, pas de requêtes incessantes à un serveur web, ce qui améliore la performance et la sécurité du site, mais aussi son empreinte écologique. Un système de gestion de contenu, Forestry, y a été adjoint pour faciliter la rédaction des pages.
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
6 mai 2019Projets / Revues de ProjetsAnne Blanchart, docteure spécialiste des sciences du sol et de l’urbanisme, est sur le point de lancer un cabinet de conseil, nommé Sol & Co, qui vise à faire intégrer la question de la préservation des sols et de leur biodiversité dans les politiques d’aménagement du territoire. Elle nous présente sa démarche.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
J’ai obtenu mon baccalauréat scientifique option Sciences de la Vie et de la Terre en 2008. Ensuite, j’ai effectué une première année de classe préparatoire aux grandes écoles spécialité Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre puis me suis réorientée dans un cursus universitaire dès l’année suivante. En 2012 j’ai ainsi obtenu une Licence de Génie Géologique et Génie Civil, décernée par la faculté de Bordeaux 1. Passionnée par l’aménagement du territoire, j’ai choisi de réorienter mon cursus universitaire en suivant un Master en Urbanisme, spécialité Villes Durables, à l’Institut Français de l’Urbanisme à Champs-sur-Marne. Suite à ce parcours universitaire, j’avais pour ambition de travailler au sein d’un bureau d’études de conseil en environnement pour l’aménagement du territoire. J’ai ainsi occupé un poste de chargée de mission au sein d’un bureau de paysage pendant un an. En 2015, j’ai postulé à une thèse interdisciplinaire sur le sujet des sols et de l’aménagement du territoire, proposé par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (Ademe) et la Région Grand Est (anciennement Région Lorraine). J’ai eu la chance d’effectuer ce travail de doctorat de 2015 à 2018 au sein du Laboratoire Sols et Environnement (Université de Lorraine – Inra) et de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (Aix-Marseille Université). Ce travail de recherche interdisciplinaire m’a permis de conjuguer les intérêts que je portais pour le domaine des sciences du sol et de l’urbanisme, me permettant logiquement de faire le lien entre ma Licence, mon Master et mon expérience professionnelle dans l’aménagement du territoire.
Vous créez un cabinet conseil sur la question des sols : quelle en sera la mission ?
Effectivement, peu de temps après avoir débuté mes travaux de recherche en doctorat, j’ai très vite perçu l’intérêt sur le marché que pourrait présenter un cabinet de conseil sur la question du fonctionnement et de la qualité des sols en milieu urbain, dans le but d’aiguiller les prises de décisions des professionnels de l’aménagement du territoire quant à l’usage à donner aux sols des villes de demain, qui se veulent durables et résilientes. Depuis quelques mois maintenant, je porte un projet de création d’une entreprise spécialisée sur la thématique des sols et de leur biodiversité en milieu urbain. Ce projet est actuellement en incubation (Incubateur Lorrain, Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine) et devrait voir le jour courant juin 2019.
La philosophie de l’entreprise est intimement liée à la transition écologique et aux respects des valeurs durables et de protection des ressources naturelles lors de l’aménagement d’un territoire. Le message principal est le suivant : les sols sont des systèmes en trois dimensions (volume) et dynamiques (vivants) qu’il faut veiller à préserver compte tenu des bienfaits qu’ils sont aptes à fournir pour le bien-être des habitants mais également pour les réponses qu’ils apportent à un nombre élevé d’enjeux environnementaux. Par exemple, les sols, y compris en milieu urbain, et si leur usage est compatible avec leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques, sont aptes à participer à la régulation des inondations (infiltration de l’eau), du changement climatique (stockage de carbone) ou encore de la biodiversité (les sols urbains sont un formidable réservoir de biodiversité !).
Concrètement, quelles en seront les activités ?
L’entreprise sera spécialisée sur l’intégration de la qualité des sols et de leur biodiversité dans la définition de leurs usages en milieu urbain. Plus précisément, il est convenu que l’entreprise propose trois prestations :
Une prestation de conseil auprès des collectivités territoriales, élus, et professionnels de l’aménagement du territoire : grâce à des interventions sur des sites de projets urbains, l’entreprise sera en mesure de développer un plan d’échantillonnage représentatif de l’hétérogénéité des sols en place, d’ouvrir des fosses pédologiques, de décrire et d’échantillonner des profils de sols, de réaliser des analyses biologiques, physiques et chimiques sur les échantillons prélevés et de donner en retour des recommandations aux acteurs de l’aménagement quant à l’usage optimal que peut accueillir le sol sans avoir à l’amender fortement ou bien également quant à la manière dont le sol doit être travaillé pour fournir ses bienfaits sur le long terme. Cette prestation peut s’adapter à un public de particuliers, souhaitant recueillir des informations sur le fonctionnement et la qualité des sols de jardins ;
Une prestation de formation auprès des agents de collectivités territoriales, d’associations ou encore d’acteurs de l’aménagement du territoire (aménageur, bureaux d’études, agences d’urbanisme et de paysage) : à travers des ateliers de formation d’une durée adaptée, des informations et compétences pourront être données quant au fonctionnement et aux besoins (paillage, amendements, tonte, etc.) des sols urbains (jardins, parcs, pieds d’arbres, espaces verts, etc.) en fonction de leurs caractéristiques biologiques, physiques et chimiques. Des formations seront également proposées quant à la manière dont il est possible de travailler les sols en place pour qu’ils répondent aux besoins des sociétés humaines, tout en préservant voire améliorant leurs caractéristiques biologiques, physiques et chimiques ;
Une prestation d’animation et de médiation scientifique à l’attention du grand public en général, mais également des acteurs de l’aménagement et des élus : conférences, tenues de stand et animations de « sciences participatives ». Ces évènements contribueront à l’accompagnement et plus fortement à l’implication des citoyens, des professionnels et des élus dans la préservation des sols et de leur biodiversité. Ils participeront également à lutter contre l’isolement de certaines populations du territoire en situation de défaveur sociale et offriront un accompagnement à l’éducation des plus jeunes -la biodiversité étant aujourd’hui une thématique intégrée dans leur programme scolaire. Par exemple, plusieurs ateliers pourront être proposés : évaluer la qualité physique de son sol (texture, structure, infiltration de l’eau) ou bien connaitre la biodiversité qui se cache sous son sol (prélever et analyser les différents organismes qui vivent dans son sol selon le protocole de Jardibiodiv). Ces ateliers permettront d’une part la sensibilisation du citoyen à une thématique particulière ainsi que l’élargissement de ses connaissances, mais également à l’apport d’informations à la recherche pour compléter notamment les bases de données issues des sols urbains, qui comportent encore aujourd’hui trop peu de données pour établir des référentiels robustes.
Votre activité a un très fort ancrage scientifique. Pouvez-vous nous préciser selon quelles modalités ?
Ce projet de création d’entreprise est dès le départ en fort lien avec le monde de la recherche scientifique. L’idée même de la création de cette entreprise provient de mon travail de recherche effectué au cours du doctorat, ainsi que de celui de Quentin Vincent, effectué également au cours de son doctorat mené au sein de l’Université de Lorraine. Pour renforcer ce lien, il est à noter que l’entreprise bénéficie de l’appui scientifique de trois enseignants chercheurs issus du Laboratoire Sols et Environnement et de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (Aix-Marseille Université). Cet ancrage avec le monde de la recherche scientifique permet aujourd’hui au projet de bénéficier d’un accompagnement de l’Incubateur Lorrain (Université de Lorraine).
De cette manière, l’entreprise continuera de garder durablement un fort lien avec le Laboratoire Sols et Environnement. Cela permettra d’une part de reverser l’intégralité des données (sous accord du client) au Laboratoire et donc à la recherche, afin d’alimenter les bases de données nationales sur les sols urbains et la biodiversité ; et d’autre part de permettre à l’entreprise de disposer d’un atout incontestable sur le marché, celui de proposer des méthodologies et technologies sans cesse innovantes, issues des avancées directes de la recherche en sciences du sol et en urbanisme.
Pourquoi la question des sols est-elle cruciale dans la perspective de la transition écologique ?
Les sols sont une ressource naturelle non renouvelable. Ce sont des systèmes hétérogènes certes, mais vivants et offrant de nombreuses réponses aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain : ils sont capables d’infiltrer l’eau, de produire de la biomasse à vocation alimentaire et d’être un formidable lieu d’habitat pour une riche biodiversité. Puisque les sols rendent un panel de bienfaits aux sociétés humaines… pourquoi ne pas en prendre soin à notre tour ?
Aujourd’hui, l’eau et l’air disposent de mesures réglementaires qui permettent leur « protection » sur le territoire national. Ce n’est actuellement pas le cas des sols. Si leurs paramètres géotechniques et leur niveau de pollution doivent être pris en compte pour le développement d’un projet urbain, la considération des sols s’arrête là dans l’aménagement du territoire. Prendre en compte les caractéristiques biologiques, physiques et chimiques des sols urbains dans la définition de leurs usages permettrait alors d’optimiser les bienfaits qu’ils peuvent effectivement rendre (en mettant le bon usage sur le bon sol) et donc d’optimiser les réponses que ces systèmes naturels apportent aux enjeux environnementaux et plus largement durables. De la même manière, adapter l’usage aux sols et non plus l’inverse permettra de réaliser une économie de gestion de cette ressource lors de la phase chantier (limitation des apports de terres issues des milieux plus naturels) mais également sur le long terme (gestion des espaces verts notamment).
Quels sont les enjeux en matière de préservation des sols urbains ?
Ils sont nombreux ! Il est essentiel de se rendre compte que les sols urbains ne sont pas des systèmes illimités et que c’est une ressource dont la qualité tend peu à peu à s’affaiblir. Le besoin de construction de nos villes et la protection accrue réservée aux sols agricoles et forestiers, jugés plus naturels, font que les sols des villes se trouvent de plus en plus malmenés. Et pourtant, un sol en ville peut tout à fait être fertile, à l’instar, voire plus, qu’un sol agricole. Cela dépend de son histoire et de la constitution de la roche mère. Puisque les sols sont une ressource non renouvelable, il s’avère essentiel aujourd’hui de les protéger et de limiter la dégradation de leur qualité. Pour cela, il faut prendre conscience qu’un sol, y compris urbain, fonctionne bien et sur le long terme à condition que l’usage qui lui est réservé soit adapté à ses caractéristiques biologiques, physiques et chimiques.
Compte tenu du fait qu’il n’existe pas encore aujourd’hui de réglementation sur la prise en compte de la qualité des sols dans la définition de leurs usages, l’enjeu primordial est de sensibiliser les élus et décideurs sur cette thématique, afin de pouvoir tendre, un jour, à l’élaboration d’un cadre national sur la protection des « sols », au même titre que l’eau et l’air.
Le deuxième enjeu principal est l’accompagnement des acteurs de l’aménagement à la prise en compte de la qualité des sols. En effet, ces acteurs ne sont pas des professionnels des sciences du sol et il est donc essentiel que la recherche, mais également des entreprises de conseils, se développent pour œuvrer à la constitution d’outils d’aide à la décision permettant de faciliter l’intégration de cette nouvelle information dans les processus de décision qui guident le développement d’un projet urbain ou encore la rédaction d’un document d’urbanisme.
Enfin, un troisième enjeu principal qui pourrait être énuméré est la sensibilisation du grand public en général, notamment sur des thématiques en lien avec la santé, telle que par exemple l’alimentation. A l’heure du « boom » des jardins partagés et familiaux, il serait nécessaire avant tout aménagement d’un potager à l’arrière de nos jardins, que des analyses de sols soient fournies par la collectivité ou soient effectuées, afin de s’assurer de la non présence de polluants dans les sols qui pourraient se retrouver dans les parties aériennes de la biomasse cultivée et consommée par les citadins.
Pouvez-vous nous citer quelques bonnes pratiques de gestion des sols urbains ?
Les bonnes pratiques de gestion des sols urbains sont intrinsèquement liées à la composition même du sol urbain, à son fonctionnement et à son usage. Je dirai donc qu’il y a autant de bonnes pratiques de gestion qu’il n’y a de sols en milieu urbain !
Le message principal à retenir serait selon moi le fait que les sols ne sont pas seulement des supports sur lesquels nous pouvons vivre, mais sont également des systèmes en trois dimensions qui participent à notre survie. En milieu urbain, les sols sont hétérogènes et pour garantir leur bon fonctionnement, leur protection mais également la qualité des bienfaits qu’ils sont aptes à fournir, il apparait nécessaire de réaliser de manière systématique des évaluations de leurs propriétés biologiques, physiques et chimiques avant d’en déterminer leurs usages.
Merci et à bientôt !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
28 janvier 2019Projets / Revues de ProjetsSébastien Manteau conseille les viticulteurs en matière de viticulture alternative. Installé en Champagne, il a baptisé son activité AlternatiVity. Ou comment cultiver la vigne sur sol vivant.
Qui êtes-vous ?
Je suis fils de Viticulteur. J’ai toujours aimé les plantes… Je crois me souvenir que petit, je disais à mes parents que je voulais être Chercheur.
J’ai un Master 2 en Œnologie et Ampélologie (la science de la Vigne) et un Doctorat en Biochimie végétale sur les maladies de la vigne. J’ai travaillé pendant 11 ans comme Chargé de Recherche en Œnologie. Licencié, j’ai décidé de revenir à mes premières amours !
En parallèle de cela, j’ai acheté une maison. Le terrain avait été décaissé et je me suis retrouvé à jardiner dans de l’argile pur. Mettant en pratique mes connaissances scolaires, j’ai totalement échoué. Je me suis mis à chercher ce qui n’allait pas. Sur Internet, j’ai découvert la Permaculture. Les connaissances techniques et les valeurs de cette « philosophie » ont comblées tout de suite toutes mes attentes ! Les pièces du puzzle s’assemblaient dans ma tête : j‘allais faire du Conseil et de la Formation en Viticulture alternative !
Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la viticulture alternative ?
C’est surtout grâce à mon père que je me suis intéressé à cela. Alors que j’étais au Lycée, je me rappelle de lui en train de remuer des produits. Il avait la tête au dessus d’un seau et il remuait avec un bâton en bois dans les mains. Il allait utiliser ce mélange pour traiter la vigne. Je regarde le bidon de ce produit et je lui dis : « Regarde ce qui est écrit ici ! Tu ne devrais pas faire ça ! Moi, quand je suis au lycée pour mélanger un tel produit, je suis avec une blouse, des lunettes de protection, des gants. Et surtout, je suis sous une hotte ou avec un masque ! » Lui de me répondre : « Penses tu ! Tu dis n’importe quoi, le technico a dit qu’il n’y a pas de problème ! ». J’ai enterré mon père l’an passé. L’espérance de vies des Français est de 79 ans et demi. Il en était très loin. Et à vrai dire, je ne connais vraiment que très très peu d’agriculteurs ou de viticulteurs qui soit arrivé à cet âge… Je veux pouvoir me promener l’été dans la nature, dans les vignes avec ma fille. Sans craindre pour sa santé parce que ça pue et qu’il y a des produits nocifs et cancérogènes tout autour de nous ! Il faut que tout cela change !!!… et le plus vite possible.
Quels sont les avantages et les limites de la viticulture alternative par rapport aux pratiques conventionnelles ?
La viticulture alternative telle que je l’entends est basée sur la Permaculture, l’Agroécologie et les sols vivants. Commençons par les limites de ces méthodes car elles sont assez simples en fait. Il y a quelques limites techniques, mécaniques et de connaissances. Celles ci sont facilement « dépassables » grâce à des formations, l’achat ou la conception de matériel adapté, une mise en réseau et de l’entraide viticole. Mais la limite la plus importante reste la limite psychologique ! La peur de l’inconnu, de ce que va dire le voisin, de rompre la loyauté vis à vis de nos parents, anciens…
Pour les avantages, c’est un peu plus complexe en fait… car nous ne les connaissons pas tous encore ! Il semble que tous les légumes cultivés en sol vivant sont plus riches en goût, minéraux, et vitamines. Les raisins et les vins semblent plus complexes et plus riches. La législation imposera bientôt de ne plus utiliser de désherbant en agriculture. Les techniques que j’utilise ont également cet avantage de ne plus en utiliser sans dégrader le sol par des labours ou en le laissant à nu. Il y également les avantages écosystèmiques qui aident à la culture grâce à la faune et la flore. Ces pratiques sont également plus en accord avec ce que demandent les consommateurs. Et enfin, l’avantage le plus important sans doute est que ces techniques permettent de capturer du carbone pour agrader les sols et participer à la limitation du réchauffement climatique.
Comment se positionnent les viticulteurs sur ces sujets ?
C’est là aussi une question complexe… Quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu’à plus de 90%, ils détestent le travail de la vigne. Ce travail est pénible, sans intérêt réel car déconnecté de la nature, avec de plus en plus de contraintes administratives… Ils sont « obligés » d’utiliser des quantités importantes de produits chimiques dangereux pour eux, leurs enfants et la nature afin d’avoir un revenu. Cette viticulture n’a aucun sens !
Mais lorsque vous discutez avec eux de faire évoluer leurs pratiques, la limite psychologique arrive tout de suite. Je ne pense pas que nous puissions faire de généralités sur « les viticulteurs ». C’est un groupe sociologique qui suit les comportements de tous les groupes humains. Il y a ceux qui vont avoir peur, être contre et toujours freiner, les suiveurs qui composent le gros du peloton et les pionniers ou les innovateurs.
Quel est le discours que vous leur tenez afin de faire évoluer leur pratique ?
Afin de faire évoluer leur pratique, je dois comprendre quel est leur point de blocage psychologique. Ensuite, je leur fais connaître et comprendre tous les avantages liés à ce type de viticulture en sol vivant.
Votre approche repose sur une très forte expertise scientifique. Comment cela sert-il votre activité ?
Cette expertise me permet de faire un tri dans toutes les infos sur ces sujets, puis de valider les plus pertinentes. Actuellement tous les scientifiques reconnus vont dans le sens de mes convictions et de ce que je propose...
Vous développez votre activité au sein de la coopérative d’entrepreneurs Synercoop. Vous vous attachez à y mettre en place un pôle de compétences autour de la transition écologique. Quel est l’intérêt d’une telle démarche ?
La encore, plus aucun scientifique ne doute de la nécessité de la transition écologique. Ayant toujours pensé que l’Entraide était une belle valeur, je ne fais que mettre en pratique mes convictions dans ce pôle de compétences autour de la transition écologique. Une telle démarche nous permettra d’aller plus loin, d’être plus efficace et plus résilient vis à vis de cette transition.
Merci à vous et belle transition à tous !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
29 novembre 2018Projets / Revues de ProjetsLe Plan B est une stratégie de structuration des initiatives de la transition sur le territoire nancéien. A l’occasion de son financement participatif, nous mettons un coup de projecteur sur cette action partenariale originale, en rencontrant l’une de ses instigatrices, Pauline Nowik.
Qu’est-ce que le plan B ? Quelle est l’histoire derrière cette initiative ?
Le Plan B Nancy est une stratégie qui vise à faire changer d’échelle les alternatives de l’Économie Sociale, Solidaire et Écologique. Cette stratégie repose sur trois axes : la mutualisation, la professionnalisation et la communauté. Si nous développons ces trois axes, c’est pour répondre à des besoins que nous avons repérés lors de l’organisation du village Alternatiba à Nancy en juin 2015. Plus de cent structures étaient venues sur deux jours présenter leur alternative au changement climatique. Lors de différentes discussions, ces acteurs ont constaté que nos alternatives manquaient de moyens (humains, matériels et financiers), que nous proposions une image “amateur” et que nous communiquions sur nos actions de manière limitée, dans nos cercles d’adhérents. De là, nous avons songé à répondre à ces manques par une stratégie qui se construit depuis 2016.
Ainsi, la mutualisation permettra d’avoir accès à du matériel (vidéoprojecteur, photocopieur, …), des locaux (bureaux, salles de réunions, espace de stockage) et des compétences (comptable, graphiste, …). La professionnalisation se traduira par des formations pour les bénévoles et salariés, de l’accompagnement pour obtenir des financements adaptés et la mise en relation avec des personnes qualifiées (experts en ressource humaine, en gestion financière, en marché public, …). La communauté qui se construit actuellement permettra à chaque membre du plan B de toucher l’ensemble des adhérents pour informer sur la mise en place d’une conférence, d’un atelier, ou d’une action non violente de désobéissance par exemple.
Quels en sont les créateurs ?
Au départ, une poignée de citoyens déjà engagés dans diverses associations et collectifs et aujourd’hui, nous sommes une vingtaine d’associations et une trentaine de personnes engagées à tous niveaux : du petit coup de main ponctuel à l’investissement quasi quotidien.
Quels sont les objectifs ?
L’objectif est de donner les moyens aux citoyens, associations et entrepreneurs de rendre crédibles et désirables toutes les actions, qui, d’une part, luttent pour dénoncer les fausses bonnes solutions, et, d’autre part, proposent et construisent des alternatives. Notre slogan illustre nos ambitions : “de l’alternative à la norme”.
A quoi va servir le financement participatif que vous venez de lancer ?
La campagne de financement en cours va nous permettre d’aménager notre local situé au 51, rue de la République à Jarville. Des travaux sont prévus pour permettre aux premiers utilisateurs d’avoir accès à une salle de réunion, des bureaux, et des espaces de stockage pour faciliter la logistique des associations notamment. Nous achèterons également les premiers matériels et outils à mutualiser, selon les besoins identifiés auprès des adhérents. La campagne se termine le 12 décembre et nous invitons chacun à contribuer, même avec un petit don, car ce qui est important, c’est de montrer que nous sommes nombreux à soutenir le plan B Nancy.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Le 4 décembre prochain, nous accueillons la Nef, la banque éthique, pour une soirée de présentation. Le dimanche 9 décembre, nous organisons des portes ouvertes dans notre local à Jarville afin d’accueillir les curieux et futurs engagés. Après le 12 décembre, selon le succès de la campagne de financement participatif, nous aménageons le local de Jarville et poursuivons notre développement : proposition d’un calendrier partagé des actions militantes, mise en place d’un calendrier de formation, poursuite de la communication grand public, constitution des annuaire de personnes qualifiées, …
Quelle est l’articulation du Plan B avec Képos ?
Képos est le volet économique de notre stratégie. En effet, il s’agit bien de faire bénéficier du plan B aux membres de Képos et inversement. Certains entrepreneurs pourront bénéficier des moyens mutualisé,s par exemple un bureau ou l’accès au photocopieur et de la communauté pour tester leurs idées, et à l’inverse devenir personne qualifiée pour aider au développement de nouvelles alternatives. L’enjeu est de créer un réseau d’acteurs sans concurrence, qui se nourrit des réussites et idées des uns et des autres.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
7 novembre 2018Projets / Revues de ProjetsCécilia Gana est la créatrice et la gérante du magasin Day by Day de Nancy, épicerie spécialisée dans la vente en vrac. A l’heure où de nouvelles formes de commerce apparaissent, elle nous présente son activité et la conduite de son projet.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Cécilia Gana, je suis née à Nancy, et suis aujourd’hui la gérante d’une épicerie 100 % vrac.
Comment en êtes-vous arrivée à créer une épicerie en vrac ?
Depuis toute petite, j’ai été sensibilisée à l’écologie, à la protection de l’environnement et à l’anti-gaspi (grâce à ma famille notamment). Après de longues études, orientées vers l’écologie et m’ayant mené jusqu’au doctorat, j’ai souhaité me diriger vers un métier plus concret, utile au quotidien et surtout qui ait du sens, avec un contact humain plus présent. Ayant conscience du problème de la pollution et essayant de réduire nos déchets, nous trouvions dommage, avec des amis, qu’il n’y ait pas de magasin dédié au vrac sur Nancy. Et je me suis donc lancée dans l’aventure en créant mon entreprise et en ouvrant le magasin.
Pouvez-vous nous décrire plus précisément votre activité ?
Day by day est une épicerie 100 % vrac, où les clients peuvent venir avec leurs contenants, afin de limiter les emballages (je fais la tare avant). Des contenants sont également disponibles sur place et gratuits (sacs en papier compostables et bocaux). On ne prend que la quantité dont on a besoin afin de limiter le gaspillage. Tout y est vendu au détail (les prix sont indiqués au kilo) : épicerie salée (pâtes, légumineuses, riz, gâteaux apéritifs, huiles, vinaigres,…) ; épicerie sucrée (sucres, sirops, céréales, fruits secs, farines, biscuits, chocolats, café, thé,…) mais également des produits d’entretien (vinaigre, bicarbonate, savon de Marseille, lessives, liquide vaisselle…) et d’hygiène (shampooing, déodorant et dentifrice solide)
Comment voyez-vous les attentes du grand public, et de votre clientèle en particulier, en matière de zéro déchet et de vente en vrac ?
Dans le vrac, chacun peut trouver son compte : certains viennent parce qu’ils souhaitent avant tout réduire les déchets d’emballage, d’autre plus pour le côté « je ne prend que ce dont j’ai besoin », donc pour moins gaspiller, mais aussi varier les menus. Et enfin il y a aussi le côté économique du vrac : consommer en vrac permet de faire jusqu’à 30 % d’économie si l’on compare avec des produits équivalents emballés. Ce que les gens recherchent aussi, c’est la traçabilité des produits, savoir d’où ça vient, comment c’est fait. Nous sommes donc très attentifs à cela et indiquons l’origine de chaque produit. Nous connaissons bien nos producteurs et fournisseurs, nous savons comment ils travaillent et on peut ainsi l’expliquer aux clients.
Vous avez fait le choix de créer votre activité en franchise. Quels sont les atouts et les limites de cette solution ?
Comme je n’étais pas issue d’une formation autour du commerce, je trouvais ça utile d’être accompagnée par la franchise. Pour convaincre une banque de m’octroyer un prêt, c’était aussi un petit plus de dire que j’allais être franchisée. Faire partie d’un réseau, quand on est commerçant indépendant, est aussi rassurant : on se sent moins seul, on échange souvent, on partage des astuces et bonnes pratiques entre franchisés. La franchise apporte aussi plus de visibilité, avec par exemple un site internet que je n’aurais jamais pu faire et financer en n’étant pas franchisée. L’accès également à autant de références (avec plus de 80 fournisseurs différents) aurait été impossible, je n’aurais pas pu proposer autant de produits seule. Bref, pour moi, ce ne sont que des avantages, je n’y vois aucun inconvénient ! D’autant plus que c’est un petit réseau, à taille humaine : chacun a son mot à dire, les franchiseurs sont à l’écoute de tous les gérants d’épicerie, nous travaillons ensemble. Si on veut que le vrac se développe, je pense qu’il faut aussi travailler en réseau, pour avoir plus d’impact vis à vis des fournisseurs, leur faire changer leurs modes de conditionnement, mais aussi gagner plus de visibilité vis à vis du grand public. Le bio par exemple est en plein essor et s’est fait connaître de tous grâce aux réseaux de magasins spécialisés dans les produits bio.
Les magasins de vente de vrac commencent à se multiplier : ça vous inquiète ou ça vous enthousiasme ?
C’est très encourageant, le fait que le vrac se développe. On trouve maintenant du vrac dans à peu près toutes les grandes surfaces, mais de plus en plus de magasins dédiés au vrac se développent. Je pense qu’il y a de la place pour tous et que plus on sera nombreux, plus les gens pourront facilement adopter le vrac, réduire leurs déchets, en parler autour d’eux et convaincre d’autres personnes de passer au vrac.
Quelques mots sur vos prochaines perspectives ?
Continuer à développer la gamme de produits proposés (à mon ouverture, j’avais 650 références, aujourd’hui, j’en ai quasi 850). Essayer de proposer d’avantages de produits français (aujourd’hui 60 % des références) et si possible bio (un peu plus d’1/3 des produits proposés en magasin à l’heure actuelle). Faire en sorte que le vrac se développe de plus en plus. Sensibiliser les gens à la réduction des déchets (continuer à proposer des ateliers avec des partenaires locaux autour du « mieux consommer » et « réduire ses déchets »)
Merci !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
12 octobre 2018Projets / Revues de ProjetsFélix Billey est un jeune ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques et Industries du Bois, basé à Besançon. Inventeur et entrepreneur, il a plusieurs cordes à son arc : conception d’un vélo amphibie, création d’une maison tractable en bicyclette, fabrication et vente de boucles d’oreille en plumes naturelles… Il nous présente ses sources d’inspiration et le sens de son travail de conception et de fabrication d’objets low tech ou inspirés de la nature, posant ainsi la question de la place des technologies dans la transition écologique.
Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
J’ai 24 ans et toutes mes dents.
Quelles sont vos principales activités d’inventeur et d’entrepreneur ?
Actuellement, je conçois et fabrique une sorte de petite maison roulante tractable par un vélo. J’ambitionne de vivre quelques temps dedans. Je l’ai baptisée la BikeHouse. C’est un peu un clin d’œil aux start-up ou accélérateurs de projets en tout genre. Non pas que je ne crois pas à tout cela, mais je suis convaincu que, pour mettre au point quelque chose de fondamentalement nouveau, ou quelque chose de fou, où l’on se dépasse, où l’on va plus loin que ce que l’on peut même imaginer, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et si le numérique donne parfois le sentiment que l’on peut tout avoir instantanément, j’ai l’impression que c’est un leurre, qui nous rend passifs et consommateurs. Partir à la conquête ou reconquête de ma spontanéité c’est un peu l’objectif de la BikeHouse, c’est mon incubateur personnalisé, en tant qu’inventeur, qui me laissera le temps d’approfondir des choses très intimes. C’est une échappatoire, un outil me permettant de cultiver mon jardin secret.
Imaginez-vous : être un arbre… Si vous évoluez dans un incubateur ou une start-up, vous développerez majoritairement vos branches et votre feuillage : vous êtes en concurrence pour la lumière et vous devez grandir vite pour ne pas être dans l’ombre. A travers la BikeHouse, la démarche est plutôt de développer les racines de mon arbre avant le feuillage. Ma croissance est insignifiante voir presque invisible, mais la particularité, c’est que la ressource principale n’est pas donnée par le ciel, mais par la terre ! Ainsi, en cas de tempête, l’arbre évoluant en start-up sera facilement déraciné car son feuillage est trop gros par rapport à ses racines ; en cas de sécheresse, l’arbre start-up sera beaucoup plus vulnérable car son feuillage est beaucoup plus étendu et ses racines pas assez pour puiser l’eau dans le sol. En bref, la BikeHouse a pour but de donner vie à des idées apparemment non viables dans le système actuel, c’est un peu sa vocation.
Comme quand on apprend à jouer d’un instrument de musique, le début est difficile, et une fois que ça commence à venir, ça devient satisfaisant, c’est plus simple de jouer et ça devient plaisant. Seulement il est très difficile d’arriver au point où cela devient plaisant, car tout ce qui nous entoure tend à nous divertir. Nous avons tendance à choisir la facilité. Quelque part, la BikeHouse a pour but de me plonger dans un inconfort, ou un confort juste suffisant, pour que la pratique de quelque chose d’a priori difficile dans le confort actuel, devienne très plaisant voir nécessaire pour trouver du plaisir ou l’équilibre. En fait, quand l’on est dans le confort, on n’a pas forcément besoin de faire quelque chose, on se contente de ce que l’on a. Rien ne nous incite à sortir de notre situation. Dans l’inconfort de la BikeHouse, je serai obligé de m’activer pour sortir de l’inconfort, pour oublier l’inconfort.
Donc, plus concrètement, mon activité aujourd’hui principale est la fabrication de la BikeHouse. Une fois celle-ci terminée et viable, le temps que je passe sur la BikeHouse se déplacera sur la mise au point d’un vélo amphibie. J’ai aussi des projets de spectacle, et surtout, je veux rester ouvert à l’inconnu. En parallèle, je développe avec une cousine une activité de fabrication et vente de boucles d’oreilles en plumes naturelles. Celle-ci exploite la technique du montage des mouches de pêche. Ça, c’est un peu le feuillage de mon arbre, mais qui ne pousse pas très vite et plutôt difficilement.
Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Pour la BikeHouse je m’inspire de mes besoins propres. Des plus primaires aux plus spirituels. Toutes les conséquences du réchauffement climatique (catastrophes naturelles, sécheresses, disparition d’espèces etc…) sont également des faits qui me pousse à mener mon projet au bout même si il est très marginal, et que j’ai peu de moyens. Pour les boucles d’oreilles, je trouve mon inspiration directement dans la nature.
En tant qu’inventeur, comment travaillez-vous ?
Cela dépend des activités. Généralement, j’opère par cycles. Je m’explique : quand je débute une activité, je lui consacre un tout petit peu de temps, même si quelque fois la motivation est telle que je pourrais travailler presque nuit et jour. Mais je préfère procéder ainsi pour ne pas risquer de me décourager. Ensuite, je libère de plus en plus de temps pour cette activité, jusqu’à atteindre une sorte d’apogée ou elle devient mon activité principale et occupe quasiment tout mon temps. Ensuite, je relance ou reprends une autre activité, qui va relayer petit à petit la première. Mais, attention à ne pas passer d’un projet à un autre sans avancer, fuir la difficulté de l’un en passant à l’autre et vice versa. Je peux imager mes propos avec la métaphore du pied de tomate : si on le laisse pousser tout seul, il produira plein de toute petites tomates ; si on enlève les « gourmands », il produira plusieurs belles tomates ; et si on enlève trop de tige et qu’on ne laisse qu’une seule fleur, il ne produira qu’une seule très grosse tomate.
Pour savoir si un projet me tient à cœur, je tiens une sorte de petit journal dans lequel je mets mes idées, mes réflexions, mon humeur. J’essaie d’être le plus honnête possible. Et quand je décide de lancer une idée, un projet, je reprends ce journal pour voir si l’idée est ancienne ou récente, récurrente ou anecdotique. C’est ce qui me permet de savoir avec plus d’assurance si un projet ou une idée me sera viable ou non dans le futur. Pour revenir au pied de tomate, savoir si c’est un « gourmand » ou si c’est une vraie branche productive.
Dans le développement de la plume à l’oreille, comment abordez-vous l’acte de vente ?
Je fonctionne en allant voir directement les responsables de boutique, et en leur montrant mes produits en vrai. Cela me permet d’observer leurs réactions, leurs observations. J’ai ainsi directement leur réponse. C’est aussi plus simple pour négocier les prix, et les formalités de vente, d’exposition… Ce que j’apprécie dans cette façon de faire, c’est que même si les boutiques ne veulent pas de mes produits, les employés ou les responsables sont souvent très encourageants !
Quelle vision du monde ou de la société essayez-vous de mettre en œuvre ?
J’ai une certaine vision du monde et de la société, mais je ne peux pas dire que je cherche à la mettre en œuvre. Elle m’aide dans mes prises de décisions. Je vois la vie comme un grand jeu, fondé sur des lois instaurées par on ne sait qui ou on ne sait quoi, et où tout le monde perd à la fin.
Le monde du travail est également un jeu, un grand jeu de société où il y a des gagnants et des perdants. Dont la seule véritable importance est de meubler l’existence, la rendre moins lourde, la rendre exaltante. Une façon de détourner son esprit sur des problèmes moins impactant, moins douloureux, que des questions existentielles sans réponses. Concrètement, cette façon de voir se traduit par plusieurs type de comportements chez moi : « puisque mon travail n’est pas important, alors au moins qu’il soit épanouissant », « puisque mon travail n’est pas important, je ne risque rien », « puisque mon travail n’est pas important, qu’il ne détruise pas ce qui l’est ».
Quelles sont les prochaines étapes pour « la plume à l’oreille » et vos diverses activités ?
Dégager un salaire pour ma cousine et moi : bref, rendre l’activité rentable. Aller le plus loin possible dans le respect de l’environnement et de nos idées.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
Réflexions
23 juillet 2022RéflexionsOutre la fatigue, dont nous avons déjà parlé, le sentiment humain qui semble aujourd’hui un des mieux partagés, est l’anxiété. Les jeunes générations font couramment part de leur « éco-anxiété », ce sentiment diffus d’angoisse et d’impuissance qui croît à mesure que le changement climatique s’accélère. Il semble très lié à une impression pesante que la crise est insurmontable, et que l’action est vaine, parfois insincère, ou à tout le moins trop velléitaire.
Si ce sentiment naît chez certains d’une connaissance précise des enjeux climatiques ou de biodiversité, il est causé ou catalysé chez d’autres par la succession des épisodes aigus de nature écologique, sociale ou géo-politique, que nous vivons actuellement, et dont chacun pressent obscurément qu’ils sont liés. Plusieurs postures se font alors jour : la fuite, l’incantation, le repli sur soi, etc.
Comment, personnellement ou collectivement, faire face à ce sentiment d’anxiété qui paralyse ? Cela peut sembler d’autant plus difficile qu’il n’est pas du tout certain que les crises écologiques ou politiques que nous traversons soient solubles. Évoluant dans un monde conçus et façonnés par des ingénieurs, nous vivons sans doute dans l’illusion que tout problème a sa solution. Or, l’humanité fait aujourd’hui face à une difficulté à laquelle elle n’a jamais eu affaire : elle a généré une évolution de son cadre de vie qui petit à petit rend celui-ci invivable pour elle. La difficulté est hors-norme : elle concerne un macro-système qui collapse du fait de l’action d’un de ses agents internes. Celui-ci, à l’intérieur de ce système, doit le faire évoluer alors qu’il est complètement pris, englué dedans.
Au final, c’est notre rapport au monde qui est à interroger. En d’autres termes, la question fondamentale pour l’homme contemporain, est d’ordre métaphysique, ou à tout le moins anthropologique : « Quelle est la place de l’homme dans le monde ? ». Nous devons nous y confronter, sans nous abriter derrière des process techniques ou des habitudes sociales en espérant qu’ils répondent à notre place. Alors, une fois que nous aurons humblement envisagé la question , il nous faudra admettre qu’il existe quelque chose en dehors de nous, que l’homme n’est pas la mesure de toute chose, et que donc nous devons effectuer une sorte de retrait, au moins partiel.
Ce retournement, cette conversion, sont à envisager comme un processus de dépossession, de perte de contrôle consentie. Ce mouvement d’acceptation de notre vulnérabilité est fondamentalement anxiolytique : il ne nie pas l’angoisse, il permet de vivre avec. Et il reconfigure l’action. Aujourd’hui, si nous le voulons, il nous est possible d’agir avec mesure, non pour nous imposer à ce qui est autre, mais pour dialoguer avec l’autre, s’agencer à lui. Cette action qui transforme avec respect, qui reconfigure en reconnaissant l’altérité, est fondamentalement joyeuse.
C’est précisément ce renouvellement de posture que connaissent tous les grands malades qui arrivent à se rétablir, qui regagne une capacité d’agir : ils ne sont plus dans la toute-puissance antérieure, mais vivent avec la blessure ou la maladie, pour ajuster ce qu’ils sont à ce que leur environnement leur permet d’être.
Emmanuel Paul, Kèpos [...]
30 mars 2022RéflexionsLa guerre en Ukraine a déjà pour effet de faire grimper substantiellement les prix de l’énergie et des matières premières, notamment agricoles. C’est ainsi que le pétrole, le gaz, le nickel, le blé ou encore l’huile de tournesol voient leur prix s’envoler de manière exponentielle. L’inflation est au plus haut depuis de très nombreuses années en Europe, et notamment en France. Mais il est important de noter que ce mouvement haussier était déjà en cours avant l’agression de l’Ukraine par la Russie. Il concernait alors en particulier le gaz et le pétrole, mais aussi les coûts de logistique ou les semi-conducteurs. Il était alors majoritairement attribué à la reprise post-covid et à la désorganisation des chaînes logistiques internationales. Mais personne ne prenait en compte qu’il n’était pas impossible que la capacité à fournir des écosystèmes dont nous dépendons soit elle-même limitée, et d’une certaine manière, déjà « au taquet » !
La Guerre en Ukraine est un accélérateur et un amplificateur de ces tendances, dans plusieurs domaines :
Les occidentaux cherchent à réduire leur dépendance au gaz et au pétrole russes, ce qui accroît la pression haussière sur les prix via une demande plus forte auprès des autres producteurs.Les engrais et autres produits de synthèse pour l’agriculture sont très dépendants du pétrole, et massivement produits en Russie et Ukraine. Cela implique directement une augmentation des coûts de production des agriculteurs.La Russie et l’Ukraine sont de très importants exportateurs de matières premières agricoles (céréales, oléagineux, etc.). Leur capacité à fournir va être très fortement impactée par la guerre : incapacité des paysans ukrainiens à pratiquer leur activité (manque de carburant, indisponibilité des agriculteurs car partis au combat ou ayant dû fuir, etc.), impossibilité d’exporter les marchandises depuis les ports de la Mer Noire, difficulté à payer les opérateurs russes du fait des sanctions financières touchant le pays, etc.Augmentation du coût des matières premières métalliques, comme par exemple le nickel, du fait d’une forte concentration de la production en Russie. On constate également par exemple en ce moment de très fortes pénuries d’acier, l’Ukraine étant un pays avec une puissante industrie lourde.
écologiques se renforcent pour aboutir à un même résultat : notre mode de vie va devenir littéralement hors de prix. Quelque part, nous avons vécu depuis des décennies à crédit, en pillant les écosystèmes, en prenant dans leur stock de capital plutôt que dans les intérêts qu’ils étaient capables de nous fournir, les fameuses ressources renouvelables. Pour des acteurs comme Kèpos, il était clair que l’on ne pouvait toujours sortir plus de produits d’écosystèmes dont la capacité à fournir était par définition limitée, et qu’un hiatus allait apparaître.
En conséquence, la sécurité alimentaire d’une grande partie du monde n’est plus assurée, les causes géopolitiques se mêlant aux difficultés économiques et aux effets du changement climatique (sécheresse historique au Maroc ou en Amérique latine par exemple). Mais le pire est bien sûr que ce sont les populations les plus déshéritées qui vont le plus souffrir, et notamment dans les pays dont l’autosuffisance alimentaire est la plus faible (Moyen-Orient, Maghreb, Afrique subsaharienne, etc.). On s’attend à des famines et des troubles politiques et géopolitiques terribles.
En France, la situation se traduit par la montée en puissance de la thématique du « pouvoir d’achat », qui devient incontournable dans le débat présidentiel. Mais malgré la démagogie de nos candidats et dirigeants, il est très clair que l’on ne s’en sortira pas à coup de ristournes sur le prix de l’essence ou de primes inflation. Et que ce soit l’État ou les consommateurs qui sortent l’argent, il faudra toujours payer ! Il importe donc que tout un chacun comprenne que la donne vient de radicalement changer, et que ce qui n’était jusqu’à présent que latent devient terriblement réel : il va nous falloir payer le vrai prix des choses. L’abondance dans laquelle nous avons vécu depuis un siècle était d’une certaine manière irréelle. Plus que jamais, le seul scénario soutenable est celui de la sobriété. Et nous avons tous intérêt à la choisir plutôt qu’à la subir.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
21 janvier 2022Réflexions« Si vis pacem, para bellum » : si tu veux la paix, prépare la guerre ! Face à l’accroissement des périls à l’Est de l’Europe, cet adage latin devrait présider à notre action. Rappelons les faits : la Russie, qui a déjà annexé le Crimée et déstabilisé le Donbass, masse des troupes (plus de 110000 hommes) et du matériel lourd à la frontière ukrainienne. Dans le même temps, elle annonce déployer son armée pour des exercices en Biélorussie, et organise des manœuvres navales d’ampleur mondiale. Face à cela, l’Ukraine appelle à l’aide les occidentaux. Mais la menace ne se limite pas à l’Ukraine : pays baltes, scandinaves et d’Europe centrale s’inquiètent. C’est ainsi que la Suède commence à déployer des troupes sur certaines de ses îles jouxtant la Russie. La question se pose : qu’est-ce qui intéresse vraiment la Russie ? Seulement l’Ukraine ? Ou tout le périmètre de l’ancienne sphère d’influence soviétique ?
Dans le même temps, la Russie fait monter la pression en exigeant des États-Unis et de l’OTAN des concessions exorbitantes : impossibilité de plus étendre le périmètre de l’OTAN, retrait des troupes de l’OTAN d’Europe centrale et orientale, etc. De plus, la Russie entend négocier directement avec les Etats-Unis, en n’incluant pas les Européens, pourtant les premiers concernés. Ces demandes ressemblent plutôt à des ultimatums, et ne sont pas de réelles négociations. Au même moment, l’opinion publique russe est abreuvée d’un discours présentant l’OTAN comme assiégeant la Russie, alors qu’elle n’a en réalité qu’une fonction défensive.
Face à cela, il apparaît de plus en plus clair que les occidentaux ne sont pas prêts à mourir pour l’Ukraine. Mais le seront-ils pour défendre des membres de l’Union Européenne et de l’OTAN ? Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse d’une agression par la Russie de l’Ukraine, les occidentaux menacent le Russie de sanctions économiques et politiques d’ampleur systémique, qui couperaient les vivres aux Russes. Mais ce qui pourrait se profiler derrière tout cela, ce pourrait être une déstabilisation plus vaste de toutes les démocraties de l’Est et du Nord de l’Europe.
Face à cette situation, on ne peut qu’être abasourdi par l’esprit munichois qui prévaut dans un pays comme la France. La France ne croit pas réellement à une agression de l’Ukraine par les Russes, et avance qu’un dialogue exigeant est possible. Les experts éclairés ne croient plus à la possibilité de ce dialogue, qui est, au mieux, un vœux pieux, au pire, une compromission. Si l’on tenait vraiment à la démocratie et à la liberté, l’heure devrait être au réarmement, militaire, politique, économique et surtout moral.
Or, que voit-on ? Toute une partie de la classe politique a basculé dans une attitude de fascination ou d’ambiguïté vis à vis de Poutine : Mélenchon, Zemmour, le Pen, et même une partie de la droite républicaine. L’itinéraire de François Fillon est à cet égard symptomatique, qui prend des responsabilités aux conseils d’administration de plusieurs grandes entreprises russes. Dans la sphère médiatique, on frise l’inconscience : tout le monde est incrédule face au péril, et on préfère consacrer son attention à la réouverture des discothèques et autres sujets du même genre. Sans parler des citoyens, qui ont déjà en grande partie abdiqué leur liberté, c’est à dire leur capacité à influer, par la participation à la délibération démocratique, sur la volonté générale et le destin collectif.
Munichois un jour, Munichois toujours : telle pourrait être notre devise. Nous semblons croire que la rationalité l’emportera. C’est méconnaître les passions humaines à l’œuvre dans l’histoire, faite de démesure et d’inconséquence. Or, ce que l’on voit, c’est un dirigeant russe animé de l’esprit de revanche. Dans ce contexte, et alors qu’une guerre chaude de dimension potentiellement systémique pourrait être déclenchée, il ne faudrait pas que nos renoncements et notre manque de courage nous précipitent dans l’abîme. Après notre pusillanimité face au changement climatique, nous adoptons la même attitude face au risque géopolitique.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
6 décembre 2021RéflexionsLe temps passe, et la lassitude gagne… « L’éternité, c’est long, surtout sur la fin », dit Woody Allen. Et en effet, les soubresauts de l’épidémie de Covid générèrent chez tout un chacun le sentiment d’être embarqué dans une sorte d’ascenseur émotionnel. C’est ainsi qu’au printemps 2020, avec le premier confinement, tout le monde était persuadé qu’il s’agissait d’un sprint, un mauvais moment à passer en quelque sorte. Le Président de la République a pu emprunter l’expression du « retour des jours heureux » au début de l’été 2020, alors que la contrainte sanitaire se relâchait. A l’automne, nous nous faisions fort de mieux gérer les éventuels sursauts épidémiques avec les masques arrivés depuis en quantité suffisante. Las, cela n’était pas du tout suffisant, et les contaminations reprirent. Revint alors l’espoir avec les vaccins, qui allaient nous sortir d’affaire. Et effectivement, la situation s’améliorait : armés de nos passes sanitaires, nous pouvions à nouveau fréquenter restaurants, concerts et salles de cinéma. Hélas, les perspectives s’assombrissent aujourd’hui à nouveau : les vertus des vaccins faiblissent avec le temps, le virus mute régulièrement, des personnes non vaccinés assurent au virus des jours fastes de circulation, et la fatigue se fait sentir.
La fatigue… « La chose la mieux partagée » aujourd’hui, pourrait-on dire en paraphrasant Descartes. Elle apporte une coloration à notre être au monde, elle est l’expérience contemporaine collective et individuelle par excellence. Les articles fleurissent sur la question, et la recherche académique s’en empare. Et de fait, les conséquences psychologique, sociale ou économique du Covid sont d’ores et déjà considérables. Certes, sous l’effet du Plan de relance, la machine économique s’est relancée de manière intense. Mais on aurait presque l’impression d’un épisode maniaque chez un patient bipolaire, tant cela semble artificiel et exagéré. Et quoi qu’il en soit, le rattrapage économique de 2021 ne résout aucun de nos problèmes sociaux, écologiques ou politiques.
Cette fatigue, de laquelle personne n’arrive à venir à bout, est d’autant plus écrasante que nous ne voyons pas le terme de cette épidémie. Et dussions-nous y arriver, elle n’est qu’un épisode de la crise écologique en cours, qu’un avatar d’une évolution bien plus large, celle qui a vu l’homme devenir une force géologique, évolution que l’on nomme anthropocène. En effet, le Covid et la manière dont il s’est déployé, sont très liés à notre rapport vicié aux écosystèmes naturels, à notre propension à nous déplacer à la surface du globe de manière frénétique, à notre appétit insatiable en produits et services, etc. Et l’anthropocène nous met face à des mutations autrement plus majeures qu’une épidémie somme toute bien maîtrisée et peu létale : effondrement de la biodiversité inédit depuis plus de 60 millions d’années, changement climatique dû à des concentrations de CO2 dans l’atmosphère inconnues depuis 3 millions d’années, etc. Bref, nous n’avons déjà plus faim, alors que nous n’en sommes qu’aux hors d’œuvre !
La fatigue de nos sociétés et de leurs membres est aussi celle des écosystèmes dans lesquels nous vivons, épuisés de sollicitations permanentes, que nous stimulons sans arrêt pour en obtenir davantage. Et comme pour n’importe quels organismes, plus nous les stimulons, moins nous en tirons quelque chose. Qu’il s’agisse de productions agricoles, de pétrole ou de matière premières minérales, partout les rendements sont décroissants, et il nous faut stimuler plus pour obtenir moins.
La bonne nouvelle est que ce dont ont besoin à la fois les écosystèmes, les sociétés humaines, les êtres humains en tant que corps et esprits, c’est de repos. L’antidote au burn out et à la fatigue, c’est de s’arrêter, de regarder autour de soi, de reprendre ses esprits, et de prendre conscience de qui l’on est, où l’on habite, etc. Prêter attention à soi, à l’autre, à ce qui est, est ce à quoi nous invite la philosophe Simone Weil dans l’Enracinement. Elle est une posture éthique fondamentale, qui nous restaure en tant que sujet, et donne à l’objet de notre attention la place qui doit être la sienne. Elle est l’alternative à l’excitation du monde actuel, connecté à tout, présent à rien. Le repos est ce dont les écosystèmes naturels ont besoin pour se réhabiliter. Il fait signe vers un choix essentiel que nous devons apprendre à faire : procrastiner ! Garder des choses à faire pour le lendemain, savoir s’arrêter, est une vertu, dont nous parle Charles Péguy dans le Porche du Mystère de la Deuxième vertu. Il s’agit d’une condition de l’espérance, dont nous avons tant besoin aujourd’hui. Nous voici donc au seuil d’un choix crucial : savoir distinguer nos vrais et nos faux besoins. C’est alors que nous pourrons laisser filer les vaines affaires du monde, pour renouer les fils du sens de nos vies terrestres.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
10 septembre 2021RéflexionsLes enjeux écologiques sont une invitation à reconfigurer les modalités de la vie économique, de la compétition à la coopération. En effet, la coopération apparaît comme une approche qui est :
Plus efficiente, garantissant un meilleur usage des ressources.Plus efficace, rendant possible l’atteinte de meilleurs résultats en matière d’impact écologique.Davantage porteuse de sens, à l’heure où la question du sens se pose avec acuité à nos organisations économiques, sociales et politiques.
Des enjeux vitaux
Les enjeux liés à la crise écologique sont vitaux pour l’humanité. Quelques chiffres pour l’illustrer :
Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) représentent 81 % du mix d’énergie primaire dans le monde. Il nous faut, d’ici 2050, quasiment réduire à 0 cette consommation.Le pic du pétrole conventionnel a été atteint depuis 2005. Le maintien de la production ne peut s’effectuer qu’avec le recours aux pétroles non conventionnels. On ne sait combien de temps ceux-ci pourront assurer nos approvisionnements.Le taux de CO2 dans l’atmosphère est aujourd’hui au niveau le plus élevé depuis 3 millions d’années.Pour atteindre la neutralité carbone, il nous faut diminuer nos émissions de Gaz à Effets de Serre par un facteur 6 d’ici 2050 par rapport à 1990, tout en doublant la capacité de nos écosystèmes à stocker du carbone. Pour l’instant, nous avons à peine parcouru 20 % du chemin (en 30 ans), et seulement via la délocalisation de notre industrie.Le scenario as usual nous met tout droit sur le route d’une augmentation de la température mondiale de + 4°C d’ici 2100 par rapport à la période préindustrielle. Aujourd’hui, nous en sommes déjà à + 1,09°C.La crise de la biodiversité actuelle est vue par les chercheurs comme la 6ème extinction massive des espèces. La précédente date d’il y 60 millions d’années. Celle-ci menace nos approvisionnements alimentaires, la fertilité de nos sols, la disponibilité d’une eau favorable à la consommation humaine, etc.
Nous sommes donc face à une crise globale, systémique, « un nouveau régime climatique » comme le dit Bruno Latour. L’homme est devenu une force géologique, qui modifie la structure du système terre : on parle d’« anthropocène », l’ère géologique de l’homme. Dès lors, la transition écologique est un processus de transformation radicale et multidimensionnelle, qui vise à apaiser les contradictions que l’homme a introduites dans le système terre, et qui menacent sa pérennité.
La nécessité de cette transformation concerne tous les acteurs : acteurs publics, entreprises, société civile, citoyens, etc.
La coopération : une nécessité
La vie économique est au cœur des mutations à accomplir. Les modalités d’organisation des échanges doivent évoluer face aux caractère critique des enjeux liés à la transition écologique. La vie économique est en effet organisée selon le principe de la mise en concurrence. La « concurrence libre et non faussée » promue par l’Union Européenne est un principe important pour garantir que la compétition économique soit loyale. Par ailleurs, les étudiants en gestion connaissent bien la matrice créée par Michael Porter, qui montre que la concurrence ne se limite pas à celle directe avec les offreurs des mêmes produits que soi, mais qu’elle est présente tout au long de la chaîne de valeur, vis à vis des fournisseurs, des clients (via leur pouvoir de négociation), vis à vis de nouveaux entrants, ou de produits de substitution. On aboutit alors à un modèle concurrentiel généralisé, centré sur le profit, très efficace pour la création de richesses, mais sans doute beaucoup moins pour leur répartition.
La difficulté aujourd’hui est qu’il faut rentrer dans un modèle de sobriété, qui clairement vient percuter de plein fouet les logiques de croissance. Les indicateurs de succès d’une entreprise doivent se déplacer de la sphère financière vers de nouveaux indicateurs de maintien des ressources, de neutralité carbone, de régénération des écosystèmes naturels et de résilience des organisations humaines. Il nous faut donc glisser d’un modèle concurrentiel qui permet une maximisation de la richesse produite, à un nouveau modèle de relation qui permettent d’atténuer nos impacts, de mieux anticiper des risques, de réagir avec cohésion aux situations de crise.
Ce nouveau modèle de relation inter-organisations, c’est la coopération : une manière de résoudre collectivement des problématiques communes en misant sur le partage de l’information, la mutualisation de ressources, la synergie entre activités, la répartition équitable du pouvoir de décision et de la valeur créée. C’est un mode de relation qui doit être régulé par la puissance publique pour s’assurer que l’intérêt collectif soit en son centre. Il est une nécessité au moment où la société est traversée de forces centrifuges qui menacent sa cohésion.
Pour reprendre le propos de notre introduction, la coopération est :
Plus efficiente : la mutualisation de ressources a pour effet la limitation de leur gaspillage.Plus efficace dans ses impacts écologiques et sociaux : elle permet une orientation collective des efforts vers des objectifs de sobriété, en offrant un espace de dialogue, de partage de connaissances et de délibération collective susceptible de placer des objectifs écologiques ambitieux au cœur de l’action collective. En outre, elle garantit une meilleure coordination des efforts, en suscitant un apprentissage collectif qui permet de gagner en efficacité.Porteuse de davantage de sens : elle est une réponse au gouffre actuel entre le gigantisme des moyens techniques à notre disposition, et l’anomie des objectifs de nos organisations. Elle recrée du sens pour tous et pour chacun. Elle permet une herméneutique du réel qui oriente vers un objectif de maintien de l’humanité et de la nature dans leur être.
L’exemple de la SCIC Kèpos
Kèpos (« Jardin » en grec ancien) expérimente un modèle écosystémique pour œuvrer collectivement, via la coopération inter-entreprise, à la transition écologique du territoire. Il s’agit d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) : une société commerciale avec un fonctionnement coopératif, qui se définit vis à vis d’un intérêt collectif, à mi-chemin de l’intérêt privé et de l’intérêt général, autour de la transition écologique de son territoire d’implantation, la région nancéienne.
Kèpos est constitué d’un noyau de 24 entreprises, TPE, travailleurs indépendants, associations, engagés sur les questions écologiques, et qui sont dans une logique de développement afin de maximiser leurs impacts écologiques et sociaux. Le but est de passer des seuils de manière collective, la coopérative jouant le rôle d’un outil de développement mutualisé. L’écosystème d’activités ainsi formé est composé d’acteurs qui ne sont ni sur les mêmes métiers, ni sur les mêmes marchés, ni sur les mêmes secteurs, favorisant par là-même leurs interactions.
La coopération s’y vit de plusieurs manières :
Via une gouvernance multipartite, incluant des acteurs privés et publics, créant une véritable entreprise partagée.Par un accompagnement des dirigeants de chaque membre, afin de l’aider à prendre de la hauteur.En privilégiant un développement endémique de relations entre membres et avec les partenaires de l’écosystème, s’appuyant sur des fertilisations croisées tout azimut. Les relations d’affaire entre membres n’ont de cesse de s’y multiplier.A travers des propositions de formations pour monter en compétence individuellement et collectivement.Via la mutualisation de ressources auxquelles aucun des membres, seul, ne pourrait prétendre.En organisant des rencontres avec des experts des questions écologiques, notamment des universitaires.En mutualisant les offres et en menant une prospection collective des gros donneurs d’ordres.En proposant aux coopérateurs un bouquet de services : conseil, recherche de financement, recrutement, etc.En mettant en place une représentation commune auprès des pouvoirs publics.En vivant tout cela dans un climat de convivialité et d’entraide.
Kèpos est à l’heure actuelle en train de chercher à étendre son modèle au-delà de son premier cercle de coopérateurs. C’est tout le sens de la labellisation PTCE émergents (Pôle Territorial de Coopération Economique) que la coopérative vient d’obtenir dans le cadre du Plan de relance. La relation avec la sphère publique n’est pas oubliée, et certaines collectivités sont entrées au capital de la SCIC. Kèpos se pose ainsi en relais proactif de politiques publiques qui peu à peu se construisent en matière de transition écologique, en même temps qu’il cherche à les influencer.
Dans le contexte des crises climatique et de la biodiversité, les expérimentations, telles celle menée par Kèpos, sont des jalons essentiels pour réorienter l’activité économique vers la durabilité et la sobriété. Il est crucial que ces expérimentations puissent prospérer et tenter de trouver des solutions pour que les enjeux écologiques soient réellement à l’agenda des entreprises.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
15 avril 2021RéflexionsCe blog est l’espace d’expression de la SCIC Kèpos et de ses membres. Aussi donnons-nous la parole aujourd’hui à Chloé Lelarge, fondatrice du cabinet Frugali, experte sur les questions d’alimentation responsable et de consommation durable, et membre fondatrice de Kèpos.
Le Petit Robert définit le terme consommer comme suit : « Mener (une chose) au terme de son accomplissement (➙ consommation). … Consommer le mariage : accomplir l’union charnelle. Amener (une chose) à destruction en utilisant sa substance ; en faire un usage qui la rend ensuite inutilisable. ➙ user de, utiliser »
Quelle dualité au sein de l’action la plus populaire et banale de notre quotidien ! A première vue, rien de très durable dans cette action ; car durabilité fait aujourd’hui écho à l’idée de pérennité. Consommation et durabilité, deux notions qui semblent antinomiques, contraires. Mais à l’heure où la consommation est le fondement de notre société, peut-on s’aventurer à imaginer le dessein d’un projet de société basé sur la consommation durable ?
Une consommation désenchantée
A l’aube des années 50 est entrée en marche ce que l’on a nommé « la société de consommation ». Tels un véritable monstre semblable au ventre de Paris dont parlait Victor Hugo, la société et ses membres se sont dotés d’un pouvoir d’achat et d’acquisition puissant. Si puissant qu’avec lui, ils ont embarqué l’agriculture, et notre relation au vivant. Tout ce qui est, ou était, est devenu “biens de consommation”. Parallèlement à cette facilité d’acquisition, les femmes ont accédé au marché de l’emploi, et l’entrée dans les foyers de nombreux objets ménagers a permis une véritable émancipation, un gain de temps et une économie d’effort.
Mais aujourd’hui, en proie aux perspectives noires du réchauffement climatique et à la crise sanitaire mondiale, n’est il pas temps de ralentir ? Bien plus que des biens et services, nous consommons sentiments, relations et expériences. La pandémie marque un coup d’arrêt à notre frénésie et nous sommes obligés de nous stopper net. Perdus et hagards, apeurés par cette idée puissante de vide, nous nous retrouvons à prendre conscience de notre fragilité et fébrilité face aux vivants.
Par-delà l’assouvissement ultime de besoins non indispensables, que cherchons nous à combler ? Sommes-nous en mal d’amour, de liens, d’échanges ? Nous répondons à cette demande de contact via les applications et les réseaux sociaux. Course ultime, quête de la personne parfaite, aucune satisfaction pérenne ne se dégage de ces modes de consommation. Pire encore, ils donnent la sensation que tout est possible, ignorant effort et patience ; ils piétinent le sens de nos vies.
Les impasses de la culpabilité
Dans cet article nous tentons de répondre à ces questions pour esquisser des pistes permettant de faire autrement. Alors consommer durablement, est-ce renoncer au confort matériel, à la joie de se faire plaisir, à celle d’offrir, à celle de recevoir ?
Voici une tentative de réponse. Aujourd’hui nous n’allons pas vous parler d’écologie, ni même de climat mais plutôt de simplicité, de découverte, et de joie de vivre et faire pour soi et les autres. Car insister sur la responsabilité, l’ acte d’achat, la conscience, la prise de conscience… se résume plus à une forme de culpabilité qu’à un point de départ en faveur du changement ! Non là ne peut pas être le point de départ d’une véritable transformation.
Deux extrêmes s’opposent et produisent un sentiment de distance, de mépris, de lassitude, à l’égard de tout changement, gestes et pratiques contribuant à une “forme de durabilité”. Il en ressort un assez vulgaire “après moi le déluge”. Là n’est pas le propos, et trouver des raisons rationnelles au changement pour faire évoluer un individu est presque perdu d’avance.
Opérer une mise en action positive
Deux choses sont donc nécessaires pour une prise de conscience et une traduction dans les actes. D’une part, que ce soit à l’échelle d’un individu, d’un foyer, d’une collectivité, d’une entreprise ou encore au sommet de l’État, rien ne se fera sans effort consacré au changement et qui concerne l’individuel et le collectif. D’autre part, le premier acte de l’effort devra toujours porter sur quelque chose d’accessible.
Revenons aux actes de consommation : que disent-ils de nous ? Que ce soit l’achat d’un objet neuf pour un anniversaire, la consommation effrénée de viande, la confiance accordée aux fake news, nous y plaçons des critères de confiance et de réassurance. Or, l’humanité s’est construite à travers les traditions, celles qui ont forgé la transmission de la pratique. Petit à petit, la société de consommation est venue remplacer cette forme de tradition et, avec elle nos savoirs, nos savoir-faire, nos relations aux autres. A défaut de vous servir un “c’était mieux avant” ou d’exhorter les boomer à ramasser leurs déchets, je vous propose de changer dans votre tête, de modifier votre point de vue . Se défaire de l’acte de consommer en devient totalement libérateur, car il enlève tout rapport marchand et graduel à l’autre.
Alors par quoi/par où commencer pour que l’étape première de notre changement soit un début prometteur ? Nous pouvons recenser tout ce qui nous est agréable dans notre quotidien. Ce dont nous avons besoin pour nous sentir bien. Quatre dimensions peuvent nous convaincre de changer : l’écologie, l’économie, la santé et le lien social. Alors notre sage capacité à la résilience pourra nous mener à une consommation dite durable. Et ce d’autant plus que, si la consommation doit se heurter à un brusque et violent traumatisme sociétal, environnemental, économique et sanitaire, la résilience passe principalement et tout d’abord par le principe d’altérité : connaître et vivre avec l’autre dans un souci d’entraide.
PS : Quelques petites évolutions peuvent nous donner un peu de confiance, telles ces aspects réglementaires liés à la loi Climat en préparation :
Obligation d’ici 2030 pour les commerces de détail de plus de 400 m 2 de consacrer au moins 20 % de leur surface au vrac.Expérimentation du “Oui pub” : interdiction de la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée sur la boîte aux lettres.Instauration d’un “Eco-score” : amélioration de l’information du consommateur sur l’empreinte carbone des produits.
Chloé Lelarge de Frugali [...]
9 mars 2021RéflexionsAlors que la planète finance s’inquiète d’un retour de l’inflation et d’une hausse des taux, on note ces dernières semaines une hausse sensible des prix du pétrole, favorisée par le maintien de restrictions de leur production par les pays de l’Opep. Dans le même temps, certains tensions se font jour en matière d’approvisionnement en semi-conducteurs, en plastique ou encore en métaux. Tous ces matériaux ou produits subissent une double situation d’envolée de la demande suite au Covid, et de capacités de production détenues par un nombre limité d’acteurs, notamment asiatiques, qui n’arrivent pas à fournir.
Ces signaux faibles d’une situation économique extrêmement fragile ne sont pas une surprise pour les personnes qui s’intéressent à la question de la disponibilité des ressources dans un monde fini. Et quelque part, on peut se dire raisonnablement : ce n’est que le début ! Pour en prendre la mesure, nous vous proposons ici une relecture de l’ouvrage de référence de Mathieu Auzanneau sur l’histoire du pétrole, nommé tout simplement Or noir. Celui-ci reprend un siècle et demi d’histoire récente du pétrole, depuis le premier forage du Colonel Drake en Pennsylvanie en 1859, jusqu’aux guerres du Golfe et la crise de 2008.
Plusieurs idées forces en ressortent. La première est que l’industrie pétrolière est l’industrie la plus rentable qui ne fut jamais, générant des fortunes inédites à l’échelle de l’histoire de l’humanité. Cette rentabilité s’explique par des infrastructures somme toute légères, par rapport à la valeur énergétique et donc économique d’un tel liquide. En effet, dans les puits classiques, il suffit tout bonnement de forer pour que le pétrole jaillissent, là où l’extraction de la source d’énergie de la précédente révolution industrielle (le charbon), était extrêmement intense en capital et surtout en travail.
Cette rentabilité exceptionnelle était couplée à une abondance inimaginable, à tel point que l’industrie, pendant des décennies, a dû œuvrer, à coup d’ententes et de cartels, à limiter drastiquement la production pour que les cours ne s’effondrent pas. Les cours n’en sont pas moins restés extrêmement faibles jusqu’à la fin des années 60, sans pour autant gêner l’expansion de la richesse chez les principaux acteurs du secteur.
Cette régulation par le cartel s’est accompagnée d’une très grande porosité entre les acteurs privés du secteur et les acteurs publics, notamment aux Etats-Unis, où leurs intérêts sont indissociables. Et ceci a toujours été avec des manœuvres géopolitiques de plus en plus déstabilisatrices pour s’assurer de l’accès aux réserves dans les zones les plus richement dotées, en particulier au Moyen-Orient.
Dans ce contexte, qui prévaut pendant quasiment 100 ans, l’industrie connaît un pivot extrêmement puissant au tournant des années 1970. C’est à cette époque que les puits de pétrole américains, en Californie ou au Texas, voient leur production diminuer. On passe alors d’un marché piloté par la demande (avec une offre qui semble intarissable) à un marché piloté par l’offre, qui elle apparaît alors limitée quand la demande devient insatiable. En ce sens, les années 1970 marquent véritablement le passage dans le monde contemporain tel que nous le connaissons aujourd’hui. Nous rentrons alors dans un contexte d’augmentation des prix que les désordres géopolitiques au Moyen-Orient vont catalyser lors des chocs pétroliers de 1973 et 1979. Les prix n’en finiront plus, dès lors, de suivre des courbes en « crêtes de punk », entre le contre-choc des années 80 et l’envolée des prix précédant la grand crise de 2008.
Surtout, ce qui marque les acteurs de l’industrie, c’est tout d’abord la reprise en main des ressources par les grands pays producteurs au détriment des majors occidentales, mais aussi l’incapacité de l’industrie à découvrir de nouvelles réserves pouvant compenser celles qui peu à peu se tarissent. C’est ainsi que les acteurs pétroliers paraissent depuis quelques décennies paralysés par l’épuisement successif d’un certain nombre de champs pétroliers. Il n’y a quasiment plus de doute aujourd’hui pour dire que le pic pétrolier conventionnel a été atteint dans les années 2000, et que la production ne peut se maintenir que grâce aux pétroles non conventionnels (pétrole de roche mère, offshore profond, sables bitumineux). Dans le même temps, le fait que les réserves d’Irak soient encore largement disponibles, du fait des guerres et embargos qui ont prévalu dans ce pays pendant des décennies, explique qu’il soit au centre du jeu géopolitique mondial.
A la lecture de cette somme historique, on comprend que la préoccupation du pic pétrolier traverse toute l’industrie depuis un moment, sans que ces questions ne viennent troubler la quiétude du grand public et de la sphère médiatique. Or, quand on regarde à quel point l’abondance énergétique rendue possible par le pétrole a modifié du tout au tout notre monde et l’a fait entrer dans une trajectoire asymptotique, on ne peut qu’avoir l’impression d’un Leviathan, d’un monstre, formé de ce que nous sommes devenus, et qui commence à vaciller sur ses jambes et à perdre son équilibre.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
9 février 2021RéflexionsDans la foulée de notre contribution à la construction d’un Business Act Régional, tel que proposé par la Région Grand Est, nous publions aujourd’hui un nouveau texte destiné aux élus de la Métropole du Grand Nancy. Son propos est de montrer qu’à l’échelle d’une agglomération, cette crise du Covid place entreprises et acteurs politiques à la croisée des chemins, pour se saisir résolument, ou non, des questions de transition écologique.
La crise sanitaire que nous connaissons actuellement va marquer pour des décennies nos territoires et leur trajectoire de développement. Ses conséquences sont systémiques et touchent, à court, moyen et long terme, toutes les dimensions de la vie de la cité : sociale, économique, écologique, politique, etc. Cela appelle des politiques publiques de résilience pour absorber le choc et en tirer profit afin de réorienter nos modèles. Or, cette épidémie du Covid-19 n’est qu’un artefact d’une mutation d’une plus grande ampleur, l’anthropocène, l’ère géologique de l’homme, qui demande une transformation globale et multidimensionnelle de nos modes de production, de consommation et de vie vers la durabilité : la transition écologique. L’objet de cette tribune est d’appeler à ce que cette crise soit un tremplin vers une mise en route effective et ambitieuse de cette transition à l’échelle du Grand Nancy.
La crise du Covid-19 révèle nos fragilités territoriales
S’il s’avère aujourd’hui indispensable de réviser les stratégies et les modalités du développement économique local, c’est d’abord parce que la crise sanitaire a révélé de grandes fragilités.
Fragilité d’abord de notre système de soins, dont les infrastructures et le fonctionnement se sont révélés très vite sous tension au printemps dernier, sous l’effet d’une situation qui n’avait pas été anticipée. Fragilité industrielle ensuite, marquant ce qui serait, au yeux de nombreux observateurs, la fin de la mondialisation telle que nous l’avons connue jusqu’à présent. Notre très forte dépendance industrielle vis à vis de la Chine a ainsi conduit, dans un pays aussi développé et avancé technologiquement que le nôtre, à la pénurie d’un produit aussi simple à fabriquer qu’un masque chirurgical !Fragilité de notre tissu économique en général, fonctionnant en flux tendus et sans marge de manœuvre quand la situation conjoncturelle se dégrade. Les experts s’accordent d’ailleurs à dire que le niveau d’endettement des entreprises françaises est alarmant, ce qu’on peut relier à un manque de fonds propre et à une incapacité des dirigeants à projeter leurs entreprises autrement que dans une perspective de type « business as usual ».Fragilité sociale et culturelle enfin, avec des dégâts très importants sur la cohésion de la société, les ressources des ménages les plus fragiles, l’isolement des personnes, l’individualisme, l’éducation des jeunes générations et la confiance dans l’action publique.
Nous sommes dans un moment historique : la “crise” est étymologiquement le moment de la décision, du tri. Or, comme l’exprime si bien Bruno Latour, cette crise sanitaire est comme “enchâssée dans ce qui n’est pas une crise – toujours passagère – mais une mutation écologique durable et irréversible. Si nous avons de bonne chance de « sortir » de la première, nous n’en avons aucune de « sortir » de la seconde. Les deux situations ne sont pas à la même échelle, mais il est très éclairant de les articuler l’une sur l’autre.”
Faire face à la mutation écologique
Si de puissants intérêts économiques et financiers cherchent aujourd’hui à différer ou faire annuler des normes environnementales estimées trop contraignantes, la réalité matérielle, physique, du globe, se rappellera toujours à nous. Revenons ici brièvement sur quelques-unes de ces “données de base”. Le changement climatique est bien entamé, et nous en voyons régulièrement les manifestations. Si les émissions mondiales de Gaz à Effet de Serre (GES) se poursuivent au rythme actuel, nous atteindrons au moins +4 °C d’ici la fin du siècle, c’est à dire que nous entrerions, d’ici 20 ou 30 ans à peine, dans un monde totalement différent de celui que nous avons connu jusqu’alors, celui-là même qui a permis la formidable croissance économique des 70 dernières années : multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, vagues de chaleur), qui deviendront des menaces permanentes ; baisse des rendements agricoles partout sur la planète, sous l’effet conjugué du réchauffement et des atteintes diverses à la biodiversité (urbanisation, usage des pesticides et insecticides, pollutions des terres et des mers) ; augmentation de la mortalité directe due aux pics de chaleurs ; problèmes d’accès à l’eau (notre région connaît depuis plusieurs années déjà des situations de sécheresse structurelles) ; et augmentation de la propagation de maladie portées par les insectes, notamment. Rappelons ici au passage que de nombreux scientifiques établissent un lien au moins indirect entre les atteintes à la biodiversité (braconnage, déforestation) et l’apparition de nouveaux virus engendrés par zoonose comme le Sars-Cov-2.
La société civile est de plus en plus consciente de ces enjeux. Les marches pour le climat, les mouvements de jeunesse, les associations et ONG, ont contribué à faire connaître et affirmer la priorité de ces questions (plus de deux millions de signataires pour la pétition “L’Affaire du siècle”, par exemple). Les étudiants ne sont pas en reste, en “refusant de contribuer par leur travail à l’accélération des crises environnementales et sociales et souhaitant mener une activité professionnelle cohérente avec l’urgence écologique” (l’Appel pour un réveil écologique compte déjà plus de 32 000 signataires et concerne 400 établissements en Europe). Les consommateurs eux-même se déclarent beaucoup plus sensibilisés, affirmant de plus en plus leurs préférences pour l’alimentation bio, les produits issus de circuits courts, les marques les plus respectueuses de l’environnement. Les entreprises de notre territoire doivent donc aussi prendre en compte ces tendances de fond !
Nouvelle donne pour les politiques publiques de développement économique
C’est le propre des entreprises d’appréhender et de trouver des réponses à ce type de contrainte, et même de s’en saisir pour les transformer en opportunités, et de le faire mieux que leurs concurrents ! Mais ces mêmes entreprises ont besoin de visibilité, d’une stratégie claire, globale et cohérente, de long terme pour pouvoir y inscrire leurs propres stratégies de développement, programmer leurs investissements. Or, et c’est tout le paradoxe de notre situation, les entreprises et les banques les plus éclairées et conscientes de ces enjeux appellent justement les autorités publiques à de nouvelles formes de régulation ! Elles le savent, le “business as usual” est incapable d’appréhender les défis du changement climatique, les “externalités négatives” comme les pollutions diverses ou les émissions de CO2 n’entrant pas dans leur champ comptable. En la matière, il revient donc à la force publique d’agir et d’affirmer des orientations fermes et contraignantes, et surtout de réduire les incertitudes pour faciliter la bonne marche des acteurs économiques.
Les pouvoirs publics, et singulièrement les collectivités et leur groupements, dont le Grand Nancy, se trouvent donc en situation de devoir fixer un nouveau cadre de développement, et ce en articulation avec ceux de l’Europe et de l’État, qui sur ces questions sont en train d’évoluer. C’est à une nouvelle forme de planification et à de nouvelles régulations que nous appelons aujourd’hui. Elles doivent prendre forme dans le cadre d’un développement économique décentralisé qui, depuis la loi Notre, s’appuie sur les deux piliers que sont les Régions et les Métropoles. Nous sommes convaincus que la crise du Covid-19, qui appelle un soutien nécessaire de la collectivité auprès des branches et des entreprises les plus touchées, offre justement l’opportunité de mettre en place de nouvelles orientations capables de prendre en charge les enjeux écologiques, qui représentent la plus forte menace pour nos sociétés, à moyen terme.
Nos propositions pour le Grand Nancy
Nous nous permettons donc de faire quelques propositions aux élus de la Métropole du Grand Nancy, pour opérer cette transformation de manière proactive :
Le premier levier, et le plus transversal, consiste à changer les termes de la délibération sur le territoire. Il importe que, dans les instances politiques, consulaires, patronales, syndicales, académiques, etc., le débat soit réorienté à la lumière des enjeux écologiques contemporains. Pour cela, il est essentiel que dans toutes ces enceintes, un effort d’information et de mise à niveau des acteurs soit entrepris, pour qu’il connaissent puis maîtrisent ce dont on parle quand on parle de raréfaction des ressources, de changement climatique ou d’effondrement de la biodiversité. Très clairement, les acteurs ne sont pas au niveau de leurs responsabilités sur ce point.
La deuxième série de leviers à trait à la question de la formation initiale et continue sur le territoire du Grand Nancy :
Faire muter l’offre de formation sur le territoire, en investissant massivement dans la formation professionnelle des personnes qui vont perdre leur emploi, pour réorienter cette force de travail vers les secteurs de la transition écologique. La bonne nouvelle étant que la transition écologique devrait se solder par une création nette d’emploi, via la relocalisation d’activités et le développement de nouvelles filières (recyclage, réemploi, travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments existants, etc.).Poser très clairement à l’Université de Lorraine la question de sa stratégie pour que tous les étudiants soient formés de manière sérieuse aux enjeux énergie-climat, et puissent dans leur avenir professionnel avoir les leviers pour contribuer à la transition écologique là où ils trouveront du travail.Créer une filière de formation initiale et continue de haut niveau pour les cadres industriels sur le management de la transition écologique dans l’industrie.
Dans le domaine de la politique de soutien aux entreprises :
Ne plus soutenir avec de l’argent public aucun projet d’innovation ou d’investissement qui ne soit pas, sur la base d’une évaluation ex-ante, compatible avec l’objectif de la neutralité carbone en 2050. L’idéal serait de faire de même avec les Prêts Garantis par l’État (PGE) et autres outils financiers spécifiques à la période Covid. Comme l’affirme la Convention citoyenne pour le Climat, il faut cesser de soutenir “l’innovation pour l’innovation”. Il ne s’agit pas de contrôler a priori toute innovation : simplement, une innovation ou un investissement industriel qui ne répondra pas aux objectifs de neutralité carbone ne pourra dorénavant plus bénéficier du soutien financier public (de la Métropole du Grand Nancy et des partenaires usuels (Région, BPI, etc.)). Nous affirmons ainsi le rôle indispensable de la collectivité d’orienter le développement économique en faveur de la transition, ce que le marché est aujourd’hui incapable de faire, seul.Pour accompagner la réorientation nécessaire de notre appareil de production vers les stratégies et les secteurs bas carbone, il nous semble essentiel d’assumer politiquement les pertes d’emploi dans les secteurs les plus émetteurs de Gaz à Effet de Serre. Il faut alors être suffisamment proactif pour que les politiques d’attractivité et de soutien aux entreprises soient renforcées sur ces secteurs bas carbone, afin qu’ils offrent les opportunités d’emploi que les personnes à reclasser sont en droit d’attendre.Œuvrer au circuit local de l’argent en multipliant les véhicules d’investissements de proximité (fonds, CIGALES, sociétés de capital-risque régionales). Les monnaies locales complémentaires devront également être beaucoup plus soutenues qu’elle ne le sont aujourd’hui : elles sont des leviers décentralisés très efficaces pour favoriser des chaînes d’approvisionnement et de distributions locales. Favoriser le recours des entreprises locales au système de financement de projets mis en place avec le Plan de relance de l’État et le Green New Deal européen. Ces plans reposent sur le principe d’un fléchage vers des thématiques clés de la transition écologique. Il est essentiel que les entreprises locales bénéficient de l’ingénierie de projet et de l’ingénierie financière qui leur permettra d’aller chercher ces ressources. Ce peut être le rôle de Scalen ou de Grand Nancy Innovation que l’accompagner les acteurs économiques locaux en ce sens.
Dans le domaine de la planification économique du territoire :
Augmenter sensiblement, à travers un effort de planification, les investissements productifs publics bas carbone, en créant une société d’équipement locale qui s’appuie résolument sur les outils financiers mis à disposition par l’Union Européenne. La transition écologique nécessite des investissements publics et privés importants. Or, ces dernières décennies, les plans d’ajustement structurels ont justement conduit à réduire l’investissement public. Dans une logique de planification, il est au contraire indispensable de programmer ces investissements bas carbone, via par exemple une société mixte permettant de conjuguer capitaux publics et privés.Prise de participation directe de la Métropole du Grand Nancy, avec le Conseil régional, dans les entreprises clés de la transition écologique du territoire, pour peu qu’elles aient leur centre de décision localement. Cela est essentiel pour orienter les stratégies industrielles et économiques vers la transition bas carbone, de manière cohérente et organisée.Orienter la commande publique en renforçant la pondération des critères environnementaux dans les appels d’offres du Grand nancy.
En matière de commerce :
L’approche sélective des projets bénéficiant d’un soutien public dont nous parlions plus haut doit être étendue à tous les leviers d’action en faveur des entreprises, en particulier à l’échelle locale. Les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) devront par exemple intégrer l’impératif de neutralité carbone dans l’évaluation des projets proposés, y compris en aval, au niveau du consommateur (par exemple : le nouveau commerce implanté devra proposer une solution de réemploi / réparation / recyclage et intégrer une chaîne régionale dédiée).La réorientation de la consommation que l’on a vue à l’occasion du confinement vers les circuits courts doit être saisie au vol, pour renforcer l’assise du commerce de centre ville. A la faveur des faillites qui ne manqueront pas de se produire dans les commerces périphériques, il importe que la puissance publique récupère les locaux laissés vacants et les friches pour les rendre à l’agriculture, et desserrer la contrainte foncière autour de la Métropole du Grand Nancy. Celle-ci pourra s’adresser à elle même un objectif de zéro artificialisation nette.
Ces quelques propositions méritent d’être affinées, précisées, chiffrées. Il nous semblait important, à ce stade, d’inscrire ces réflexions dans celles des équipes politiques qui se mettent en place sur la Métropole du Grand Nancy depuis les dernières élections, en posant les quelques jalons de ce que devrait être, selon nous, un développement économique local pleinement orienté en faveur de la transition écologique.
La crise du Covid-19, qui hélas en présage d’autres, nous offre justement l’opportunité de sortir d’un modèle de développement délétère et de mettre en place les bases d’une société bas-carbone. Ce choix de société doit d’abord être un choix démocratique, qui dépasse largement les cercles entrepreneuriaux, pour engager ensemble entreprises, collectivités, et associations, chefs d’entreprises et syndicats, consommateurs et citoyens, vers un avenir viable et désirable.
Emmanuel PAUL, Président de la SCIC Kèpos
Laure HAMMERER, Samuel COLIN et Ian Mc LAUGHLIN, salariés de Kèpos
Caroline ANTOINE, Artiste-Plasticienne et Paysagiste indépendante
Anne BLANCHART, Présidente de Sol &co
Yohan BLANCHE, Directeur d’Un Toit Partagé
Cécilia GANA, Gérante de Day by Day Nancy
Pierre-Antoine PHULPIN, Gérant de I Wood
Martin THIRIAU, Président de SOS Futur
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
9 novembre 2020RéflexionsLes réunions des membres de Kèpos sont parfois l’occasion de prendre un peu de hauteur. Ce fut le cas en octobre , lors d’une session intitulée « Enjeux philosophiques et spirituels de la transition écologique ». Kèpos recevait à cette occasion Xénophon Tenezakis, agrégé de philosophie, et Aramis Marin, enseignant-chercheur en gestion très intéressé par les questions de spiritualité.
En matière philosophique, il est possible de partir d’une question simple : « Comment en est-on arrivé là ? ». Couramment, on admet une opposition entre nature et culture, la première étant ce qui est là, et la seconde, ce qui entretient, ce qui cultive la nature. Chez les grecs, la nature est proche du cosmos, ce qui est ordonné. Les êtres croissent selon cette nature, qui est une forme d’essence. On ne peut dès lors « faire n’importe quoi », « sortir de la nature ». Il en va de même chez les Chrétiens, chez qui l’homme est dépositaire de la nature. Il en prend soin et respecte son ordre immanent.
Le progrès technique et scientifique vient bouleverser ces approches : il fait apparaître la nature comme chaos. Le monde n’a plus d’ordre, plus de but. Il importe dès lors à l’homme d’ordonner la nature, car il apparaît alors que, fondamentalement, l’ordre immanent au monde ne lui convient pas. L’humanisme est ce moment où l’homme apparaît au-dessus de tout.
Cependant, on ne peut tout maîtriser, et très vite apparaissent des effets imprévus à l’action humaine, l’homme, par définition, n’ayant pas une vision globale. C’est alors que l’environnement conditionné par l’homme conditionne l’homme en retour. La maîtrise semble seulement partielle, et tout un ensemble de désordres apparaissent : changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution généralisée des écosystèmes, etc. Très vite, la question que nous nous posions initialement devient : « Que faire ? »
La première option serait sans doute de faire de la nature un nouvel absolu, quelque chose de sacré ayant une valeur religieuse. On peut craindre cependant l’aspect dogmatique de la solution.
La deuxième option serait de renforcer notre approche technologique, afin de mieux maîtriser la situation, les effets imprévus dont nous avons parlé tout à l’heure étant alors vu comme un déficit de technologies. Mais il est cependant fort probable que ce qu’il s’agit d’appréhender, dans sa globalité, excède les capacités d’absorption de l’homme.
La troisième possibilité, qui peut paraître plus raisonnable, est de développer une autre technologie, reposant sur les interactions Win/Win. Cela implique de considérer que l’homme ne fait qu’un avec la nature, car en modifiant la nature, l’homme se modifie lui-même. Il importe alors de trouver les formes d’interaction non nocives. Au cœur de cela se trouve l’idée d’interdépendances, notamment locales. Cela suppose une science qui ne se déploie pas sur le modèle de la loi universelle, et un effort pour sortir de la standardisation. Le fait que ces interdépendances soient locales rend cela très difficile, à l’heure où les interdépendances sont surtout globales. Finalement, il ne s’agit de pas autre chose que de chercher à « faire entrer le dentifrice dans le tube », que l’humanité récente s’est appliquée à faire sortir !
Au-delà de ces réflexions philosophiques, Aramis Marin, très proche de la spiritualité dite ignatienne, issue des Jésuites, donne des éléments supplémentaires sur ce qui peut nous inviter à initier et conduire la transition écologique. Sa thèse est simple : fondamentalement, il ne faut rien changer ! La transition doit venir naturellement, telle quelque chose qui naît.
Pour cela, un effort de définition doit être fait sur ce qu’est la spiritualité. Il s’agit là d’une dimension humaine importante, relative à la perception que l’homme a de lui-même dans sa relation au monde. Cette dimension spirituelle est très liée à la question de la transcendance. Mais c’est aussi une expérience, une chose à vivre liée à un système de croyances. C’est enfin, une finalité, vue comme ce que j’espère.
Dans ce cas, pourquoi parler spiritualité lorsque l’on évoque la question de la transition écologique ? Plusieurs éléments peuvent être cités :
La dimension spirituelle nous permet en la matière d’avoir accès à un horizon plus large, qui fondamentalement nous oriente vers la sobriété, voire, pour certains, l’ascèse.Elle nous invite à gagner en liberté, car elle remet en perspective la question de la finalité et des moyens. In fine, l’homme peut y trouver la paix.Enfin, c’est un bon moyen pour ne pas se fatiguer : un activiste avec son énergie propre se fatigue vite, celui qui puise dans une transcendance trouve des ressources externes utiles pour avancer loin.
Dès lors, comment mettre en place cette spiritualité de la transition ? L’approche est relativement simple. Tout d’abord prendre du recul, de la hauteur, de la distance (marcher, écrire, parler). Il importe en effet que « l’eau soit tranquille ». Puis contempler et méditer, pour admirer ce que l’on voit et écouter les mouvements intérieurs que l’on perçoit. Enfin, se laisser éprouver par une austérité en vue d’une ascèse joyeuse. Ce choix de la pauvreté ouvre vers la mystique et le lien avec la terre vécue comme ce qui nous donne ce dont on a besoin. Au final, il est alors possible de sortir de l’accablement pour construire la résilience.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
29 septembre 2020RéflexionsLa transition écologique appelle un changement profond des comportements individuels. Mais comment y parvenir ? C’est sur cette question que butent beaucoup d’initiatives publiques et privées pourtant très louables. Il semble que ces comportements ont une inertie absolument terrible, et qu’hélas, alors que l’urgence climatique menace, nous en soyons réduits à des petits pas. Et pourtant, la situation pourrait être résumée avec une phrase de Winston Churchill : « Mieux vaut prendre le changement par la main, avant qu’il ne nous prenne à la gorge ».
Ces enjeux étaient à l’ordre du jour d’une rencontre organisée par l’association Citoyens & Territoires, à la Cité des paysages, sur la colline de Sion, le 17 septembre dernier. L’occasion d’échanges très riches, sous l’éclairage d’une enseignante-chercheuse en psychologie sociale, Lolita Rubens, dont nous nous permettons de reprendre à grands traits l’exposé.
Si les comportements sont parmi les choses humaines un des traits les plus difficiles à modifier, c’est parce nous sommes actuellement dans une situation où ce qui nous fait le plus défaut, c’est l’attention. Et précisément, nous sommes tous pris dans une série d’injonctions que nous adressent notre rythme de vie, la publicité ou nos téléphones portables. Dans ces conditions, il est très difficile de relever la tête pour mener une réflexion construite sur ce qui serait, parmi nos habitudes, des comportements souhaitables.
Mais alors, sur quels leviers s’appuyer pour faire évoluer des comportements ? Le premier d’entre eux consiste à « inhiber l’habitude », c’est à dire à réussir à desserrer la contrainte de l’habitude pour en faire évoluer les paramètres. L’exemple choisi par Lolita Rubens concerne les nudges, ces incitations, parfois ludiques, qui réorientent nos comportements. Peuvent être ainsi modifiée des interfaces hommes/machines, des aménagements urbains, des équipements collectifs. On va alors gamifier les usages ou formuler les choix à effectuer d’une manière qui change les réponses apportées par les utilisateurs. Nous sommes ici très loin de changements structurels, et la liberté de l’individu est à peine prise en compte. En outre, l’effet du nudge peut vite s’épuiser. Bref, nous n’atteindrons pas nos objectifs de changement de comportement qu’avec ce type d’approches.
Le deuxième levier est plus puissant. Il laisse la place à la persuasion pour modifier les attitudes des agents. Par attitudes, on entend alors les représentations qui déterminent les comportements. Le discours rationnel devient possible, mais à lui seul, il ne suffira pas. Deux autres leviers doivent être actionnés concomitamment : les normes collectives et le contrôle perçu. En effet, il faut que l’agent puisse se rattacher à un système de normes, partagées collectivement, qui lui indiquent qu’il n’est pas seul dans ses efforts, et que son action conjuguée à celle des autres les oriente vers un avenir souhaitable, désiré en commun. C’est tout le rôle du story telling et de films comme Demain, qui indiquent une direction que l’on a envie de suivre avec d’autres. Mais persuasion et ancrage dans un système de normes partagées ne sont pas suffisants : il faut que l’agent ait une impression de contrôle perçu sur la situation, qu’il sente qu’il est en capacité d’agir sur le système en question. Si l’on se contente de le mettre au courant de l’ampleur des mutations écologiques en cours, il va être sidéré, tétanisé, et se mettra hors service pour se protéger. Les gens ont peur quand ils ne savent pas quoi faire. Orienter la personne vers l’action concrète en lui donnant des clés sera anxiolitique et lui donnera la possibilité de transformer une compréhension intellectuelle en action opérationnelle.
Cette méthode est plus efficace et plus respectueuse de la liberté des individus que la précédente, mais on peut aller plus loin. Pour cela, il importe de regarder quels sont les facteurs d’un engagement personnel ou collectif. Ce qui apparaît, c’est que ce facteur d’engagement, c’est l’engagement précédent. Pour peu que l’on arrive, en utilisant l’un ou l’autre des leviers précédents, à initier un premier engagement, si léger soit-il, celui-ci va enclencher une dynamique vertueuse vers des engagements de plus en plus forts et consistants. L’engagement renforce l’engagement. C’est ainsi qu’un petit pas initial librement consenti peut permettre d’aboutir à des changements systémiques à l’échelle d’un individu, d’un collectif ou d’un pays. Il faut donc toujours capitaliser sur les réussites précédentes, si minimes fussent-elles.
Ce qui est intéressant avec cette idée, c’est qu’elle restaure un espace pour la liberté humaine, et partant, pour la dignité de la personne. En effet, la monopolisation de l’attention des individus est une forme d’aliénation, par laquelle la personne ne s’appartient plus, mais agit en fonction d’algorithmes qui la conditionnent. Or, l’engagement, c’est la liberté. Cette logique d’engagements croissants est liée à une logique d’émancipation, d’empowerment qui rend possible, pour l’homme, une réappropriation de ses conditions d’existence. Tout n’est donc pas perdu, pour peu que nous sachions relever la tête de nos écrans !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
24 août 2020RéflexionsLes coopérateurs de Kèpos ont reçu récemment lors de l’une de leurs réunions Yves Leroux, enseignant-chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industrie Alimentaires (ENSAIA) de Vandœuvre-lès-Nancy. Après avoir déjà échangé avec un agriculteur, ils poursuivent ainsi la réflexion sur la nécessaire transition de notre système alimentaire. Le texte ci-dessous est la synthèse des propos tenus à cette occasion.
On se fait souvent une mauvaise image de la nécessaire transition de notre système alimentaire. Cela est dû au point de vue qui est souvent adopté, celui du militant. Or, nous baignons dans un système agro-industriel qui a connu ces dernières décennies un développement hégémonique. Ce système est d’abord un système de masse. Il y a certes des niches bien connues (les Amap par exemple), mais ce qui importe, c’est la masse.
Ce système est rentré dans une logique de financiarisation qui fait que la firme n’est plus pilotée par des industriels, mais par des financiers qui cherchent à optimiser financièrement les modèles. Ceux-ci ont donc subi une modification complète de leur gouvernance. Cela a abouti à une diminution spectaculaire du coût des aliments. Ainsi, le budget alimentaire des ménages, qui représentait 30 % de leur budget total dans les années 60, n’en représente plus que 12 % aujourd’hui. Entre temps, c’est le logement qui est devenu le principal poste de dépense.
Dans ce contexte, il faut bien comprendre que l’alimentation est une politique européenne. La Politique Agricole Commune (PAC) est même la seule politique complètement intégrée en Europe. Son objectif initial était d’obtenir l’autonomie alimentaire de l’Europe. A sa création en 1962, elle s’est inscrite dans une logique protectionniste, visant à produire plus, à garantir un revenu à tous les paysans, à mettre à disposition des consommateurs des produits pas chers et répondant aux enjeux d’hygiène, pour limiter très fortement les maladies d’origine alimentaire. Cette politique a remarquablement fonctionné, mais s’est traduite par de très fortes externalités négatives (des effets pervers externes au système). Tout l’enjeu aujourd’hui est de ré-internaliser ces externalités négatives, en les faisant rentrer à nouveau dans le prix des aliments. Pour que ces effets indirects aient une valeur dont les agents économiques tiennent comptent, il faut les monétariser.
Le système alimentaire français est très complexe. Le taux d’autonomie alimentaire de la France est très élevé, atteignant les 50 %. Mais malgré cela, nous sommes pris dans un système d’échanges permanents, et ce aux échelles régionales, nationales et internationales. La logique d’une concurrence libre et non faussée est ce qui préside à la vie du système. Ce fonctionnement est indissociable d’un modèle qui est avant tout linéaire, de type extractiviste : on extrait des matières premières, on les transforme, on les distribue et elles deviennent des déchets après avoir été consommées. Ces matières premières sont recherchées sur la terre entière, aidées en cela par un coût de l’énergie particulièrement faible. C’est ainsi que les coûts de transport sont moindres que le différentiel de prix entre la France et les pays tiers. On renvoie ainsi les activités de production dans les zones les plus efficaces, sans tenir compte des externalités. Au final, on arrive à une situation où l’on puise sans limite dans l’environnement, on externalise le métabolisme, on déresponsabilise chacun. Dès lors, le locavorisme (le fait de manger local) n’est pas la solution : il faut développer son autonomie alimentaire sans viser un maximum. Pour rappel, l’autonomie alimentaire de Nancy est de 0,92 %, et celle du Grand Est de 6 % (le maximum français est atteint par la région d’Avignon, avec 8%).
Reprenons un peu de hauteur : le système terre se heurte aujourd’hui à un certain nombre de limites (réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, perte de fertilité des sols, etc.). 5 des 9 principales limites de ce type concernent le système alimentaire. Pour exemple, l’impératif de neutralité carbone d’ici 2050, tel qu’il est inscrit dans la loi, implique à cet horizon un bouleversement complet de notre économie. Du point de vue de notre empreinte carbone, cela veut dire passer de 600 millions de teqCO2 à 80 millions, dont la moitié pour notre alimentation.
Au vu de ces bouleversements, la transition écologique désigne le passage d’un système d’équilibre à un autre. Il importe donc de la mener en s’appuyant sur des méthodes et des indicateurs. Le mot clé devient alors « bio-économie-circulaire » : il s’agit tout simplement de produire du carbone renouvelable. A partir de la biomasse, il faut donc générer de l’alimentaire et du non alimentaire.
Or, nous avons face à nous deux modèles faciles à comprendre : un dominant, de type agro-industriel, et un très marginal, de type hyper-local. Le but aujourd’hui est de remettre du commun dans tout cela, en termes de qualité, de proximité, de partage de la valeur ajoutée, et de justice sociale, sans tomber dans les procès d’intention. En effet, les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) représentent 85 % du marché : on ne peut pas les négliger. L’hyperlocal ne pèse lui pas plus de 3 % de la consommation alimentaire. C’est un système marginal quantitativement, mais pas qualitativement. L’enjeu principal est donc de définir le Local, le système alimentaire du milieu, en passant d’un modèle linéaire à un modèle circulaire. Cela veut dire reterritorialiser les activités, se réapproprier les enjeux, apprendre la coopération, plus efficace à long terme que la concurrence. Cette coopération doit être pensée entre des métiers complémentaires, à l’instar de ce que Kèpos expérimente, en gardant un équilibre avec le fonctionnement concurrentiel. Cela veut dire construire des contrats circulaires, au lieu de chercher, sur un mode linéaire, à optimiser sans cesse sa position par rapport à l’autre. Cette circularité ne peut être que contractuelle.
Le système actuel se caractérise par son absence de sens, car c’est le paysan qui a une histoire à raconter, pas l’industriel. Et aujourd’hui, 15 millions de consommateurs n’ont qu’un arbitrage prix. Ils n’iront jamais chez « C’est qui le patron ? » : ils n’en ont ni la culture, ni les revenus. Or, c’est précisément vers ce type de personnes qu’il faut aller : ceux qui ne sont pas militants et n’en ont pas les moyens. Pour cela, il faut une politique claire de la puissance publique, qui doit passer à coup sûr par la restauration collective (un repas sur 6 en France). Il faut que toutes les collectivités proposent de la qualité, de la proximité, de la justice sociale et du partage de la valeur ajoutée. Cela contribuerait à créer une sorte de sécurité sociale de l’alimentation, dans une société qui reste très structurée par la propriété privée. Et pour développer une logique de type locale, il faut un outil industriel adapté, et un ensemble de méthodes d’action publique pour réinternaliser les externalités : taxes, réglementations, transferts de propriété de type crédit carbone, qui assurent peu à peu à notre société de disposer d’un système alimentaire bas carbone et résilient.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
4 juin 2020RéflexionsCe texte sur la transition écologique de l’économie régionale est une contribution à la consultation lancée par la Région Grand Est dans la perspective de la rédaction d’un Business Act Regional, en même temps qu’une tribune, signée par deux professionnels du développement territorial :
Emmanuel Paul, président de la SCIC Kèpos, qui réunit à Nancy une vingtaine de jeunes entreprises engagées dans la transition écologiqueStéphane Gonzalez, chargé de développement économique pour une collectivité territoriale de la région.
Il est publié simultanément sur le blog “Projets pour la transition écologique“, et le site Notre Plan.net. Il a été envoyé à tous les élus du Conseil régional Grand Est.
L’Etat et le Conseil régional Grand-Est viennent de lancer un “Business Act”visant à élaborer un plan de relance ambitieux, suite à la crise sanitaire du Covid-19. La démarche paraît salutaire : selon la note de conjoncture de l’INSEE du 7 mai 2020, la région a enregistré une baisse d’activité de près d’un tiers, et selon la Dares (Ministère du travail), le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A, n’ayant pas du tout travaillé au cours du mois précédent) y a progressé de plus de 22% entre mars et avril, soit la plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée. En France, on comptait fin avril plus de 4,5 millions de demandeurs d’emploi (catégorie A), soit 30% de plus depuis fin janvier.
La crise du Covid-19 révèle nos fragilités
Mais s’il s’avère aujourd’hui indispensable de réviser les stratégies et les modalités du développement économique régional, c’est aussi et surtout parce que la crise sanitaire a révélé de grandes fragilités.
Fragilité d’abord de notre système de soins. La logique comptable des dernières années a profondément affaibli l’hôpital public, malgré les alertes constantes des personnels soignants. Ainsi, au début de la pandémie, la France comptait un nombre de lits et de places en soins intensifs bien plus faible que l’Allemagne, par exemple. Mais c’est surtout sur la disponibilité des masques et des tests que la différence a été la plus tangible. Alors que l’Allemagne, ou la Corée du sud, ont pu procéder massivement à des tests pour isoler rapidement les malades, en France, comme ailleurs, leur absence a conduit à la seule stratégie possible, celle du confinement généralisé, au détriment de l’activité économique.
La pandémie a aussi mis au premier plan la fragilité d’un certain modèle de développement, marquant ce qui serait, au yeux de nombreux observateurs, la fin de la mondialisation telle que nous l’avons connue jusqu’à présent. Notre très forte dépendance industrielle vis à vis de la Chine a ainsi conduit, dans un pays aussi développé et avancé technologiquement que le nôtre, à la pénurie d’un produit aussi simple à réaliser qu’un masque chirurgical !
Nous sommes dans un moment historique : la “crise” est étymologiquement le moment de la décision, du tri. Or, comme l’exprime si bien Bruno Latour, cette crise sanitaire est comme “enchâssée dans ce qui n’est pas une crise – toujours passagère – mais une mutation écologique durable et irréversible. Si nous avons de bonne chance de « sortir » de la première, nous n’en avons aucune de « sortir » de la seconde. Les deux situations ne sont pas à la même échelle, mais il est très éclairant de les articuler l’une sur l’autre.”
Faire face à la mutation écologique
Si de puissants intérêts économiques et financiers cherchent aujourd’hui à différer ou faire annuler des normes environnementales estimées trop contraignantes, la réalité matérielle, physique, du globe, se rappellera toujours à nous. Rappelons ici brièvement quelques unes de ces “données de base”. Le changement climatique est bien entamé, et nous en voyons régulièrement les manifestations. Si les émissions mondiales de Gaz à Effet de Serre (GES) se poursuivent au rythme actuel, nous atteindrons les +1,5 °C entre 2030 et 2050 (pour atteindre au moins +4 °C d’ici la fin du siècle) c’est à dire que nous entrerions, d’ici 20 ou 30 ans à peine, dans un monde totalement différent de celui que nous avons connu jusqu’alors, celui-là même qui a permis la formidable croissance économique des 70 dernières années : multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, vagues de chaleur), qui deviendront des menaces permanentes ; baisse des rendements agricoles et de la pêche, partout sur la planète, sous l’effet conjugué du réchauffement et des atteintes diverses à la biodiversité (urbanisation, usage des pesticides et insecticides, pollutions des terres et des mers). Augmentation de la mortalité directe due aux pics de chaleurs, problèmes d’accès à l’eau (notre région connaît depuis plusieurs années déjà des situations de sécheresse structurelles), et augmentation de la propagation de maladie portées par les insectes, notamment. Rappelons ici au passage que de nombreux scientifiques établissent un lien au moins indirect entre les atteintes à la biodiversité (braconnage, déforestation) et l’apparition de nouveaux virus engendrés par zoonose comme le Sars-Cov-2.
La société civile est de plus en plus consciente de ces enjeux. Les marches pour le climat, les mouvements de jeunesse, les associations et ONG ont contribué à faire connaître et affirmer la priorité de ces questions (plus de deux millions de signataires pour la pétition “L’Affaire du siècle”, par exemple). Les étudiants ne sont pas en reste, en “refusant de contribuer par leur travail à l’accélération des crises environnementales et sociales et souhaitant mener une activité professionnelle cohérente avec l’urgence écologique” (l’Appel pour un réveil écologique compte déjà plus de 32 000 signataires et concerne 400 établissements en Europe). Les consommateurs eux-même se déclarent beaucoup plus sensibilisés, affirmant de plus en plus leurs préférences pour l’alimentation bio, les produits issus de circuits courts, les marques les plus respectueuses de l’environnement. Les entreprises de notre territoire doivent donc aussi prendre en compte ces tendances de fond !
Réinvestir la Planification
C’est le propre des entreprises d’appréhender et de trouver des réponses à ce type de contrainte, et même de s’en saisir pour les transformer en opportunités, et de le faire mieux que leurs concurrents ! Mais ces mêmes entreprises ont besoin de visibilité, d’une stratégie claire, globale et cohérente, de long terme pour pouvoir y inscrire leurs propres stratégies de développement, programmer leurs investissements. Or, et c’est tout le paradoxe de notre situation, les entreprises et les banques les plus éclairées et conscientes de ces enjeux appellent justement les autorités publiques à de nouvelles formes de régulation ! Elles le savent, le “business as usual” est incapable d’appréhender les défis du changement climatique, les “externalités négatives” comme les pollutions diverses ou les émissions de CO2 n’entrant pas dans leur champ comptable. En la matière, il revient donc à la force publique d’agir et d’affirmer des orientations fermes et contraignantes, et surtout de réduire les incertitudes pour faciliter la bonne marche des acteurs économiques.
L’Histoire est riche d’enseignements à cet égard. Dans un papier récent, le grand historien Patrick Weil rappelle que lors de la première guerre mondiale, jusqu’à l’issue de la seconde, l’Etat a su mettre en place une forme de planification : “dans l’administration, il y avait encore beaucoup d’ingénieurs et au sein du gouvernement, des personnalités qui surent prendre des tournants immédiats et radicaux. La réquisition puis la planification ne leur firent pas peur, pas plus qu’au patronat, à qui elle signifiait que l’entreprise devait songer, au-delà de la satisfaction de ses actionnaires, à sa responsabilité sociale. (…) Aujourd’hui, le chômage de masse n’attend même pas la victoire contre la pandémie pour exploser, tandis que se profile à l’horizon une nouvelle guerre de l’humanité contre un ennemi commun, le réchauffement climatique. La planification doit redevenir non le cadre de toute l’action économique mais, selon la méthode de Monnet, une coopération dans des secteurs-clés, décisifs aujourd’hui pour l’emploi et le climat.”
Vers une nouvelle économie industrielle
S’agissant par exemple de l’industrie, un consensus semble se dégager, à l’occasion de l’épidémie de Covid-19, pour affirmer que la relocalisation des activités productives est une nécessité pour notre pays et pour l’Europe. En ce sens, nous vivons maintenant une fenêtre d’opportunité exceptionnelle, qui peut permettre dans le même temps à cette industrie nationale et européenne d’opérer sa transition écologique. Cela étant, il va nous falloir gérer cette mutation dans un contexte de ressources énergétiques, matérielles et financières anémiées. C’est toute la difficulté de la phase qui s’ouvre. Comment donc l’appréhender ?
Trois séries de causes peuvent être évoquées pour expliquer la déshérence industrielle de la France. La première est liée à la dynamique des gains de productivité dans l’industrie : ceux-ci font que l’on produit la même valeur ajoutée avec des ressources humaines moindres. C’est ce qu’explique le prix Nobel d’économie Paul Krugman : la destruction d’emploi dans l’industrie vient du fait que l’on produit autant avec moins d’hommes. La deuxième série de causes a trait à la non-soutenabilité en France et en Europe des activités productives intenses en travail. En effet, dès que l’on parle de production de masse à faible valeur ajoutée, les coûts salariaux des pays d’Europe occidentale ne sont pas compétitifs par rapport à ceux de l’atelier du monde qu’est devenu la Chine. Enfin, la troisième série de causes concerne les trajectoires économiques divergentes des pays de la Zone Euro. Celle-ci n’est pas suffisamment intégrée, notamment en termes budgétaires, et immanquablement se font jour des pays du Sud qui consomment et accueillent des touristes, et des pays du Nord qui produisent cher des biens pour l’exportation qui valent chers. C’est trois séries de facteurs ont décimé l’industrie française.
Mais cette dernière fait aujourd’hui face à un enjeu encore plus crucial, existentiel pour l’avenir de nos sociétés : le verdissement de ses process. La situation actuelle se caractérise par une sous-traitance de l’activité industrielle à la Chine et aux pays à bas coûts, et donc une externalisation de nos émissions de gaz à effet de serre. Il nous faut donc rapatrier ces activités chez nous, et les verdir dans le même temps. Par ailleurs, l’explosion du chômage qui suit l’épidémie de Covid va impliquer une réorientation de l’offre de travail vers les secteurs clés de la transition écologique, par exemple la rénovation thermique des bâtiments, ou encore l’agriculture. Pour piloter cette transformation, rien ne se fera sans un effort conséquent de planification, dans la tradition du Commissariat Général au Plan. Tout cela devra s’opérer avec une demande dépréciée qui va se traduire par des débouchés moindres pour l’industrie. En même temps, cela est une chance, un aiguillon pour réorienter la consommation dans une logique de sobriété en phase avec ce que nos écosystèmes peuvent supporter.
Nos propositions pour la transition écologique régionale
C’est donc bien à une nouvelle forme de planification et à de nouvelles régulations que nous appelons aujourd’hui. Elles doivent prendre forme dans le cadre d’un développement économique décentralisé qui, depuis la loi Notre, s’appuie sur les deux piliers que sont la Région et les Métropoles. Nous sommes convaincus que la crise du Covid-19, qui appelle un soutien nécessaire de la collectivité auprès des branches et des entreprises les plus touchées, offre justement l’opportunité de mettre en place de nouvelles orientations capables de prendre en charge les enjeux écologiques, qui représentent la plus forte menace pour nos société, à moyen terme.
Pour cela, plusieurs leviers devraient être actionnés, simultanément :
Dans le domaine de la formation et des ressources humaines :
Réorienter le Plan de formation régional en investissant massivement dans la formation professionnelle des personnes qui vont perdre leur emploi, pour réorienter cette force de travail vers les secteurs de la transition écologique. La bonne nouvelle étant que la transition écologique devrait se solder par une création nette d’emploi, via la relocalisation d’activités et le développement de nouvelles filières (recyclage, réemploi, travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments existants, etc.). On pourrait par exemple s’inspirer du programme ECECLI qui, a recensé, qualifié et quantifié les nouveaux métiers de la transition écologique ainsi que l’évolution des métiers existants, par grands secteurs, pour la région Ile-de-France. Mené en collaboration avec les branches professionnelles, ce travail permettrait de dégager une stratégie partagée des enjeux des grandes secteurs d’activité.Assumer les pertes d’emploi dans les secteurs les plus émetteurs de Gaz à Effet de Serre. Ceci est clairement le cas dans l’automobile : l’électrification du parc n’aura qu’un impact limité en matière d’émissions de GES si la taille du parc n’est pas revue à la baisse. La diminution du poids des voitures et une diminution de moitié du parc de voitures disponibles doivent être un objectif politique. A ce sujet, le pôle “Véhicule du futur” a un rôle essentiel à jouer, mais il devra intégrer beaucoup plus fortement les objectifs de neutralité carbone et de sobriété. Il est par exemple inutile de développer le véhicule autonome aujourd’hui si son modèle économique ne prévoit pas, dès l’origine, que ce sera un véhicule partagé (risque d’effet rebond).Créer une filière de formation initiale et continue de haut niveau pour les cadres industriels sur le management de la transition écologique dans l’industrie.
Dans le domaine réglementaire :
Renforcer les contrôles liées aux normes et règles environnementales actuelles. Cela est vertueux pour l’environnement, et dans le même temps protège le marché intérieur : les produits manufacturés issus de Chine ou d’Asie du Sud-Est, pour peu qu’on les contrôle vraiment, ne sont la plupart du temps pas au niveau des standards demandés. Renforcer le champ et les obligations liées à la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) pour renchérir de façon considérable l’usage des produits low-cost importés, et rendre plus accessible les produits à durée de vie longue ou réparables. Cela solvabiliserait immédiatement les filières de réemploi.
Dans le domaine de la planification industrielle du territoire :
Augmenter sensiblement, à travers un effort de planification, les investissements productifs publics bas carbone, en créant une société d’équipement régionale qui s’appuie résolument sur les outils financiers mis à disposition par l’Union Européenne. La transition écologique nécessite des investissements publics et privés importants. Or, ces dernières décennies, les plans d’ajustement structurels ont justement conduit à réduire l’investissement public. Dans une logique de planification, il est au contraire indispensable de programmer ces investissements bas carbone, via par exemple une société mixte permettant de conjuguer capitaux publics et privés.Prise de participation directe du Conseil régional et des métropoles dans les entreprises clés de la transition écologique du territoire, pour peu qu’elles aient leur centre de décision sur la région. Cela est essentiel pour orienter les stratégies industrielles et économiques vers la transition bas carbone, de manière cohérente et organisée.Orienter la commande publique en renforçant la pondération des critères environnementaux dans les appels d’offres.
Dans le domaine du financement :
Ne plus soutenir avec de l’argent public aucun projet d’innovation ou d’investissement qui ne soit pas, sur la base d’une évaluation ex-ante, compatible avec l’objectif de la neutralité carbone en 2050. Faire de même avec les Prêts Garantis par l’État (PGE) et autres outils financiers spécifiques à la période Covid. Comme l’affirme la Convention citoyenne pour le Climat, il faut cesser de soutenir “l’innovation pour l’innovation”. Il ne s’agit pas de contrôler ex-ante toute innovation : simplement, une innovation ou un investissement industriel qui ne répondra pas aux objectifs de neutralité carbone ne pourra dorénavant plus bénéficier du soutien financier public (fonds régionaux, appui des dispositifs territoriaux comme les incubateurs, BPI). Nous affirmons ainsi le rôle indispensable de la collectivité d’orienter le développement économique en faveur de la transition, ce que le marché est aujourd’hui incapable de faire, seul.Cette approche sélective des projets bénéficiant d’un soutien public devra être étendue à tous les leviers d’action en faveur des entreprises, en particulier à l’échelle locale. Les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) devront par exemple intégrer l’impératif de neutralité carbone dans l’évaluation des projets proposés, y compris en aval, au niveau du consommateur (par exemple : le nouveau commerce implanté devra proposer une solution de réemploi / réparation / recyclage et intégrer une chaîne régionale dédiée).Œuvrer au circuit local de l’argent en multipliant les véhicules d’investissements de proximité (fonds, CIGALES, sociétés de capital-risque régionales). Les monnaies locales complémentaires devront également être beaucoup plus soutenues qu’elle ne le sont aujourd’hui : elles sont des leviers décentralisés très efficaces pour favoriser des chaînes d’approvisionnement et de distributions locales.
Les questions fiscales sont essentielles pour réorienter l’économie. Même si elles ne sont pas du ressort de la Région, nous ajoutons deux actions supplémentaires dans ce domaine :
Relancer la taxe carbone, en la ciblant uniquement sur les entreprises, pour que les solutions de sobriété deviennent plus rentables que les solutions carbonées, et en affecter les produits à l’accès des ménages modestes aux modes de vie bas carbones.Réorienter la fiscalité afin de renforcer le coût du capital, et diminuer le coût du travail, pour rendre plus compétitives les solutions peu intenses en capital mais intenses en main d’œuvre. C’est la voie pour modérer l’innovation technologique qui cherche à substituer la main d’œuvre humaine par des solutions techniques : une piste essentielle vers la sobriété et de création d’emplois.
Les échelons européens, nationaux et régionaux sont étroitement imbriqués. On ne peut parler de l’un sans faire appel à l’autre. Nos propositions pour la région ont donc nécessairement des résonances nationales ou européennes.
Ces quelques propositions méritent d’être affinées, précisées, chiffrées. Il nous semblait important, à ce stade, de répondre à l’appel à contributions lancé par l’Etat et le Conseil Régional Grand-Est à l’occasion du Business Act, en posant les quelques jalons de ce que devrait être, selon nous, un développement économique régional pleinement orienté en faveur de la transition écologique.
La crise du Covid-19, qui hélas en présage d’autres, nous offre justement l’opportunité de sortir d’un modèle de développement délétère et de mettre en place les bases d’une société bas-carbone. Ce choix de société doit d’abord être un choix démocratique, qui dépasse largement les cercles entrepreneuriaux, pour engager ensemble entreprises, collectivités, et associations, chefs d’entreprises et syndicats, consommateurs et citoyens, vers un avenir viable et désirable.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
11 mai 2020RéflexionsLes
querelles sur les limites et vertus du système de santé français
ont semblé, à la faveur de l’épidemie de Covid-19, déboucher
sur un consensus que l’on pourrait résumer comme suit « Notre
système de santé est le meilleur du monde, mais les choix de
politique économique néolibérale ont ruiné l’hôpital, qui
s’est retrouvé en difficulté dans la durée, ce qu’a bien
montré le manque d’équipements durant l’épidémie ». On
arrive alors à la conclusion que l’après-convid va être le
moment d’un réinvestissement dans la solidarité et dans les
services publics, pour mettre le système au niveau de l’implication
des personnels soignants pendant la crise.
Sans remettre en cause l’avis vulgaire, nous voulons ici le nuancer, afin de pouvoir éclairer en retour les questions de transition écologique. Car en effet, que penser de la prétendue asphyxie dont serait victime l’hôpital public. Prenons deux séries de chiffres pour mieux saisir le problème : selon les données de l’Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé (IRDES), en Euros constants, les dépenses de santé à l’hôpital public ont augmenté de 393 % entre 1968 et 2008, alors que dans le même temps, la population française n’augmentait que de 28,6 %. Il en a résulté une augmentation des dépenses hospitalières par habitant de 283 % en l’espace de 40 ans. Sur une série temporelle plus courte et plus récente, on observe une augmentation des dépenses de santé au sein de l’hôpital public de 19,59 % de 2007 à 2014 quand, dans le même temps, la population française augmentait de 3,98 %. Il en est résulté une augmentation de la dépense par habitant de 15,01 % sur la période. On le voit donc, l’hôpital public ne subit aucune saignée : bien au contraire, les dépenses qui y sont faites augmentent bien plus vite que la population.
Impasses de la médecine
Comment donc interpréter l’impression dominante d’une institution sinistrée ? On peut évoquer plusieurs pistes, liées à l’organisation de l’hôpital et à sa gestion, mais aussi à la balance capital/travail en son sein, de même qu’à l’évolution des besoins qu’il est censé couvrir.
Commençons
par la question de la gestion. On nous présente la situation comme
le fruit d’un conflit entre les gestionnaires d’un côté, et les
soignants de l’autre, l’impression qui domine étant que les
premiers l’ont emporté face au second, au détriment de la qualité
de service. Sans nous prononcer sur ce point, on peut toutefois
remarquer que toute organisation, quelle qu’elle soit, n’évolue
pas dans un monde de ressources illimitées, et que dans ce cadre,
savoir la faire vivre, c’est précisément la gérer : allouer
des ressources. Ceci veut donc dire être le plus efficient
possible : atteindre les meilleurs résultats possibles en
maximisant l’effet de chaque euro dépensé. On peut le déplorer,
mais c’est une réalité incontournable : toute organisation
est obligée de faire des choix. Cela impose donc de définir en
conscience les missions à remplir. Or, c’est précisément ce que,
nous semble-t-il, ne sait plus faire la médecine, nous y reviendrons
ultérieurement. Retenons pour l’instant qu’aucune organisation
n’a de moyens discrétionnaires : il nous faut tous évoluer
dans un monde de ressources finies. C’est le cas de l’hôpital,
comme de la société dans son ensemble, qui a l’impression d’être
à l’os alors qu’en fait la part de la richesse nationale qui y
est consacrée est sans cesse croissante.
Deuxième
point : la balance capital/travail au sein de l’activité de
soin. Quiconque fréquente un peu les structures hospitalières ne
peut qu’être frappé par l’ampleur des solutions technologiques
mises en œuvre : imagerie médicale, robots, molécules
hyper-complexes, systèmes d’information avec intelligence
artificielle… La médecine devient de plus en plus technologique,
intensive en innovation, et par là-même intense en capital. Cela
aboutit à une détérioration des ressources financières allouées
au travail, au bénéfice de celles mises au financement du capital.
D’où l’impression des personnels d’être sous-valorisés. Or,
le capital a une tendance naturelle à la concentration : pour
que des infrastructures ultra-chères puissent trouver un équilibre
économique, il faut qu’elles soient concentrées dans quelques
pôles, couvrant de très larges territoires. D’où l’impression
dominante que les petits hôpitaux de proximité sont délaissés :
ils sont tout simplement trop petits pour supporter les
investissements nécessaires à la médecine contemporaine. On arrive
donc à une équation du type innovation = technologie = intensité
en capital = détérioration des ressources humaines. Cette situation
n’est pas propre à la médecine : elle se retrouve dans
l’ensemble de l’économie et de la société. Elle est un élément
saillant de la crise écologique actuelle.
Enfin,
le dernier élément d’appréciation que nous voulons donner a
trait à l’évolution des besoins des patients et des missions de
la médecine. Prenons pour point de départ la question de
l’espérance de vie, et de l’espérance de vie en bonne santé.
Les chiffres de celle-ci sont disponible sur
le site de l’INSEE depuis l’année 2004 jusqu’en 2018. Pour
lisser la variabilité naturelle, nous travaillerons ici sur des
moyennes mobiles sur 3 ans. Dès lors, de quoi se rend-on compte ?
De 2004 à 2018, l’espérance de vie à la naissance a progressé
de 2,53 années pour les hommes et 1,97 années pour les femmes. Sur
cette différence, 0,73 année sont du temps de vie en bonne santé
pour les hommes, et 0,13 année du temps de vie en bonne santé pour
les femmes. Ce qui fait que le gain de vie en « mauvaise
santé » est de 1,8 années pour les hommes, et 1,23 pour les
femmes. Bref, le gain d’espérance de vie en l’espace de 14 ans
est à 71 % du temps de vie en mauvaise santé pour les hommes,
et à 90 % pour les femmes.
Ce que l’on constate donc, c’est un vieillissement prononcé de la population, qui débouche sur une augmentation de la population âgée en mauvaise santé. Nul n’est besoin de s’étonner que cela entraîne des tensions au niveau de l’offre de soins à l’hôpital. Il semble clair qu’avec une population qui croît, et une population en mauvaise santé qui augmente, l’hôpital peut se trouver en difficulté. L’ironie est que cette situation d’augmentation des besoins est le résultat de la médecine contemporaine, au moins à deux niveaux. Le premier consiste en ceci que la médecine ne peut tout guérir, mais se heurte à la chronicité des maladies. C’est le cas par exemple pour les cancers, le diabète ou l’insuffisance rénale. Les patients se retrouvent dans une situation où ils doivent vivre avec la maladie. Il en résulte que les malades ne meurent plus, mais vivent plus longtemps malades. La tension du système de santé est générée par le système de santé lui-même, en forme d’effet pervers d’une médecine qui sauve de la mort jeune, et ce à un prix très élevé. L’autre élément qui explique l’augmentation des besoins, c’est le poids des maladies dues à l’environnement : sédentarité, mauvaise alimentation, pollution de l’air, des sols, de l’eau, modes de vie morbides (tabac, alcool, drogue) … Cette augmentation est liée à des politiques publiques qui ont fait le choix du curatif largement plus que du préventif. S’amorce alors une rétroaction positive qui aboutit à l’embolie du système via la multiplication des maladies chroniques.
Eclairage en retour des questions écologiques
Qu’en
retirer pour les questions écologiques qui nous concernent ?
Plusieurs choses :
Nous qui pensions que l’épidémie de Covid signait la faillite
d’un système ruiné par les politiques budgétaires, nous
pourrions finalement être amenés à penser qu’au contraire, nous
vivions à l’âge de la solidarité, spécifiquement en France où
le financement du système de santé est un des plus socialisés au
monde. De ce point de vue, il n’est pas du tout certain que
l’avenir, avec une économie potentiellement en dépression, soit
plus solidaire.
Il nous faut sortir des activités économiques à forte intensité
capitalistique, qui déséquilibre l’allocation des ressources en
défaveur des travailleurs. Le capital est un précipité de
technologie et d’énergie. Les solutions low tech à faible impact
sont précisément celles qui utilisent peu de ressources. Ainsi, un
champ en permaculture sera à la fois plus productif, plus
consommateur de main d’œuvre et plus respectueux de
l’environnement qu’un champ en monoculture cultivé avec des
robots. Il nous faut trouver le chemin de solutions technologiques
intensives en connaissances mais très diluées en capital.
Ces solutions sont d’abord des solutions de prévention avant
d’être des solutions de type curatif. Celles-ci ont souvent pour
but de corriger l’effet pervers de la technologie précédente.
C’est spécifiquement ce qui se passe avec les pathologies
environnementales. Pour en sortir, il nous faut réinterroger
l’impact des technologies précédentes pour les corriger. C’est
là le point clé : il est nécessaire de mettre les ressources
disponibles sur la prévention. Ainsi, atténuer le changement
climatique en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre
coûtera toujours beaucoup moins cher que le gérer quand il fera
+4°C à la fin du siècle.
Un dernier mot en forme de conclusion sur les missions de la médecine. Nous avons dressé tout à l’heure le constat en forme d’aporie d’un système de santé qui fait vivre plus longtemps, mais en mauvaise santé. Est-ce souhaitable ? Quelles sont les missions de la médecine ? Eviter à tout prix la mort, ou prendre soin en acceptant que toute vie a une fin. Ces questions complexes d’éthique médicale éclairent également un point clé des questions démographiques vues du point de vue de l’écologie. Nombreux sont en effet les militants qui pensent que la natalité est, dans le monde, trop forte pour ce que la planète peut supporter. Mais c’est oublier que dans nos pays, ce qui est très fort, ce n’est pas la natalité, mais l’allongement de la durée de la vie. C’est ceci qui explique l’augmentation de la population. Dans une tribune récente au Monde, Marie de Hennezel voyait dans la gestion du Covid-19 en France une forme de « déni de la mort ». N’est-ce pas réellement là où se trouve la difficulté actuelle ?
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
27 avril 2020RéflexionsAvant de parler de l’après-Covid, il paraît raisonnable de parler du pendant, qui n’est pas près de s’achever, tant au moins qu’un vaccin n’a pas été trouvé. Quant aux impacts indirects, il peuvent courir pendant des années voire des décennies. Un intervenant spécialiste de ces questions est intervenu dernièrement lors d’une réunion à distance de Kèpos, pour nous donner des pistes d’analyse économique et d’action entrepreneuriale. Son message : piloter son entreprise par la trésorerie.
Dans ce contexte
épidémique, trois scénarios semblent se dessiner pour l’activité
économique :
Un scénario
en V, où après avoir chuté vivement, l’activité redémarre
très vite.
Un scénario
en U, où l’activité chute fortement. S’ensuit une phase étale,
avant un redémarrage.
Un scénario
en L, où l’économie rentre en dépression, et ne redémarre pas.
Stratégie pour
tenir
A l’heure
actuelle, nous sommes déjà en récession, mais il semble possible
que l’activité reparte selon un scénario en U, du fait de la
réponse apportée par les gouvernements. En 2008, celle-ci n’avait
pas été suffisante, et les Etats n’avaient pas réagi assez vite
assez fort. D’une certaine manière, ils n’avait aidé que les
grandes entreprises. Ce n’est pas le cas aujourd’hui :
l’artillerie lourde a été sortie, et il y a bien un soutien au
tissu économique de proximité. Le but est d’empêcher à tout
prix des fermetures d’entreprises. D’où le chômage partiel et
les emprunts garantis par l’État, ceci afin d’empêcher un
scénario à l’américaine, où le chômage a augmenté de plus de
20 millions de personnes en quelques semaines. C’est ainsi qu’en
France, l’État paye les salaires. Même si cela s’avère très
coûteux, c’est en revanche très efficace. Un moratoire sur les
charges sociales pourrait même être envisagé. La garantie des
prêts vise à éviter la situation où une banque puisse refuser un
prêt à une entreprise. Il existe aussi des mesures européennes,
pour éviter des risques systémiques. La Banque Centre Européenne
organise une sorte d’ »open bar », pour éviter que le
système ne s’effondre faute de liquidités, dans une situation où
chacun voudrait garder sa trésorerie pour lui. A terme, on peut même
envisager le recours à la « monnaie hélicoptère » si
la demande est trop affaiblie. Cela reviendrait à soutenir la
demande en donnant des chèques aux particuliers. Tout ceci laisse à
penser que l’on est plutôt dans un scénario de type U, avec un
redémarrage possible en décembre. Dès lors, l’objectif devient
de tenir jusque là en ayant la trésorerie suffisante.
Dans ces conditions,
faut-il avoir peur de demander des aides à l’État ? Au
contraire, il faut foncer sur ces financements, même si on n’en a
a priori pas besoin. Car c’est la trésorerie qui fait que l’on
tient. C’est ainsi que toutes les grandes entreprises tirent en ce
moment des lignes de crédit. Renault vient ainsi de souscrire 4
milliards d’euros de prêts garantis par l’État. La pression est
forte sur les banques et il faut tirer les crédits maintenant sans
vergogne. Le risque pour l’État réside dans les entreprises
zombies, qui étaient déjà en difficulté avant. Mais en l’espèce,
l’État n’a pas intérêt à trier. Et mieux vaut avoir trop de
trésorerie et rendre que pas assez et disparaître. Il faut donc
avoir une gestion d’entreprise par le biais de la trésorerie, en
vérifiant sans arrêt son cash flow. Et tous les investissements à
long terme doivent être financés par des financements à long
terme.
Dans ce contexte,
quel serait l’endettement maximum d’une entreprise ? C’est
à apprécier selon son besoin de trésorerie. A chiffres d’affaires
égal, des entreprises ont des besoins en trésorerie différents.
Même si c’est une question dont la réponse est difficile à
donner dans l’absolu, il paraît aujourd’hui judicieux de
s’endetter, en fonction du montant de ses achats et de ses
salaires, pour tenir la trésorerie jusqu’en décembre.
Résilience des
entreprises
Cette crise est le
signe que les entreprises ne sont pas résilientes. La réflexion à
mener devient donc : comment rendre son entreprise résiliente
aux chocs externes ? Il faut pour cela penser que la vie des
entreprises est cyclique. Pour une entreprise, une croissance
permanente est impossible. Dans ce contexte, la relocalisation des
flux est une réponse à l’enjeu de résilience. Cela permet de
répondre mieux et plus vite aux chocs. On peut dire à l’heure
actuelle que la démondialisation est en route. La carte à jouer est
celle de la relocalisation sur de petits territoires.
Dès lors, des
changements forts doivent être opérés dans les entreprises :
à l’interne, une organisation plus résiliente permettant une
évolution dynamique, et à l’externe, une résilience par
écosystème, mettant au premier plan la complémentarité, la
mutualisation, qui forment des coussins d’amortissement en cas de
chocs. Un groupe constitué doit donc réfléchir à sa dynamique en
cas de chocs. L’agilité est une réponse collective. Il faut
anticiper collectivement les chocs exogènes, et imaginer les
réponses futures. Pour cela, il est indispensable de comprendre la
dynamique des crises. De ce point de vue, les vannes de l’argent
grand ouvertes aujourd’hui préparent sans doute, via leur impact
budgétaire, la crise prochaine.
Dimensions
financières de la crise
A l’heure
actuelle, on distribue de l’argent à tout le monde, augmentant
ainsi la masse de billets dans la poche des gens. On a ainsi beaucoup
de liquidités pour la même quantité de biens. Aux Etats-Unis, ce
sont 2000 milliards de dollars qui ont été injectés, en France 100
milliards d’euros. La dette publique de la France va dépasser très
largement les 100 % de son PIB. Tant que les gens ont confiance
dans leur monnaie, tout va bien. Mais il y a des risques que cela ne
dure pas. On est sur ce chemin-là, avec un risque lié à des
configurations économiques inconnues. Un exemple en est l’arrivée
des taux d’intérêts en territoire négatif. Les Etats aujourd’hui
ne pourraient plus supporter des taux d’intérêt élevés. On
aboutit alors à un système illogique, où on ne donne plus la bonne
valeur au risque, débouchant ainsi sur des incohérences, des
mauvaises incitations. Ni les banques, ni les épargnants ne gagnent
plus d’argent. Heureusement, l’inflation n’est, en tout cas
pour l’instant, pas un problème, et les Etats ne se livrent pas de
guerre sur ce point.
Pour mieux saisir
cette question, il faut bien comprendre d’où vient l’argent des
banques. Une banque ne prête pas son argent, ni celle de ses
déposants. Elle prête beaucoup plus que cela. Ses modes de
fonctionnement sont édictés par la BCE, et par des réglementations
dites « Bâle III ». Par exemple, si elle a 1000 € de
capital, elle va pouvoir prêter jusqu’à 10 fois plus. Elle crée
jusqu’à une certaine hauteur de l’argent, qui disparaîtra
ensuite au moment du remboursement. Aujourd’hui, une banque reçoit
de l’argent Open Bar de la BCE, et s’en sert pour prêter à
nouveau encore plus. Seule la BCE peut créer de l’argent à partir
de rien. La situation actuelle implique que les banques ne sont pas
bridées dans leur activité de création monétaire.
Dans ce cadre, y
a-t-il un risque qu’une banque puisse faire faillite ? A
priori non, car les banques sont devenues aujourd’hui de simples
agents de la BCE, ses distributeurs de monnaie. Celle-ci achète par
ailleurs les titres d’Etats en difficulté pour les rembourser,
l’Italie par exemple. Ceci a permis que la chaîne financière
tienne depuis la crise des dettes publique de 2011, et ce même si
les pays du Nord ont refusé la mutualisation des dettes entre pays.
Conclusions
politiques
Un dernier mot sur l’impact politique de tout cela. Les acteurs économiques vont voir ce qui n’a pas marché et mené à la crise actuelle. Les grandes entreprises vont modifier leur stratégie, et la relation politique avec la Chine va être reprise. On va assister à une forme de démondialisation. En sus intervient une crise du pétrole très grave, qui va déstabiliser les pays producteurs. La question va donc devenir : qu’est-ce qui fait de l’Europe une communauté ? Si l’entraide est la réponse, il est probable que des partis politiques vont en profiter pour renforcer leurs arguments anti-européens.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
27 mars 2020RéflexionsLa crise actuelle du Covid-19 emprunte un itinéraire déjà maintes fois parcouru par l’humanité dans son histoire : celui d’une épidémie. Sans doute, nous, modernes, étions certains d’échapper à ce genre de calamité. Les seules épidémies auxquelles nous pensions être sujets n’étaient pas infectieuses : tabagisme, cancer, diabète, dépression, obésité, addictions… Les grandes épidémies infectieuses étaient le propre de temps lointains, et pour tout dire, moyenâgeux. La preuve, nous avions réussi à juguler les dernières crises naissantes (SRAS, grippe H1N1…). Quant au Sida, il est sorti de notre perspective.
Et pourtant, toutes les prospectives un peu sérieuses savaient que ce genre de risque était latent, et, sa concrétisation, pour tout dire, inévitable. Sous l’effet de trois facteurs conjugués : la démographie galopante, l’augmentation exponentielle des flux, et le rapport vicié avec le monde animal. Sur la démographie, force est constater que le monde est, aujourd’hui, plein, et que l’homme y pullule telle une espèce invasive. De même que la concentration de personnes dans un bateau de croisière favorise les maladies sous l’effet de la promiscuité générale, de même, le concentration d’humains sur la planète transforme l’espèce humaine en un gigantesque bouillon de culture. Dans le même temps, l’explosion des flux de marchandises et de personnes offre les conditions pour une propagation inarrêtable de maladies, et ce tant dans la sphère végétale qu’animale ou humaine. Un groupe d’individus est malade, et c’est comme si toute l’espèce était bientôt malade. Enfin, la crise sanitaire est née d’un rapport déviant à la sphère animale : destruction des habitats naturels, immixtion de la présence humaine dans le monde sauvage, et explosion de l’élevage, avec des animaux tous identiques et immunodéficients concentrées dans des conditions sanitaires déplorables, créent les conditions imparables de l’émergence de nouvelles maladies. En ce sens, ce n’est pas un hasard que le SARS-Cov-2 soit apparu en Chine. Avec l’Asie du Sud-Est, c’est la région du monde où ce type de problèmes se manifeste de la manière la plus aiguë.
Finalement, le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité ou l’épidémie de Covid-19 sont bien nés des mêmes facteurs : un rapport complètement vicié au monde naturel. Et comme le souligne fréquemment Bruno Latour, celui réagit à nos actions : cette épidémie est finalement comme un retour du refoulé.
Comment dès lors analyser la manière dont nos sociétés y répondent ? Ce qui est frappant, c’est l’incapacité à se saisir d’un problème d’ampleur systémique, et non pas paramétrique. Nous sommes typiquement dans la configuration du Cygne Noir, dont nous avons déjà parlé, théorisé par Nassim Nicholas Taleb : un événement aux conséquences incalculables que notre cerveau et notre manière de connaître ne sont pas capables de voir venir. En France, les polémiques sur la disponibilité des masques, des respirateurs artificiels ou des personnels soignants le montrent : nos sociétés ne sont pas aptes à surinvestir en période calme pour anticiper des événements d’ampleur exceptionnelle dont nous savons pourtant qu’ils arriveront tôt ou tard. C’est le cas en matière sanitaire, mais aussi bien pour les forces armées, la prévention des inondations ou encore le risque nucléaire. Quelle que soit l’incapacité de tel ou tel gouvernement, il est très difficile, pour l’homme tel qu’il est et l’économie telle qu’elle est organisée, d’anticiper et de préparer à son juste niveau une crise d’ampleur systémique. Ceci nécessite un effort de planification et de surinvestissement qu’il est très peu aisé de maintenir dans la durée. Parallèlement, il est tout à fait possible de diminuer les facteurs de risques, en l’occurrence ici, en décomplexifiant et en ralentissant la marche du monde. Ou pour le réchauffement climatique, en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre.
Dès lors, ce qui transparaît dans cette gestion de crise, c’est la performance supérieure des économies fortement industrielles, qui peuvent produire pour elles-mêmes les équipements dont elles ont besoin au plus fort de la crise (masques, respirateurs…). Quoi qu’il en soit du niveau initial du stock d’équipements, celui-ci s’épuise très vite s’il ne peut être renouvelé par la mobilisation de l’industrie domestique. Or, les pays qui s’en sortent le mieux sont des pays très industriels comme la Corée du Sud ou l’Allemagne. Les pays du Sud, aux économies plus tertiarisées et touristiques, sont en déroute (Italie, Espagne, France…). La force est dans le local.
L’autre élément saillant de la gestion de la crise sanitaire, c’est une sorte de prime aux régimes autoritaires ou à la réduction démocratique. Si la Chine a pu faire en sorte que, selon les chiffres officiels, l’épidémie ne tue que 3000 personnes pour une population de plus d’un milliard d’individus, c’est précisément parce qu’elle a pu lui imposer une contrainte exceptionnelle et implacable. Et dans les démocraties, l’issue n’a généralement été trouvée que via un affaiblissement très fort des libertés individuelles. Il va en ressortir un très fort affaiblissement des démocraties. Et dans notre pays, celui-ci est d’autant plus vif que la défiance vis à vis de l’État tend à se généraliser. Chacun est devenu professeur de santé publique, et donne son avis et ses prescriptions. Le travail de sape des réseaux sociaux contre l’État comme incarnation de la volonté générale est dévastateur. A coup sûr, l’épidémie de Covid-19 va œuvrer à accentuer cette trajectoire divergente dont nous avons déjà parlé, entre d’un côté un État qui se raidit, et de l’autre des populations qui explosent. Et, ceci dans un contexte géopolitique où l’influence américaine va ressortir grandement amoindrie, et celle chinoise considérablement renforcée. Il n’est qu’à voir les appels au secours de l’Italie envers la Chine. Quant à l’Union Européenne, elle risque tout simplement de perdre pied.
Cette secousse est la première d’une telle brutalité dans le contexte de l’anthropocène. Elle est systémique et soudaine, et dessine notre avenir. Les cartes sont rebattues. Il est à prévoir une très forte perte de cohésion de nos sociétés et du monde, et un appauvrissement généralisé, dans un contexte économique particulièrement vulnérable. Dans ce cadre, nous voulons faire le pari, avec Kèpos, d’une simplification des échanges, en faveur du local, du sobre et du low tech. C’est la position que nous allons avancer. Mais à voir la voracité avec laquelle les français se jettent sur la sociabilité numérique pour compenser le confinement, nous pouvons douter que ce soit la proposition dominante. Mais nous y mettrons toute notre énergie.
Image : Danse macabre de la Chaise-Dieu.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
9 mars 2020RéflexionsKèpos recevait Maxence Arnould, doctorant à l’INRAE, qui travaille sur la gestion du morcellement de la forêt privée française, et Georges Pottecher, président de Forestys. Retour sur les échanges tenus à cette occasion.
Que planter aujourd’hui ?
Cette société nouvellement créée est un bureau d’études qui a pour mission d’apporter des informations pour accompagner les sylviculteurs. Tout part du constat de la vitesse de déplacement des aires climatiques en France. Celle-ci est de 10 à 15 km par an. Or, un arbre vit en moyenne 100 ans. Il en résulte qu’au moment où l’on abat un arbre, il faut le replanter 1000 km plus loin. Ceci fait qu’en un siècle, le climat méditerranéen sera généralisé sur toute la France, et les sapins des Vosges vont devoir aller voir ailleurs. Les forestiers voient donc les problèmes de ce type qui s’accentuent. Dans le même temps, les crises sanitaires s’accélèrent, à l’exemple de la propagation des scolytes. Le gestionnaire se demande donc ce qu’il doit planter. Celui-ci, en temps normal, se base sur son capital d’expérience. Mais cela est, en ce cas, inutile : le changement climatique va plus vite que la croissance des arbres. La situation d’aujourd’hui est caractérisée par le fait que la vente du bois de paye plus les coûts de gestion de la forêt.
Dans ce contexte, le métier de Forestys consiste à voir ce qui pousse et ce qui crève aujourd’hui. Pour cela, la société s’appuie sur une base de données de l’inventaire forestier national, en utilisant des méthodes de traitement développées par AgroParisTech, dont l’usage a fait l’objet d’une convention avec Forestys. Les clients pour l’instant sont les grandes forêts privées. Pour mémoire, la forêt française fait 16 millions d’hectares, dont 12 millions de forêt privée. Forestys donne des informations, mais fait très attention à ne pas prescrire.
La société fait partie du projet « Des Hommes et des Arbres ». Celui-ci, lancé à l’initiative du Grand Nancy, vise à ce que la Métropole ait un impact positif sur les territoires alentours. Ceci vise à créer un cadre pour valoriser les services écosystémiques rendus par la forêt. Cela peut par exemple concerner la construction, la santé ou les loisirs. La Caisse des Dépôts et Consignation a choisi ce projet dans le cadre de l’appel à projets « Territoire d’innovation ». Il a été très bien évalué, mais les financements sont inférieurs à ce qui était attendu, du fait d’un nombre de lauréats plus importants que prévus.
Le morcellement de la forêt privée
Maxence Arnould réalise sa thèse à l’INRAE, en partenariat avec AgroParisTech et l’ENSGSI. Son travail part du constat que les 12 millions d’hectares de forêt privées en France appartiennent à 3,5 millions de propriétaires. Le seuil entre petits propriétaires et propriétaires plus importants est fixé à 25 ha. La moitié de la forêt privée française est le fait de petits propriétaires. Il est d’ailleurs très fréquent que les propriétaires de ce type ne sachent même pas qu’ils le sont. Pour traiter ces difficultés, le travail de thèse de Maxence Arnould vise à tester la méthode du living lab, une démarche de co-création multi-acteurs, où chacun d’entre eux vaut 1. AgroParisTech est en train de monter le premier living lab forestier au monde. Parmi les acteurs concernés figurent par exemple les notaires qui gèrent la question des successions. Dans les villages, cette méthode revient à inclure les citoyens dans la gestion.
La grand morcellement de la forêt française s’explique par plusieurs facteurs. On peut citer par exemple le partage d’une partie des terres au moment de la Révolution française. Le remembrement n’a pas été possible sur ce type de propriété. En outre, la politique forestière et ses outils sont relativement pauvres. On rencontre ainsi dans les cadastres des propriétaires nés en 1800 ! Les coûts sont énormes pour gérer cette situation. Dans ce contexte, le fait que les acteurs s’intéressent à la forêt est un enjeu de Des Hommes et des Arbres.
Une des problématiques clés pour ce type de propriétaires est de les inciter à renouveler leur forêt. Cette question du renouvellement est très liée à la question du gibier, qui dégrade les jeunes pousses. Il existe par exemple des protections mécaniques des jeunes plants, mais qui restent après sur place, et sont autant de déchets. Des protections chimiques sont aussi possibles. Tout cela coûte très cher et illustre les difficultés de rentabilité de l’activité forestière.
La valorisation des services écosystémiques
La valorisation de la forêt s’appuie usuellement sur la production du bois et la chasse. Mais comment aller plus loin pour rentabiliser les services écosystémiques de la forêt ? Quel est le modèle économique possible ? Des pistes sont explorées autour de la certification, en y faisant rentrer ces services écosystémiques. Mais la certification forestière (avec par exemple les labels PEFC, FSC, etc.) n’est pas dans une bonne dynamique en ce moment, avec une hausse des surfaces qui ralentit. Des labels « bas carbones » pourraient émerger, afin de rémunérer les propriétaires pour le stockage du carbone que leur forêt opère.
En zone rurale, on assiste aujourd’hui à une forte dévastation des haies et des lisières de forêt. Ailleurs, faute d’entretien, des parcelles crèvent sur elles-mêmes. La compensation carbone pourrait donc être une piste pour améliorer la situation. Les entreprises achèteraient du stockage de carbone, en replantant, en transformant le taillis en futaie, ou en boisant une friche. Ce sont là des cas très spécifiques, et du point de vue de la lutte contre le changement climatique, la compensation carbone fait plutôt partie du problème que de la solution : elle devient souvent pour une entreprise un moyen de ne pas entrer dans une logique de sobriété. En outre, un jeune arbre ne stocke que peu de carbone. On peut aussi se demander si ce type de programme est suivi, évalué ? Quoiqu’il en soit, les jeunes arbres meurent beaucoup : dans la sylviculture traditionnelle, on compte 50 survivants pour 1000 arbres plantés.
Les usages de la forêt
La thématique agroforestière devient de plus en plus prégnante. Certains techniciens de chambre s’y intéressent fortement, ce qui n’est pas le cas du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) ou des coopératives et exploitants forestiers. De nombreuses pistes sont à explorer : par exemple la pâturage de moutons dans des vergers, ou encore des synergies entre la chasse, le tourisme et l’apiculture. En Meurthe-et-Moselle, des expérimentations sont en cours dans le réseau des Fermes vertes. Les arbres ont ceci d’intéressant en agriculture qu’ils permettent de garder l’humidité sur la parcelle, et qu’ils favorisent la qualité agronomique des sols. Ceci est très lié à la question de l’agriculture biologique. On en parle de plus en plus en école d’agronomie. Cela est d’autant plus porteur que nombre d’agriculteurs s’inquiètent de la dégradation de leurs sols, et ils payent énormément, sous la forme de produits phytosanitaires, pour pallier à cette difficulté. Ils sont sur ces sujets pris dans des injonctions contradictoires très fortes.
La biodiversité devient une question clé de la gestion forestière. Les friches ne sont d’ailleurs pas les zones avec la plus forte biodiversité. Une gestion minimum peut être préférable à l’absence complète de gestion, où le risque est fort en ce cas que des espèces hégémoniques s’installent. Tout ceci pose la question de notre rapport au sauvage et à la singularité. Quel doit être le rôle de l’intervention humaine ? Redevenir une forêt primaire est très long (plusieurs siècles) : il ne suffit pas pour cela de laisser un terrain en friche.
Le bois énergie n’est généralement pas issus de forêts gérées durablement, sauf pour la valorisation des branches et des restes. Cela revient à poser la question de savoir si le bois énergie est durable. Les approvisionnements ne sont en outre pas forcément sécurisés. Ce type d’usage implique des rotations plus rapides. Il est parfois difficile de trouver du bois d’œuvre pas trop cher si un énergéticien est passé avant. Il est également important de ne pas empiéter sur les surfaces agricoles pour cela (tout comme pour la méthanisation). Le bois énergie est en revanche très intéressant après concassage des dépôts en déchetteries ou des déchets de l’industrie. Et il n’y a pas de rentabilité pour le bois énergie sur les petites parcelles.
L’avenir de l’Office National des Forêts (ONF) est un sujet qui revient souvent dans l’actualité. On peut faire le parallèle avec ce qu’il en était de l’assistance à maîtrise d’ouvrage proposée par les Directions Départementales de l’Équipement (DDE) et les Directions Départementales de l’Agriculture (DDA) aux petites communes il y a quelques années. Il en est résulté une dégradation de la compétence d’acheteur de ces communes. Il y a eu une perte de savoir-faire, sans compensation par le secteur privé, l’activité étant difficilement rentable. Plus globalement, les politiques actuelles cherchent à articuler public et privé, mais cela reste très compliqué au niveau local. Mais on est encore très loin d’une privatisation de l’ONF. On observe cela étant une perte de confiance et un mécontentement des petites communes envers l’ONF.
L’avenir
Quelle est la situation de la forêt en Grand Est ? Celle-ci est dégradée : les épicéas sont très attaqués, certains hêtres sèchent par la cyme (deux bûcherons ont été tués récemment du fait de la chute d’arbres morts), les chênes résistent mieux. Les chenilles, qui aiment la chaleur, se développent de manière significative : elles peuvent, en plusieurs années, tuer des chênes. Elles sont en outre très urticantes, ce qui gène les activités de loisirs. Les espèces de basse température voient leur aires diminuer, et sont remplacées, beaucoup moins vite, par les espèces de haute température. Sur la longue durée, la déprise agricole a fait que les sols ont été colonisés par la forêt depuis le XIX siècle. La superficie de la forêt française en a été doublée. La situation tend à s’équilibrer aujourd’hui. Par ailleurs, le feu est un des périls actuels . Jusque dans les années 2000, le risque feu était très limité dans le Grand Est. Sous l’effet du changement climatique, ce risque sera, en 2050, équivalent à ce qu’il est en zone méditerranéenne. Pour information, le feu unitaire avec la surface le plus étendue en France a été, en 2019, situé dans le Jura.
Quel est l’avenir de la forêt ? Il faudrait qu’un travail de coopération tel celui de Kèpos puisse être mené. La situation devient en effet très compliquée, du fait d’une gestion de plus en plus difficile. Il va donc falloir un consensus très important pour aller au delà de ces difficultés. Le collaboratif est donc essentiel, pour arriver à une action concertée entre acteurs dans et hors de la filière.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
30 janvier 2020RéflexionsKèpos recevait dernièrement Matthieu Jacquot, directeur de Mobicoop, et Romain Vaudois, responsable du développement de Citiz Grand Est en Lorraine, pour une table-ronde sur la mobilité dans la perspective de la transition écologique, et sur le rôle de la voiture en particulier. Retour sur les principaux échanges tenus.
La mobilité : quelques éléments de cadrage
Paradoxalement,
la mobilité est souvent oubliée dans les enjeux de transition. Or,
elle constitue un levier très fort pour faire évoluer le système,
car elle a un impact très important en termes d’émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES). Si on affronte vraiment ces enjeux, on casse
beaucoup de choses. Et cela est vrai aussi bien pour le transport de
personnes que pour le transport de marchandises. En France, la
mobilité représente environ 150 millions de tonnes équivalent CO2
(teqCO2), sur 500 millions d’émissions totales. Elle constitue le
premier poste pour la France, le second pour l’Europe. Sur le
territoire national, 80 % des déplacements se font en voiture,
et 90 % de ces 80 % se font en voiture solo. 50 % des
déplacements en voiture font moins de 5 km.
La
voiture, depuis sa généralisation, a changé les modes de vie en
profondeur. C’est ainsi que courses et loisirs sont réalisés de
plus en plus loin du domicile. Notre manière d’habiter a aussi été
profondément impactée : la voiture a permis l’étalement
urbain. Il en a résulté un éloignement sensible des populations
des services publics. Les
déplacements domicile-travail ne représentent que 30 % des km
parcourus en voiture. La majorité des déplacements sont non liés
au travail. Il ne faut donc pas surestimer la thématique du trajet
domicile-travail. Aujourd’hui, même si les horaires de travail
sont désynchronisés (tout le monde ne sort pas du travail en même
temps), la congestion est toujours là. Un point clé, qui explique
pour partie l’usage de la voiture, est la flexibilité que cette
dernière permet dans les horaires. Dans les faits, l’usage de la
voiture continue à augmenter, et son usage en solo continue à se
développer. Le nombre de personnes par voiture est en moyenne de
1,32 : avec 100 voitures, on transporte 132 personnes !
L’équipement
en voitures est surabondant dans la société française. Certains
foyers ont jusqu’à 3 à 4 véhicules. Tout cela renvoie à la
problématique de l’aménagement et au poids du lobbying
automobile. Pour mémoire, la marketing automobile en France pèse
autant que le budget total des Trains Express Régionaux (TER). Tout
cela est vendu depuis des décennies à travers le prisme du rêve et
de la liberté. Cela se retrouve très fortement aujourd’hui dans
la manière dont sont promus les modèles de SUV.
Voiture, inégalités et écologie
On
note cependant des évolutions positives : les jeunes passent le
permis de plus en plus tard. Certains même ne passent jamais le
permis. Malgré tout, il existe une ségrégation de plus en forte
entre personnes des centres villes non motorisées et habitants des
périphéries. On observe aussi des différences de localisation
selon les classes sociales : les classes moyennes sont proches
de leur lieu de travail, alors que les classes pauvres ou très
élevées s’en éloignent davantage. La mobilité est un donc lieu
d’expression des inégalités sociales : on l’observe très
bien entre les bus, pour les classes populaires, et les trams, pour
un public plus aisé. Plus globalement, l’empreinte écologique
d’un ménage est très lié à ses revenus.
On
constate aujourd’hui deux discours opposés : celui sur la
mobilité propre, et celui sur la mobilité sobre. Les véhicules
électriques, dits « propres », deviennent intéressants
écologiquement à partir de 50000 à 80000 km parcourus, tant ces
modèles contiennent d’énergie grise (l’énergie nécessaire à
leur fabrication). Pour améliorer les choses du côté de la
conception des véhicules, les enjeux se situent dans leur poids et
dans la descente en gamme. A l’heure actuelle, tous les gains de
conception faits dans l’efficience des moteurs ont été perdus
dans une augmentation du poids des véhicules. La tendance n’est
donc pas du tout à aller vers des petites voitures !
Pour bien comprendre les impacts écologique de la mobilité motorisée, il faut comprendre qu’il nous faut passer d’une situation où une personne en France émet en moyenne 1700 kg de CO2 par an, à une situation où cette même personne émet 500 kg de CO2. Or, les services publics, qui ne dépendent pas de l’action de chacun, génèrent déjà 350 kg d’émissions par personne. Mais il existe cependant de nombreuses opportunités liées à la décarbonation de la mobilité, pour les particuliers comme pour les entreprises. On peut prendre l’exemple du cyclo plombier à Paris, qui se déplace plus aisément et rapidement, pour des coûts bien moindres. L’argument écologique n’est jamais le plus déterminant dans le changement de comportement. Pour qu’une solution soit substituée à une autre, il faut que le service apporté soit meilleur. Le changement de comportement doit donc être accessible socialement.
ll
faut bien avoir conscience, qu’à part le vélo, rien n’est
vraiment vertueux. Il est à noter que le vélo électrique a un
effet positif sur la démotorisation des gens.
Le vélo commence à être vu très positivement et à générer du
rêve. A son exemple, il est donc essentiel que les modes alternatifs
donnent envie. Mais il n’est pas du tout sûr que ceci permette de
réduire le nombre de kilomètres parcourus en voiture, tant l’effet
rebond est au cœur des comportements humains. Un gain quelque part
est dépensé à nouveau ailleurs.
Enfin, notons que l’usage du vélo est encouragé par la loi dans
les entreprises. Ainsi, la Loi Mobilités crée un forfait de 400 €
payé par l’employeur pour les salariés qui viennent au travail à
vélo. Mais l’inégalité est toujours là, car le dispositif n’est
pas obligatoire. Même si la fiscalité a en général un rôle à
jouer, il ne faut pas surestimer la place du facteur prix. L’essence,
en passant de 1 € le litre à 1,50 €, n’a pas permis une baisse
significative de l’usage de la voiture.
Autopartage et covoiturage
L’autopartage
permet une évolution de ces pratiques. Ces voitures en libre service
sont un moyen de limiter très fortement les kilomètres parcourus
par un ménage. Tout simplement parce que le ménage va voir ce que
lui coûte réellement l’usage de sa voiture. Le coût n’est plus
caché mais visible (le client paye à l’heure d’utilisation) :
c’est une très forte incitation à diminuer. L’usage d’une
voiture est en effet, pour un ménage, très onéreux : une Clio
revient à peu près à 500 € par mois !
Parmi
les bénéfices de l’autopartage, les ménages concernés vont
faire leur course à pied en bas de chez eux. La feuille de route de
Citiz est bien de faire diminuer l’usage de la voiture : une
auto partagée remplace 10 voitures en ville. La problématique peut
être différente à la campagne, où l’offre de transports en
commun est en baisse, même s’ils n’ont jamais été vraiment
généralisés. Bus et trains sont ainsi remplacés par des offres de
Transport A la Demande (TAD). Dans ce cadre, il faut bien comprendre
que le mouvement des « gilets jaunes » dépasse la simple
question de la mobilité.
La
SCIC Mobicoop, quant à elle, a trois métiers : le covoiturage,
l’autopartage de flottes d’entreprises, et le transport
solidaire. Ce dernier vise à valoriser les réseaux d’entraide
encore présents à la campagne, afin d’aider à mutualiser l’usage
de la voiture. Sur toutes ces activités, l’idée est d’être
inventif dans l’usage de l’automobile. L’autopartage en
entreprise peut concerner, dans le cas de Mobicoop, les flottes de
voitures ou de vélos. Une telle pratique en inter-entreprises est
difficile juridiquement à mettre en place. Des croisements sur ces
questions sont en projet avec Citiz.
Aujourd’hui,
le covoiturage est entré dans les usages d’une part importante de
la population pour les trajets longue distance. La différence entre
Blablacar et Mobicoop se situe dans l’investissement marketing
consenti pour avoir une masse critique d’utilisateurs. Dès lors,
Mobicoop, beaucoup plus petit que Blablacar, a fait le choix d’avoir
un modèle économique davantage basée sur la prestation de services
en marque blanche, en particulier pour des collectivités. La SCIC ne
se rémunère pas sur les données.
Qu’en
est-il de l’impact écologique du covoiturage ? Des études
tendent à prouver que la situation n’est pas meilleure après
qu’avant : les covoitureurs prenaient auparavant le train. Le
véritable enjeu écologique est d’arriver à une masse critique
d’utilisateurs sur les destinations abandonnées par le train. A
noter qu’on inclut généralement dans le coût du train à la fois
l’exploitation et l’investissement. Il faudrait faire la même
chose avec la voiture, en prenant en compte également la
construction et l’entretien de la route. Il y a donc un biais de
comparaison entre train et voiture. C’est ainsi que les 500 €
évoqués tout à l’heure ne comprennent que le coût de possession
de la voiture.
La
covoiturage dans les trajets domicile-travail ne représente que 4 à
5 % des déplacements en voiture pour cet usage, soit quasiment
rien ! Pour ne pas se décourager, il faut savoir que l’on
n’est pas dans une configuration de type « Tout ou rien » :
il est nécessaire d’y aller peu à peu. Le télétravail se
développe, mais il est très encadré. L’employeur doit ainsi
vérifier une fois par an que les conditions de travail chez le
salarié sont bonnes. On sent poindre en parallèle un développement
du coworking à l’échelle du quartier ou du village.
La masse critique pour le covoiturage longue distance a été atteinte chez Blablacar. Cette masse critique est très liée au bases de données disponibles. Les mettre en lien aurait un effet levier fabuleux. Mais c’est là une question de politiques publiques : la mutualisation des bases de données n’est pas le choix fait par le législateur. Ceci a pour effet que les petits flux sont abandonnés. C’est d’autant plus dommageable que l’on pourrait facilement avoir des impacts importants sur les trajets très fréquentés. Par exemple, 120000 véhicules circulent par jour sur l’A31 entre Metz et Thionville. Si 1000 voitures étaient ouvertes au covoiturage, cela rendrait disponible d’emblée 4000 places supplémentaires. La possibilité de faire autrement existe donc véritablement.
Crédits Photo : Trafic, de Jacques Tati.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
6 janvier 2020RéflexionsL’actualité a parfois de curieux échos historiques. Ainsi en est-il de l’assassinat du Général iranien Qassem Soleimani, qui n’est pas sans faire penser, toutes choses égales par ailleurs, à l’attentat de Sarajevo, qui déclencha la Première Guerre Mondiale. Il est inutile de chercher à élaborer des scénarios géopolitiques quand on n’en a pas l’expertise et la compétence, mais notons là qu’il pourrait s’agir de ce que Nassim Nicholas Taleb appelle, dans son ouvrage du même nom, un Cygne noir. À savoir un événement imprévisible à l’impact incalculable.
Par la structure de
notre savoir, nous sommes habitués à penser les choses en termes de
régularités, de moyennes, de structures causales simples. Or, si
l’on regarde ce qui a vraiment un impact dans l’histoire, ce sont
véritablement les événements peu probables, rares, que personne
n’a anticipés. En d’autres termes, l’histoire est jalonné
d’événements qui ont bouleversé les choses sans que nous ayons
été outillés pour les voir venir. Ainsi en est-il par exemple du
11 septembre, de la crise de 2008, ou du réchauffement climatique,
qui est un mécanisme qui s’est mis en place avec la révolution
industrielle, avant que nous en ayons l’intelligence. Et sans doute
est-ce le cas de l’attentat de Sarajevo ou de l’élimination de
ce Général iranien.
Que faut-il en tirer comme conclusion ? Qu’il faut réorienter notre attention et notre énergie. Les questions qui nous sont posées actuellement ne concernent assurément pas, par exemple, les modalités de gestion de nos régimes de retraite. Mais elles concernent à coup sûr la stabilité géopolitique du monde et la stabilité géochimique et biologique de la Terre. Quand tous nous passons une énergie hors de propos sur la question des retraites, nous nous payons de mots, nous ne voyons pas les cygnes noirs qui entrent en scène. Or ceux-ci sont potentiellement d’un impact considérable. Songeons aux conséquences qu’auraient pour un pays comme la France une déstabilisation généralisée de tout le Moyen-Orient, de l’Iran jusqu’à l’Afrique du Nord. Assurément, ce serait toutes les dimensions de vie politique, militaire, sociale et économique du pays qui s’en trouveraient bouleversées. Plus globalement, il nous faut penser une géopolitique de la transition écologique.
La situation australienne donne à voir le même décalage, la même dissonance cognitive, entre des Australiens en vacances sur des plages de sable fin, et la réalité des bouleversements écosystèmiques que le réchauffement climatique a déclenché, sous forme d’incendies, dans le Sud-Est du pays. « Veiller pour ne pas être surpris » dit l’Evangile (Matthieu 24, 37-44). Une invitation à méditer, pour ne pas se retrouver tels des retraités en slip de bain, au moment où le monde moderne bascule.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
17 décembre 2019RéflexionsLa présente contribution est proposée par Kèpos et ses membres dans le cadre de la consultation « On s’engage » lancée par l’Université de Lorraine. Celle-ci demandait à la communauté universitaire et à la société civile des idées sur la transition écologique de l’établissement. Cette article s’interroge sur ce que devraient être les missions d’une université à l’heure de l’anthropocène. Dans ce cadre, devenir une université en transition, c’est d’abord intégrer les enjeux écologiques dans les grandes missions de l’université, à savoir la recherche, l’enseignement, et l’innovation
Questionner l’activité de recherche
L’anthropocène est le grand événement de la modernité, qui met en cause à court terme l’existence de l’espèce humaine. Mais l’université l’a-t-elle intégrée dans ses stratégies de recherche ? On pourrait donc proposer qu’une première étape soit de questionner, à travers une analyse bibliométrique, quelle la place des enjeux écologiques au sens large dans les activités de recherche de l’université. La deuxième étape serait alors de mettre l’anthropocène à l’agenda de toutes les activités de recherche de l’université, et cela à l’échelle individuelle, à l’échelle du laboratoire, et à l’échelle de l’établissement. Enfin, la dernière étape se situera dans le dialogue des savoirs, à travers la question de la cohérence écologique globale : quels sont les effets de résonance de la crise écologique entre les différents champs disciplinaires ? Et comment l’action humaine pourrait concevoir et mettre en œuvre des stratégies politiques, économiques ou techniques qui soient cohérentes et pertinentes dans l’ensemble des dimensions du problème écologique ? Voilà un agenda de recherche global capable de donner une feuille de route à l’ensemble d’une communauté universitaire.
Réorienter l’enseignement à l’université
Le monde dans lequel les étudiants d’aujourd’hui vont évoluer n’aura rien à voir avec celui dans lequel ont grandi leurs enseignants. Dès lors, il est clair qu’il faut les y préparer. Or, on le sait, les politiques climatiques ne sont pas des politiques sectorielles : elles sont transversales à tous les domaines. Il en va de même pour l’enseignement : l’enseignement de la crise écologique n’est pas un enseignement de nature essentiellement disciplinaire. Dès lors, il est nécessaire :
Que tous les étudiants aient a minima un module de formation par cycle sur l’anthropocène et ses implications.Que l’ensemble des maquettes et des enseignements soient questionnés à l’aune de ce qu’ils signifient vraiment dans un monde potentiellement à + 4° C à la fin du siècle. Que des formations expertes de ces sujets soient construites (c’est déjà le cas), et surtout entrent en dialogue entre elles. Que la formation continue prenne ces sujets à bras le corps, pour construire une offre qui forme les managers et les ingénieurs de la transition écologique dont nos entreprises et nos territoires ont besoin.
Ces questions soulèvent également la question de la formation des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS à ces enjeux : il serait très dommageable que l’ignorance se loge, en la matière, chez les personnes-mêmes qui sont en charge de la combattre.
Questionner le soutien à l’innovation
L’université a un rôle essentiel dans la vie économique, via le transfert de technologie, la création de spin off universitaires, ou la recherche collaborative. Or, ces actions sont-elles toujours cohérentes avec les enjeux écologiques au sens large ? Dès lors, nous proposons que toutes les activités liées à l’innovation mentionnées ci-dessus soient, avant tout décision de soutien, passées au crible de savoir si elles sont compatibles avec l’objectif de la neutralité carbone en 2050 (objectif inscrit dans la loi). Et pour être tout à fait cohérent, si ce n’est pas le cas, elles ne doivent pas être soutenues.
Verdir les process
Enfin, il conviendra de verdir tous les process. Quelques exemples peuvent être donnés :
Réduire drastiquement l’usage de l’avion et compenser l’intégralité des déplacements faits par ce biais par les enseignants-chercheurs. Cela pourra être fait en attribuant à chaque chercheur un budget carbone annuel à ne pas dépasser, en diminution d’année en année bien sûr.Ne plus rembourser les indemnités kilométriques et ne plus donner accès à un véhicule de service pour les déplacements pour lesquels une alternative crédible de transport en commun existe.Avoir une politique volontariste d’isolation de tous les bâtiments universitaires.Servir des produits Bio et locaux dans les restaurants universitaires et les buffets achetées auprès de traiteurs.Se poser la question de l’éco-conception des systèmes informatiques utilisés.
Un dernier mot sur la vie étudiante : les étudiants ont un rôle essentiel à jouer dans ces processus. Soutenir activement leurs initiatives en la matière est une nécessité. Sans bien sûr leur faire croire que la transition écologique d’une université est d’abord le fait de leurs éco-gestes, ce que parfois leur établissement veut leur faire croire.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
11 décembre 2019RéflexionsL’agriculture est une question clé de la transition écologique. C’est dans cet esprit que le groupe d’entreprises membres de Kèpos a consacré une de ses réunions à ce thème, en invitant Gautier Vallence, ingénieur ENSAIA et agriculteur à Goviller, et Franck Magot, ingénieur ENSAIA lui aussi, et gérant des Fermiers d’ici, pour mieux comprendre les problématiques en jeu. Retour sur les principaux éléments qui sont sortis de cette discussion, en particulier sur l’élevage.
L’élevage
La
première question abordée est celle de l’élevage, et notamment
des impacts respectifs des élevages bovins, porcins, ovins et de
volailles. Le première différence qui apparaît est la différence
entre l’élevage porcin et de volailles, qui est souvent hors sol,
sans lien avec le territoire et semi-industriel, avec celui bovin ou
ovin, qui est le fait de petites exploitations familiales. A noter
qu’en Lorraine, l’ovin est particulièrement adapté. Le mouton
se sort bien des périodes de sécheresse. En revanche, la
valorisation de ses co-produits (la laine en particulier) ne doit pas
être idéalisée : tondre des moutons est une activité très
éprouvante, qui ne peut être mécanisée, derrière laquelle il est
peu envisageable de mettre en place de véritables filières.
La situation la plus équilibrée en élevage est un élevage ovin et bovin extensif sur prairies en Bio. Cela permet de valoriser des surfaces en herbe avec de la biodiversité et du stockage de carbone. Les porcins et la volaille sont en revanche physiologiquement faits pour manger des céréales, ce qui implique un usage des terres intensif pour de la culture, avec des risques de pertes de biodiversité et d’épuisement des sols. Il n’en reste pas moins que, dans le cadre de la transition écologique, il faut passer d’une consommation de viande de 80 kg par personne et par an, à une consommation de 20 kg annuel, selon l’étude Tyfa. Le Bio est pour cela essentiel : l’élevage extensif Bio émet moitié moins de Gaz à Effet de Serre (GES) que de l’intensif conventionnel. En matière d’alimentation et d’agriculture, il faut donc toujours penser en système. Par exemple, un client d’Amap consomme souvent également moins en volume.
Le
Bio peut-il permettre de nourrir tout le monde ? Une telle
question ne permet pas de voir le véritable enjeu, qui est celui du
gaspillage alimentaire. Plus globalement, il faut chercher à
actionner plusieurs leviers : élevage/culture, la combinaison
des différents type d’élevages, le Bio et le conventionnel, le
gaspillage ou non, l’intensif ou l’extensif, etc. Le porc est par
exemple très gourmand en ressources. Ainsi, de la viande de porc Bio
élevé en extérieur se vend 35 € le kilo de saucisson. L’idéal
serait donc de diminuer le porcin et la volaille, pour libérer des
espaces de culture des céréales dédiés à leur alimentation, pour
faire à la place des protéines végétales pour l’homme et des
prairies pour de l’élevage extensif Bio.
Ces
dernières années, on a pu constater un découragement des éleveurs.
Nombreux sont ceux qui ont transformé leurs terres en culture.
Parallèlement à cela, la consommation de viande a cru pendant 60
ans, pour arriver à un pic il y a 10 ans. Mais qu’il s’agisse
d’élevage ou d’agriculture, les meilleurs systèmes sont ceux
diversifiés, même à l’échelle de la ferme, avec plusieurs
ateliers. Au niveau global, pour qu’un système agricole
fonctionne, il faut à la fois culture et élevage. Les régions les
plus exposées aux pesticides sont celles avec uniquement des
cultures pérennes (la vigne) ou non pérennes (les céréales).
Notons enfin que les rendements agricoles sont en train de stagner ou
de diminuer. Dans le même temps, les populations de pollinisateurs,
essentiels à l’activité agricole, sont en train de décroître
fortement.
Les exploitations agricoles en France
La taille des exploitations agricoles varie fortement selon les régions. En Lorraine, elle est en moyenne de 130 ha, contre une soixantaine au niveau national en 2016. Il y a un mouvement de concentration des exploitations, dans un contexte où la Surface Agricole Utile (SAU) est en diminution. On dénombre 437000 fermes en 2016, soit une baisse de 11 % depuis 2010. Le coût moyen de l’installation en Lorraine est de 350000 € la part. Les aides de la PAC, dans le type de fermes lorraines présenté, représentent à peu près 10 % du chiffres d’affaires, et jusqu’à 100 % du salaire de l’agriculteur. Il y a donc une vrai dépendance. Et ce d’autant plus qu’à l’heure actuelle, un agriculteur sur trois n’a pas de revenus.
Qu’est-ce
qui va faire qu’un agriculteur va se sortir un revenu ? C’est
d’abord la qualité des clients qui est essentielle, puis viennent
la qualité de la gestion, et l’environnement familial et
patrimonial. Parmi les sources de revenus, la vente directe ne
représente que 15 % au niveau national. Celle-ci rajoute en
outre beaucoup de travail de transformation et de commercialisation,
qui n’est pas forcément complètement rémunéré. La meilleure
situation conjugue une majorité des produits commercialisés en
circuits longs, et une minorité en circuits courts mutualisés.
Sur
toutes ces questions, la responsabilité des consommateurs est très
importante. Il est donc nécessaire de se réinterroger sur le prix
que chacun est prêt à payer pour sa nourriture. Dans ce contexte,
certains agriculteurs peuvent connaître une fuite en avant dans
l’endettement, bien aidés en cela par un système organisé avec
des acteurs qui y ont intérêt. On parle donc bien d’une
responsabilité partagée.
Un
circuit court est un circuit de distribution avec un seul
intermédiaire. Il peut donc y avoir des circuits courts longue
distance. Dès lors, qu’entend-t-on par « local » ?
Ce terme doit faire porter l’attention sur l‘agriculteur du
territoire. Sur ce sujet, il faut savoir que la région nancéienne
est l’un de France avec la plus faible autonomie alimentaire. Cela
est paradoxal alors que la pratique de la polyculture élevage
devrait permettre d’éviter ce phénomène : il y a tout ce
qu’il faut en local.
Quel
est l’intérêt de l’agriculture urbaine ? Les volumes
produits sont très faibles, et la concurrence pour les sols est très
intenses. Mais il s’agit à coup sûr d’un moyen pertinent pour
sensibiliser les urbains au vivant. Cela est d’autant plus
intéressant que les agriculteurs sont généralement très
maladroits dans leur communication. Ceux-ci vivent clairement un
mal-être, qui est très multi-factoriel. En même temps, ce malaise
est présent partout dans la société.
Le foncier
A
l’heure actuelle, l’équivalent d’un département de SAU
disparaît tous les 7 ans du fait de l’artificialisation des
terres. C’est là que se joue la relation entre l’urbanisation et
l’agriculture. L’impact pour l’agriculteur est différent selon
le type de projets : vente ou expropriation. Les endroits les
plus touchés sont les terres fertiles autour des villes. 50 %
de ces espaces partent pour de l’habitat individuel.
L’accès au foncier agricole est, en France, régulé par la SAFER. Il n’en reste pas moins que l’installation, pour un jeune agriculteur, peut tantôt être facile, tantôt être très difficile. Un autre aspect à prendre en compte est le fait que cet accès au foncier se fasse dans ou hors du cadre familial. La SAFER peut en outre être contournée par certaines sociétés étrangères.
En Lorraine, le prix de l’hectare se négocie entre 3000 et 8000 € en polyculture élevage. Pour mémoire, en Champagne, on est à 1 millions € l’hectare. Généralement, l’agriculteur veut garder son foncier, mais ça devient compliqué quand on lui propose 30 fois plus pour faire du terrain à bâtir. Dans ce contexte, il est essentiel de réguler l’héritage pour que le foncier reste transmissible à terme. En effet, les transmissions sont difficile à gérer dans les cas de fratries, où il ne faut pas léser ceux qui ne reprennent pas la terre. En outre, il faudrait toujours que l’agriculteur puisse rentabiliser son foncier par son travail, ce qui n’est pas toujours possible vu le montant du capital investi.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
28 novembre 2019RéflexionsLa situation actuelle a ceci de paradoxal que ce sont les actes les plus simples et les plus courants de la vie quotidienne qui renforcent chaque jour davantage la crise écologique et sociale contemporaine. Ceci donne corps à l’idée émise par Hannah Arendt de « banalité du mal » dans son ouvrage Eichmann à Jérusalem : Rapport sur la banalité du mal . Celle-ci repose sur l’idée que le mal dans le monde n’advient pas par l’extraordinaire, mais est le fait d’actes quotidiens routiniers commis sans y penser par des êtres basiques ayant abandonné toute conscience morale des conséquences de leurs actions. Quelques exemples peuvent être donnés de cela en ce qui concerne la crise écologique et sociale.
Le
premier est illustré par le dernier film de Ken Loach « Sorry,
we missed you ». Celui-ci fait la chronique de la vie d’une
famille anglaise vivant dans des conditions très simples, dont le
père vient d’embrasser la profession de chauffeur-livreur pour les
entreprises de e-commerce. Celui-ci, comme les cyclistes de Deliveroo
ou les conducteurs d’Uber, n’est pas salarié. Il est
entrepreneur individuel, et possède sa camionnette qu’il a acquise
à prix d’or. Avec une logique implacable, le film montre comment
ce système fait reposer tous les risques sur ce type de
travailleurs, alors que les donneurs d’ordre sont royalement
protégés. Ainsi, quand le chauffeur se fait agressé et que son
terminal de suivi de commandes est détruit, il se retrouve dans une
spirale d’endettement et d’asservissement dont il ne peut plus
sortir. Le système lui dit, en quelque sorte : « Pile, je
gagne, face, tu perds! »
Le
moment le plus saisissant du film est une conversation entre le
chauffeur et son donneur d’ordres, où celui-ci explique que,
quelle que soit la réalité que vivent les livreurs, les clients
n’en ont rien à faire : ce qui compte pour eux est de
recevoir leurs téléphones ou leurs vêtements dans les meilleurs
délais possibles, au coût le plus faible possible. Ainsi sont
désignés les premiers responsables du délitement humain dont est
porteur cette nouvelle économie : nous, les clients, et ici,
ceux du e-commerce.
Le deuxième exemple de cette banalité du mal est celui du streaming. Selon un rapport récent du Shift project, celle-ci représente 60 % des flux de données mondiaux, impliquant l’émission annuelle de plus de 300 millions de tonnes de CO2. Ces chiffres sont en outre en croissance très rapide. Le visionnage de vidéos en ligne implique le stockage et le transport d’une quantité vertigineuse de données. Ainsi, 10h de film en haute définition implique plus de données que tous les articles de Wikipedia en format texte. Cela engendre une consommation d’énergie colossale. Et cela est d’autant plus désolant quand on pense au poids de la pornographie dans ce streaming vidéo (27%). Cela revient en quelque sorte à faire tourner des centrales nucléaires ou à charbon pour de la masturbation. Au-delà de ça, regarder la moindre vidéo est complètement irresponsable par rapport aux enjeux écologiques que nous avons à affronter.
Il
en va de même pour les réseaux sociaux, et singulièrement de
Facebook. Celui-ci sape les fondements de notre société, par
l’ampleur de son implantation dans la vie de chacun, et son mépris
du droit. Preuve en est ce
jugement du 9 avril 2019 du Tribunal de Grande Instance de Paris,
saisi par l’UFC Que choisir. Celui-ci indique que 493 clauses des
Conditions Générales d’Utilisation de la plate-forme sont
abusives et illicites. Parmi les dimensions relevées par le juge,
notons que« Le réseau social ne respecte pas les droits
fondamentaux de la loi Informatique et libertés notamment sur le
consentement, l’information de la personne concernée, la
conservation des données supprimées, la finalité de la collecte de
données, la communication des données personnelles à des tiers ou
la collecte de données par des tiers à l’insu des personnes,
l’interdiction du traitement des données sensibles, l’effacement
des données, la sécurité, etc. ». Ce qui advient avec
Facebook, comme avec Google et Amazon, c’est la préparation d’une
société totalitaire à la George Orwell par la maîtrise des
informations personnelles des citoyens. C’est précisément ce que
décrit 1984 :
les personnes sont dans le livre en permanence sous le regard d’un
« télécran » qui relève et rapporte au pouvoir leurs
moindres et faits et gestes. Le pire est que cela est en train
d’advenir au profit d’entités privées et sans aucune
contrainte, à force de likes et de partages de photos de chats et de
vidéos virales. Ceci explique pourquoi Kèpos a fait le choix de
sortir de ces plate-formes.
On le voit, les comportements les plus répandus sont aussi ceux qui nous promettent l’avenir le plus noir. S’en affranchir est une ascèse nécessaire, qui est la seule voie de la liberté et de la responsabilité.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
16 octobre 2019RéflexionsNous assistons aujourd’hui à un désenchantement du travail : cherchant du sens à leur activité professionnelle, nombreux sont les salariés à y trouver surtout contraintes, souffrance et perte de la finalité de ce qu’ils font. Ce constat se rencontre un peu partout, et génère mal de vivre, stress, démotivation… Ainsi peut s’expliquer la tentation fréquente de la reconversion, passé un certain âge. Nombreux sont en effet les salariés à constater un divorce, une contradiction, entre leurs aspirations profondes et ce que le monde du travail a à leur offrir. Leurs aspirations, c’est la reconnaissance de leur contribution, l’interaction respectueuse avec leurs collègues, clients ou fournisseurs, et la participation au bien commun de la société ou de la planète. La réalité, c’est un travail dont le fruit est confisqué par quelques uns, dont la finalité est la production pour la production et dont la forme est l’exploitation illimitée des autres et de la nature
Notre thèse est que la transition écologique est un levier puissant pour répondre à ces maux du travail. Car initier la transition de son organisation, c’est bien vouloir remettre du sens là où il a déserté l’activité productive. Pour cela, il est souhaitable de repréciser la raison d’être de nos organisations. Pour quoi sont elles là ? A quoi œuvrent-elles ? Or, la transition écologique est précisément une démarche qui vise à humaniser nos fins et à ajuster nos moyens à ce qui est réellement souhaitable pour l’homme et la nature. Se questionner sur la raison d’être de son organisation dans la perspective de la transition écologique, c’est la faire entrer dans un cadre de proximité, de lien et d’attention à l’autre et au monde qui redonne une perspective. Il devient alors possible pour les salariés de refaire équipe autour d’objectifs partagés qui ont du sens. C’est l’enjeu par exemple d’une démarche comme celle de la CFDT avec son Pacte pour le pouvoir de vivre.
Comment cela peut-il se traduire concrètement ? Dans la perspective de la transition écologique, une équipe de professionnels (cadres et opérationnel de terrain) va être amené à repréciser ses fins, ses moyens et son fonctionnement interne. Cela va la faire entrer dans un processus de transformation itérative de longue durée où il va falloir peu à peu verdir toutes les activités en impliquant chacun. C’est alors que le salarié va prendre conscience qu’il n’y a pas d’un côté sa vie personnelle avec ses loisirs, et de l’autre sa vie professionnelle avec ses contraintes, mais bien une unique vie qui peut être vécue sur le mode de l’engagement, et donc de la liberté.
Entrer en transition, pour une entreprise et ses salariés, c’est donc faire confiance à l’expertise et l’intelligence de chacun pour imaginer des solutions, les opérer en équipe, et voir les résultats de son action concrètement. Quelque part, c’est un puissant moyen de réappropriation de la finalité de l’action collective, dans lequel œuvrer au bien commun rend justice à l’effort de chacun. C’est aussi permettre au salarié, face au bruit médiatique de la catastrophe qui gronde, de se sentir conforté car il n’en est pas spectateur, mais est acteur de sa résolution. C’est alors qu’est expliqué un apparent paradoxe : intégrer à leur juste niveau les enjeux environnementaux et de sobriété dans son organisation, ce n’est pas la rendre moins profitable ou efficace, mais c’est sans doute produire moins et différemment pour travailler mieux.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
6 octobre 2019RéflexionsLes événements récents donnent à voir un trait structurant de notre époque : une défiance généralisée quant aux grandes institutions. Au premier rang de celles-ci figure bien sût l’État. C’est ce que montre bien l’exemple de l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen, survenu le 26 septembre 2019. De partout, traversant de part en part les comptes-rendus et analyses faits par les médias, sourd une perte de confiance généralisée dans l’action publique. Les habitants sont persuadés que les pouvoirs publics leur cachent des choses et des rumeurs complotistes pullulent sur les réseaux sociaux. Par un étrange paradoxe, l’État annonce vouloir être complètement transparent, mais ses discours de temporisation en attendant des résultats d’analyses, ou d’ignorance quant aux impacts de la combustion de cocktails de produits chimiques, suscitent encore plus d’inquiétude. En effet, quiconque peut penser : « si la vérité n’est pas défavorable, c’est que ce n’est pas la vérité ». Et un discours de transparence qui dit qu’il ne sait pas n’est assurément plus une discours de transparence. Vrai et faux n’existent plus ; tout est paradoxe.
Mais surtout, ce que cela montre, c’est que personne ne pense que l’action publique puisse procéder d’une volonté bonne. En effet, si, à travers l’État, les hommes se dotent de lois et de règlements, et si l’État a pouvoir de police pour les faire appliquer, c’est bien que l’intention est celle d’une régulation, de la recherche d’un intérêt général. Mais on constate plutôt à l’heure actuelle une déliquescence généralisée de la confiance en l’État. Tout le monde ne voit plus dans l’action publique que cynisme ou manipulation. Une institution, quelle qu’elle soit (Etat, Eglises, entreprises, syndicats…), ne se voit plus accorder aucun crédit. Cette perte de confiance en ces institution qui nous réunissent est un état social pathologique, de nature paranoïaque.
Il ne peut en résulter que deux évolutions, qui peuvent d’ailleurs, un temps, coexister, jusqu’à ce que l’une des deux l’emporte sur l’autre. La première évolution possible est l’anarchie, ou autrement dit la guerre civile. Car si le peuple ne croit plus qu’il y a des institutions possibles qui nous réunissent, alors tout se fragmente, et c’est la guerre de tous contre tous. Jérôme Fourquet, dans son ouvrage L’archipel français, montre les prémisses d’une telle évolution. L’autre direction possible est celle d’un renforcement drastique du pouvoir de l’État, pour mettre les forces centrifuges sous l’éteignoir. C’est la tentation autoritaire qui s’empare de pays entiers, depuis la Hongrie jusqu’à l’Italie, en passant par le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Vénézuéla ou la Turquie. Dans ce cas, l’État, tel le Léviathan de Hobbes, ne peut que se renforcer considérablement pour éviter la guerre civile.
Ce qu’il en ressort du point de vue de la transition écologique, c’est que celle-ci doit s’opérer dans un contexte qui la rend de moins en moins possible. En effet, pour que la transition puisse être mise en œuvre, nous avons besoin de collectif, de délibération démocratique, d’action résolue. Le contexte socio-politique dans lequel nous évoluons est de moins en moins celui-ci. Comme l’explique Bruno Latour dans Face à Gaia, notre époque est d’une certaine façon proche de l’époque de la Renaissance : tout y possible, pour le meilleur (un nouvel humanisme) ou pour le pire (la guerre de tous contre tous, religieuse ou autre).
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
27 septembre 2019RéflexionsNous avons tous nos petites contradictions. Et l’écologie n’est pas en reste. Ainsi en sera-t-il de l’élu local qui portera des projets très vertueux de recyclage ou de centrales photovoltaïques, mais qui fera tout pour que de nouveaux équipements de loisirs ou de nouvelles industries s’installent sur son territoire. Ou encore de telle ONG environnementale qui abusera des vidéos en ligne et des réseaux sociaux pour porter sa parole. Ou enfin du couple de bobos parisiens qui ne mangera que du bio, mais s’offrira régulièrement un week-end en avion dans une capitale européenne. Tout cela n’invite guère à l’optimisme : une action résolue et sincère est-elle possible ? Est-il envisageable de réellement s’engager sans défaire soi-même ici ce que l’on a construit là ?
On peut voir dans ces contradictions une inconséquence généralisée, par laquelle on justifie ses faiblesses par celles des autres, ou par les efforts que l’on fait par ailleurs. Mais cette attitude, pour humaine qu’elle soit, n’en est pas moins désastreuse, car ce que la transition met en jeu, c’est un changement à accomplir qui est général et complet, en d’autres mots, systémique. Certains diront que les petits pas sont inutiles en la matière. D’autres affirmeront que ceux-ci sont nécessaires pour mettre en route les choses. Dès lors, en plus du côté contradictoire mentionné plus haut, on se retrouve confronté à une deuxième difficulté : quel rythme, quelle stratégie adopter ?
Au final, l’action humaine se trouve vite en défaut : elle est contradictoire, et elle ne sait pas où elle va. Enfin, dernier aspect : elle n’est pas coordonnée : il n’existe aucune cohésion, à l’échelle d’un pays, d’un territoire ou d’un groupe social, entre les différentes actions de ses membres. Chacun fait ce qu’il veut, avec ce qu’il peut, sans que la mise en synergie se fasse. Et fatalement, l’impact des actions de l’un est annulé par l’impact des actions de l’autre.
Créer des communs
Pour sortir de cette triple impasse, on pourrait penser que la réponse se trouve dans la coercition. Ainsi de certains écologistes qui imaginent une restriction des libertés pour gagner en efficacité. Mais les régimes autoritaires, même les mieux intentionnés, ont toujours dévoyé leurs objectifs dans le sang et les larmes. L’autre réponse possible pourrait être de croire aux seules vertus de l’incitation : c’est le sens des choix faits dans nos régimes libéraux, mais sans doute au détriment de l’efficacité.
Entre les deux, entre étatisation et privatisation, il nous faut sortir de ces contradictions en invenant une tierce voie, qui est celle des communs. Ceux-ci désignent l’espace entre public et privé que nous pouvons réinvestir dans une logique de partage et de sauvegarde de nos ressources. C’est ici que la coopération est justifiée et doit être expérimentée, avec trois principes d’action pour faire face aux trois écueils mentionnés plus haut : mettre en cohérence, avoir des objectifs clairs, et coordonner l’action dans le groupe. C’est ce que tout organisation économique, politique ou sociale, devrait s’efforcer de faire pour rentrer réellement en transition. Mais à coup sûr, rien n’est gagné en la matière…
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
26 mai 2019RéflexionsDu 20 au 22 mai dernier se tenait à l’UNESCO, à Paris, un colloque organisé par le Centre de recherche et d’action sociales (CERAS) sur le thème « Quel travail pour une transition écologique solidaire ? ». L’occasion d’une réflexion de fond sur les conditions de possibilité d’un travail qui respecterait à la fois la dignité des hommes et la dignité de la planète. Car comme le rappelait Eloi Laurent, économiste à Sciences Po au deuxième jour de cette rencontre, ce qui est en cause dans la crise écologique, c’est bien la manière dont le travail humain a altéré irrémédiablement son environnement. Dès lors, il n’y aura pas de transition écologique sans une remise en cause profonde de nos manières de travailler.
Les maux du travail sont connus, que ce soit dans nos sociétés occidentales ou dans les pays en développement : perte de sens, aliénation, fragmentation des tâches… Dès lors, l’idée force du colloque est qu’un travail digne sera un travail qui œuvrera à la transition, car fondamentalement, comme l’explique laudado Si, l’exploitation de l’homme et l’exploitation de la nature sont un seule et même chose. On pourra objecter qu’il serait sans doute possible de trouver son épanouissement au travail dans des missions délétères pour la planète : ne trouvera-t-on aucun personnel de Total, de Monsanto ou d’Areva qui vive son travail sur le mode de la mission, en toute bonne foi, avec l’impression de l’utilité commune ?
Mais cette idée de la convergence entre travail digne et respect de la planète ne doit pas être compris seulement comme une description possible de la réalité, mais comme une boussole pour la transition. En effet, la tâche à accomplir est tellement vaste, urgente et bouleversante, qu’elle ne saurait être conduite si elle n’est pas accomplie par chacun, dans son travail, sur le mode de la réalisation de soi. Ceci renvoie donc à leur responsabilité les régulateurs du travail (Office International du Travail (OIT), Etats, organismes pariraites…), et les entreprises et leurs dirigeants. D’où la publication à l’issue de ce colloque d’un manifeste rédigé au terme d’un travail de recherche de deux ans, nommé « Manifeste pour un travail décent et durable ».
Mais l’idée la plus originale de la rencontre a été amenée par Gaël Giraud, chef économiste de l’Agence Française de Développement (AFD), qui interroge l’intensité en travail des activités économiques actuelles. Reprenant les travaux d’un de ses collègues anglo-saxons, il questionne l’intensité en travail d’une économie fondée sur le charbon, puis d’une économie fondée sur le pétrole. L’exploitation du charbon demande une main d’œuvre très abondante. A l’inverse, l’exploitation du pétrole est essentiellement capitalistique. Aujourd’hui, les énergies renouvelables sont encore plus capitalistiques que le pétrole : une éolienne en fonctionnement ne demande quasiment pas d’intervention humaine. A l’inverse, les sociétés pré-industrielles peuvent apparaître comme essentiellement travaillistiques.
Dès lors, la transition nous amène-t-elle vers un monde travaillistique ou capitalistique ? A travers l’exemple des énergies renouvelables, on pourrait penser que nous allons vers un renforcement du rôle du capital. Mais peut-être n’est-ce là qu’un leurre, et qu’au contraire, il faudrait aller vers des solutions technologiques et des modes de produire hyper-intensifs en travail. Car qu’est-ce que le capital ? Une forme de précipité d’énergie, de technologie et de travail. C’est justement ce qui permet d’effectuer des gains de productivité gigantesque dans la destruction de la nature : un homme dans une forêt coupera moins d’arbre avec une hache qu’avec une tronçonneuse. Dès lors, la feuille de route de la transition pourrait impliquer de rechercher toujours les modes de faire les moins intensifs en capital. C’est précisément l’idée des low tech, telle que présentée par Philippe Bihouix. C’est sans doute également un moyen de remédier à la question des inégalités, en reprenant une idée de Thomas Piketty dans le Capital au XXIème siècle : le rendement du capital étant supérieur à la croissance, l’accumulation de richesses se fait toujours au profit des détenteurs de capital. Peut-être est-ce aussi là un moyen de redonner sens au travail, en le sortant de l’ornière des bullshit jobs décrits par David Graeber, pour le réancrer dans la transformation concrète des choses et des êtres. Et cette approche donne la meilleure clé de lecture de la question d’un revenu universel : celui-ci serait tout simplement une aberration écologique, consacrant l’idée du capital productif au détriment du travail productif de proximité, qui est précisément ce que nous devons viser.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
14 mai 2019RéflexionsKèpos a consacré une de ses dernières réunions à la problématique de la santé environnementale, avec l’intervention de Fariborz Livardjani, toxicologue au Centre Albert Jaeger et membre de notre projet. L’occasion de prendre conscience des interactions entre santé et environnement, pour mieux penser la responsabilité de nos entreprises.
Le métier de médecin peut prendre trois formes : celle de thérapeute, qui soigne : celle de préventeur (par exemple les médecins du travail), celle de toxicologue, qui évalue. Traditionnellement, les toxicologues interviennent lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de médicaments. Aujourd’hui, leur rôle s’est diversifié : ils travaillent entre autres sur les pathologies liées à l’environnement. Cela a pu donner lieu au concept de « médecine environnementale », qui reste très controversé. Il est préférable de parler de « santé environnementale ». Cela pose bien sûr la question de comment on définit l’environnement, et comment on définit la santé.
Une première approche serait de parler des risques qui se manifestent, dans le cadre de vie, sur les organismes vivant. L’environnement est alors appréhendé à travers trois dimensions : l’eau, l’air, et le sol. Il y a une très forte interdépendance de l’homme avec ces trois milieux. Dès lors, quel que soit le type de produit introduit par l’homme, il y a un impact sur nos milieux. Or, on constate à l’heure actuelle une explosion des volumes concernés. On est ainsi passé d’un million de tonnes de produits chimiques par an en 1930 dans le monde, à 500 millions aujourd’hui. 143000 substances chimiques sont sur le marché, dont seulement 3000 réellement évaluées. On peut distinguer les substances pures et les mélanges : les premières sont au nombre de 10000, les secondes offrent des possibilités quasi infinies.
La santé de son côté se définit, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Bien plus tôt dans l’histoire, Avicenne affirmait que l’homme doit toujours être pris dans son environnement. Dans le même ordre idée, l’OMS définit la santé environnementale comme l’ensemble des interactions entre la santé et l’environnement. L’hygiène des milieux devient alors la gestion de l’environnement pour la santé. Depuis la conférence de Rio en 1992, la santé est devenue un élément essentiel du développement durable.
Prenons maintenant quelques chiffres pour illustrer la problématique. Entre 1994 et 2010, le nombre de cas de pathologies cardiovasculaires, de diabète ou de cancers a augmenté de 118% en France, alors que dans le même temps, la population n’augmentait que de 19%. 5 millions de tonnes de produits CMR (Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques) sont utilisés chaque année en France. 2,3 millions de travailleurs sont exposés aux CMR. Les maladies professionnelles liées aux produits CMR représentent un coût de 650 millions d’euros pour la Sécurité Sociale. On observe une très forte hausse des maladies professionnelles, de l’ordre de 9% par an. Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont également en augmentation rapide et continue. On recense 1000 nouveaux cas de cancers diagnostiqués par jour en France. On estime que 47% des hommes développeront un jour un cancer, et 37% des femmes. Selon le National Cancer Intistute aux Etats-Unis, 35% des cancers pourraient être d’origine professionnelle. On observe 149500 décès par cancer chaque année en France. En outre, on assiste à une explosion des maladies invisibles (hypersensibilité, fybromialgie…). Au final, 88% des décès en Europe sont liés aux maladies chroniques. Selon le Professeur Belpomme, trois quarts des cancers seraient ainsi évitables, car dus à la dégradation de notre environnement.
Les pesticides sont une question clé. Par exemple, 11% des vins contiennent des phtalates. Les pesticides peuvent avoir plusieurs effets. Beaucoup d’études sont en cours sur le sujet, mais les liens de cause à effet sont difficiles à démontrer. Les pesticides peuvent aussi être des perturbateurs endocriniens, avec des effets sur le système hormonal. Ils semblent avoir un effet sur la différenciation sexuelle, et seraient impliqués dans une baisse générale de la fertilité (en 70 ans, la concentration de spermatozoïdes à diminué de 50%). Des effets neurologiques sont aussi à envisager. Les tribunaux commencent à condamner les producteurs de pesticides, en France aussi bien qu’aux Etats-Unis. On observe également des dysfonctionnements du système immunitaire, ainsi qu’un fort développement des allergies. Ce sont tous des produits marqués par une très forte dispersion : on parle de mobilité éco-toxicologique. Selon l’Institut Français de l’Environnement (IFEN), 87% des cours d’eau sont pollués. Les pommes contiennent en moyenne 27 traitements par des pesticides en résidus. La pollution par les pesticides est présente dans tous les aliments végétaux et animaux. L’espèce humaine est dès lors elle-même contaminée, l’homme devenant en quelque sorte une « éponge à polluants ». En outre, tous ces polluants se combinent et donnent lieu à des « effets cocktail », sur lesquels peu de données sont disponibles pour l’évaluation, du fait précisément de leur dispersion. On parle, dans le cas des toxicités aigües, de DES (Dose Sans Effet) et de DJA (Dose Journalière Admissible). Mais cela ne tient pas compte du potentiel toxique des associations de produits, de même que de la répétition des doses, mêmes faibles.
Enfin, on peut faire un focus sur la question de l’habitat, où de nombreuses pathologies peuvent être liées aux Composés Organiques Volatils (COV), à l’amiante, au NO2, au monoxyde de carbone, à la poussière de bois… On observe par exemple une multiplication par deux des cas d’asthme en 20 ans. Dans le même ordre idée, on estime à une fourchette entre 300 et 3000 le nombre de substances comprises dans la fumée du tabac. Tout cela est d’autant plus complexe que parfois, ce n’est pas le produit qui est toxique, mais sa métabolite (le produit de sa métabolisation par l’organisme).
Au final, nous sommes donc arrivés à un seuil dans la contamination globale de notre environnement. Si bien qu’aujourd’hui, l’espérance de vie en bonne santé est en train de chuter. La mort se vit également dans beaucoup plus de souffrances qu’auparavant. Il est donc essentiel d’avoir une vision holistique de son environnement. La conscience des entreprises sur ces sujets est extrêmement faible, et ce même si des outils existent et sont imposés par la loi. Citons ainsi le Document Unique de Prévention des Risques, qui est un outil clé qu’il est indispensable de mobiliser à son juste niveau.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
26 avril 2019RéflexionsPour un territoire, la transition écologique ne peut pas juste donner lieu à des ajustements paramètriques des politiques publiques. Au contraire, une redéfinition systémique de ces mêmes politiques est indispensable. Cela implique un renouvellement radical des termes du débat. Les questions à poser pourraient être les suivantes :
Quelle politique de mobilité doit être mise en place à l’heure de la descente énergétique ?
Quelle politique d’aménagement sont souhaitables dans un contexte d’effondrement de la biodiversité ?
Quelle politique foncière définir alors que les sols sont en train de s’épuiser à vitesse accélérée ?
Quelle politique d’habitat promouvoir alors que les scenarii de transition énergétique impliquent une diminution de 50% de la demande d’énergie ?
Quel développement économique mettre en œuvre, alors que la limitation du réchauffement climatique vient radicalement interroger les logiques de développement qui ont prévalu ces 200 dernières années ?
Comment refaire de la politique ensemble à l’échelle d’un territoire alors que les choix qui doivent être faits sont les plus engageants que l’humanité ait jamais été mise en demeure de faire ?
On le voit, les enjeux sont majeurs et les risques de perte de cohésion sociale ou économique sont très importants pour un territoire. Il est donc essentiel de sortir de la gestion “as usual” et d’enrichir le questionnement politique. Or, la transition écologique concerne l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre sur un territoire. En ce sens, elle ne relève pas d’un enfermement sectoriel, mais est éminemment transversale. Elle met en premier la notion de cohérence : ne pas effacer les gains réalisés quelque part à travers d’autres décisions connexes.
Dès lors, quelle pourraient être les méthodologies à mettre en œuvre pour faire de la transition écologique le projet majeur et structurant d’un territoire ? En première approche, on pourrait imaginer le process suivant :
La mise en perspective des tendances à l’œuvre, internes ou externes, sur le territoire : ce travail prospectif doit aller au-delà du simple diagnostic de territoire. Il en modifie les enjeux en resituant la trajectoire territoriale dans un contexte systémique bien plus vaste (énergétique, écologique, économique, social, géopolitique…).
La définition du projet de territoire : la transition écologique est d’abord un projet de territoire qui nécessite un partage des enjeux systémiques qui se posent à toute communauté humaine, une mise en récit d’un futur désirable dans un contexte en plein bouleversement, et la définition d’objectifs partagés à la fois très ambitieux, réalistes et rassembleurs. C’est là où s’incarne la volonté politique qui impulse une démarche de transition.
La mise en route démocratique de la transition écologique. Celle-ci implique, pour un territoire et ses acteurs, de savoir refaire société pour décider ensemble d’une transformation complète et globale. En ce sens, la simple consultation des citoyens est insuffisante : il importe de mettre en œuvre une véritable démocratie de construction et de contribution. Il s’agit certes là d’un processus au long cours, mais indispensable pour que la transition soit véritablement inclusive.
L’élaboration des politiques sectorielles (urbanisme, développement économique, habitat, mobilité, cohésion sociale…). Les principes de la transition doivent irriguer l’ensemble de ces décisions. Ces politiques doivent pouvoir faire système, en gagnant en cohérence, et relever d’une véritable ambition transformatrice, et pas seulement de simple choix gestionnaires.
Sur tous ces aspects, la démarche consisterait à faire dialoguer les spécificités territoriales avec les grands enjeux systémiques. L’objectif est que chaque territoire puisse s’adapter à des conditions de vie en changement rapide et proposer à ses habitants et forces vives un cadre humain et soutenable à la construction duquel ils puissent contribuer. Car quelque part, il s’agit de tout changer totalement !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
11 avril 2019RéflexionsLe collectif Kèpos a consacré sa dernière réunion à la question du financement des initiatives de la transition. Samuel Colin, membre du Plan B, d’une CIGALES de la région Grand Est, et salarié du Florain, nous a présenté différents outils. Les réflexions ici présentées sont nées d’une prise de conscience, au Plan B et ailleurs, de la difficulté que certains projets atypiques et très engagés peuvent avoir à se financer, en particulier devant la frilosité des banques. Les outils suivants sont donc pertinents dans la sphère de la transition écologique. Ils peuvent être mobilisés en complément des dispositifs usuels de la chaîne d’accompagnement classique.
Une banque pas comme les autres : la Nef
Commençons par une banque qui ne réfléchit pas comme les autres, la Nef. Ce n’est d’ailleurs pas (encore) une banque, mais une société financière. Il s’agit d’un établissement véritablement coopératif, qui ne finance que des projets avec une charte de valeurs proche de celle de Kèpos. Dès lors, elle rend publique la liste de la totalité de ses prêts, ce qu’elle est la seule à faire. Elle n’a pas d’agence, et fonctionne avec des banquiers itinérants. Ceux-ci sont donc à même de se rendre compte de la réalité des projets qu’ils soutiennent. Cela leur permet une finesse d’analyse qui donne des arguments pour financer des projets sur lesquels d’autres banques ne vont pas. La Nef a également la particularité de ne pas se financer sur les marchés financiers. Les fonds prêtés proviennent donc directement des épargnants. La banque a ainsi passé sans dommage la grande crise de 2008. La Nef commence à proposer ses services aux particuliers, sous forme de livrets d’épargne. Elle est en attente d’avoir l’agrément bancaire complet avant de se lancer complètement sur ce marché. Elle doit pour ce faire satisfaire à la réglementation prudentielle issue de la crise de 2008, très complexe et contraignante, et peut-être pas tout à fait adaptée à ce type d’établissement. Pour des épargnants ou des porteur de projets, le recours à la Nef peut s’expliquer par le souhait de vouloir sortir de l’argent des marchés financiers. Or, l’épargne d’un ménage constitue souvent la plus grande part de son impact carbone, car, dans un établissement bancaire lambda, elle peut servir à financer des projets climaticides. C’est donc une démarche éminemment responsable que d’épargner dans un établissement comme la Nef. En revanche, ses services sont souvent plus chers, du fait d’un accès moindre à l’argent très peu cher des banques centrales.
Le financement collectif citoyen
La solution suivante qui peut être mobilisée est le financement collectif citoyen par la prise de parts, à travers plusieurs possibilités :
La première pratique peut être de proposer à des proches de souscrire. C’est une pratique tout à fait adaptée dans le cas de SCIC ou SCOP, et qui permet, par le jeu des collèges, que les fondateurs ne perdent pas la main sur la gouvernance de l’entreprise. Ce peut être mené via le bouche à oreille, à l’image de la levée de fonds coopérative menée en ce moment par Mobicoop (l’Enercoop de la mobilité). C’est aussi possible en passant par des plate-formes de crowdfunding dédiées, proposant la prise de part dans un projet.
La deuxième possibilité est de passer par le réseau des CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire). Une CIGALES est un groupe de particuliers de 6 à 20 personnes qui mettent chaque mois une somme au pot commun, et qui avec prennent des parts minoritaires dans des entreprises en création ou en développement. L’intérêt principal est de faire entrer les entreprises en question dans un réseau. Il existe 8 CIGALES en Lorraine. Pour l’investisseur, c’est un moyen d’être sûr que son argent ne travaille pas contre soi. Ca permet également au banquier de voir que le porteur de projet n’est pas tout seul : il rentre dans un réseau d’appui qui le sort de l’isolement. Il peut arriver que des CIGALES s’endorment, peinant à faire fonctionner leur activité. Mais elles ont dans ce cas d’autant plus de sous : il ne faut pas les oublier ! Une CIGALES ne prend pas plus de 20 % du capital d’un projet. Elle ne recherche pas la lucrativité. Sauf en cas de gros succès, la culbute est extrêmement rare. Chaque investissement se fait pour une durée limitée, permettant que l’argent soit ensuite réinvesti dans un autre projet. Une CIGALES a une durée de vie de 5 ans, renouvelable. Chaque cigalier est engagé à minima sur cette durée. La charte de valeur de tel club est très proche de celle de Kèpos. Leur intervention est beaucoup plus souple que celle de Business Angels, qui peuvent être très intrusifs dans la gestion des entreprises où ils prennent des parts. Il s’agit également de montants plus faibles, qui ont pour objectif de faire levier sur d’autres financements. On est aux alentours de 3000 euros par ticket. Les CIGALES vont sur les projets en lesquels elles croient : il y a donc un vrai filtre, et des refus sont possibles. Le côte collectif de l’investissement permet au porteur de projet de bénéficier d’une vraie prise de recul, et d’un réseau qui peut débloquer des situations. Finalement, l’aspect financier n’est pas forcément le plus important. Cela prouve que l’ouverture du capital d’une entreprise est, pour elle, factrice de succès. Cela doit être anticipé dès la création de l’entreprise, car une augmentation de capital ultérieure coûte cher. Des apports en compte courant sont aussi possible, même si cela est moins souple : il y a plus de latitude d’usage pour du capital que pour de la dette. Les CIGALES sont hélas peu développées en Grand Est : il en existe seulement 12, contre plus de 200 en Bretagne. Cela permet aux Bretons des interventions sur des gros projets, de parcs éoliens par exemple. Il est donc essentiel chez nous que les CIGALES changent d’échelle.
Pour les gros projets, il est possible de mobiliser une sorte d’énorme CIGALES, nommée Garrigue. Celle-ci investit ou prête pour des montants de minimum 50000 €. C’est un dispositif national qui compte pas moins de 4,8 millions d’euros d’en cours. Il fonctionne via une épargne collective. Il est à mobiliser en cas de gros besoins.
Vertus et limites du financement participatif
La troisième solution à explorer est le financement participatif par chiffre d’affaires, avec des contreparties plus ou moins symboliques, voir carrément des pré-ventes. Il existe de nombreuses plate-formes proposant ce service. Côté associatif, on peut noter Helloasso, qui est gratuit et se rémunère via un système de pourboire. Côté entreprise, les plate-forme prennent généralement une commission de 8 % des montants collectés. La plate-forme Zeste, opérée par la Nef, est à signaler : elle fonctionne avec une charte de valeur proche de la nôtre. Elle est de ce fait très sélective sur les projets à financer. Le point clé à retenir est que beaucoup de projets ne savent pas mener leur campagne. Ce type d’opération peut, de ce fait, être très décevant. Alors que si elle est bien menée, elle génère de la trésorerie quasiment immédiatement, et, dans le cas des pré-ventes, du chiffre d’affaires dès le lancement de l’activité. Enfin, elle constitue une très bonne campagne de communication. Quelques points importants sont à retenir :
Il est essentiel, avant toute chose, de se renseigner et se former, en rencontrant des gens qui savent faire ou ont fait. Il existe pour cela un Mooc bien fait sur la plate-forme Helloasso.
Kèpos et le Plan B sont des ressources à mobiliser : ils peuvent à eux deux fournir une assistance, moyennant le paiement d’une quote-part sur les montants collectés.
Il faut maîtriser sa communication : ne pas communiquer sur le financement participatif en cours tant que 10 % de la somme n’a pas été levée, et ne pas parler aux médias tant que 50 % du total n’a pas été atteint : il faut diffuser quand la campagne est déjà en train de marcher.
Il existe des choses qui ne se financent pas par crowdfunding.
Il convient d’être rigoureux dans la gestion de l’après : les contreparties doivent être prêtes avant le lancement de l’opération.
Les contreparties doivent inciter les financeurs à s’impliquer dans la suite du projet.
Il faut être vigilant quant à la saisonnalité.
Le rôle des monnaies locales complémentaires
Cet exposé sur les modes de financement alternatifs est l’occasion de faire un focus sur la monnaie locale complémentaire nancéienne : le Florain. Actuellement, 80000 Florains sont en circulation. Les principes d’une telle monnaie sont les suivants :
Orienter la consommation vers certains acteurs, ayant souscrit une charte de valeur.
Orienter la production vers certaines pratiques ou fournisseurs,
L’objectif est ainsi de mettre en place des cercles vertueux, liés au circuit local de l’argent. Cela fonctionne plus ou moins bien selon les filières.
La Loi ESS de 2014 fixe une parité entre une unité de monnaie locale (ici le Florain) et un euro. De ce fait, tout euro changé en Florain est ensuite mis dans un fonds de réserve dans une banque, en l’occurrence, pour le Florain, la Nef. Celle-ci s’est engagée à prêter un montant égal à deux fois ce fonds de réserve à l’économie locale. Une convention a été signée en ce sens en décembre 2018 entre la banque et l’association du Florain. A l’heure actuelle, le Florain compte 126 adhérents professionnels, et plus de 600 adhérents particuliers. L’objectif est de 1000 adhérents en 2019. Un projet de dématérialisation est à l’étude pour les pros. Le lancement de cette monnaie locale est un succès, et il y a actuellement plus de Florains en circulation à Nancy que de Stücks à Strasbourg. Le benchmark de toutes les monnaies locales françaises est l’Eusko, au Pays basque : l’équivalent d’un million d’Eusko est en circulation, et des entreprises ont pu se pérenniser grâce à cela. Le Florain fonctionne avec un permanent à temps partiel, et des bénévoles. Cela crée une organisation très résiliente, peu dépendante des subsides publics. Une monnaie locale a pour objet de créer du lien, et est toujours liée à un territoire. Pour le Florain, il s’agit du Sud Meurthe-et-Moselle. Il existe donc des groupes locaux en création à Toul, Pont-à-Mousson et Lunéville. Les perspectives sont les suivantes : sortir des subventions, et changer d’échelle pour avoir des impacts sur le territoire (objectif : 1 % des habitants du territoire utilisateurs d’ici 4 ans).
En quoi une monnaie locale est factrice de résilience ? Deux niveaux de lecture sont possibles :
Le fonds de réserve ne va pas au secteur spéculatif. Ceci est théoriquement vrai, mais empiriquement très limité.
En cas de crise grave liée à un effondrement financier global, impliquant une panique bancaire avec une paralysie de la monnaie, une monnaie complémentaire peut paraître être un outil de résilience, à condition qu’elle soit désindexée de l’euro. On n’en est clairement pas là, et il ne faut pas le souhaiter !
Quoi qu’il en soit, et même si une monnaie locale complémentaire n’a pas fonction d’épargne (elle est complémentaire, et pas substituable), ces réflexions doivent introduire à une véritable prise de conscience des impacts écologiques des investissements faits avec l’épargne de chacun : l’argent épargné peut avoir un impact carbone désastreux en fonction de ce qu’il sert à financer !
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
25 mars 2019RéflexionsA l’occasion de la crise dite des « Gilets jaunes », on a pu voir fleurir le rapprochement entre « fins de mois » et « fin du monde », qu’il faudrait réconcilier, et ce de la bouche présidentielle elle-même. Ainsi, la justice sociale et la transition écologique seraient deux approches convergentes. Au centre de ces discours se trouve la question de la résorption des inégalités. Et en effet, les arguments ne manquent pas. Par exemple, Gaël Giraud, de passage pour une conférence à Nancy le 20 mars 2019, affirme que le décile de revenus le plus élevé contribue pour 50% des émissions de Gaz à Effets de Serre (GES). A l’inverse, les 50% de revenus les plus modestes n’émettent que l’équivalent de 10% des GES. Dans le même ordre d’idée, une étude récente du Crédoc affirme que ce n’est pas la sensibilité environnementale des individus qui explique leur empreinte écologique, mas bien leur niveau de vie. Autrement dit, en dépit de ses comportements vertueux ou non, un individu émettra d’autant plus qu’il a des revenus élevés. De ce point de vue, fins de mois difficiles signifient fin du monde éloignée, fins de mois faciles signifient fin du monde accélérée.
Dès lors, est-ce que des inégalités nivelées par le centre signifieraient une meilleure situation écologique ? C’est la thèse de tous ceux qui affirment que les désordres écologiques et les injustices sociales ont la même origine. Celle-ci peut se situer, au choix, dans une certaine anthropologie (cf l’encyclique du Pape François, Laudato Si, qui parle à ce propos de « culture du déchet » comme une caractéristique de notre modernité), ou dans notre système économique capitaliste (d’où les références permanentes au système thermo-industriel que font certains écologistes). Dès lors, apaiser le système en mettant à bas la modernité ou le capitalisme devrait permettre de retrouver à la fois prospérité et planète préservée.
Mais sans aller jusque là, il n’est pas certain du tout que réduire les inégalités favorisent la transition écologique : Gaël Giraud l’affirme : un pays développé strictement égalitaire ne sera pas moins émetteur de GES. Au contraire, l’histoire récente montre que les périodes de très fortes réductions des inégalités sont aussi des périodes de très forte croissance économique, et cela, toujours au dépend des écosystèmes. C’est ce qu’explique par exemple Paul Krugman dans un livre d’économie politique, l’Amérique que nous voulons, paru avant l’élection de Barack Obama. Le Prix Nobel d’économie y explique comment l’après-guerre a été marquée aux Etats-Unis par une très forte compression de la distribution des revenus, liée à un boom économique historique. C’est ce qui s’est passé également en Chine sur les trois dernières décennies : la sortie de centaines de millions de personnes de la pauvreté, et une croissance exceptionnelle. A contrario, la situation mondiale actuelle est une explosion des inégalités, et une croissance anémique, à tel pont que certains économistes parlent de stagnation séculaire.
Que retenir de tout cela ? Le premier point pourrait être que la transition écologique dot être visée en première intention, avant la justice sociale, car les enjeux sont beaucoup plus importants. Le deuxième est qu’il ne faut pas viser un nivellement par le centre des inégalités, mais bien un nivellement par le bas, qui signifie en fait une ascèse généralisée et désirée comme telle. Et c’est bien là ce qui est insupportable à première vue dans l’idée de transition écologique : il faut désirer le moins, et cela pour tous. Car si nous ne le désirons pas, nous l’aurons, c’est certain (nous l’avons déjà un peu), mais en plus au prix de désordres massifs et mortifères pour notre espèce (nous sommes en train de les obtenir). La transition écologique doit être factrice de cohésion sociale : c’est une condition de réussite. Mais, et c’est le troisième point, elle doit déplacer le sens du mot justice sociale: celui-ci ne doit pas être compris comme une égalisation monétaire à la hausse des niveaux de vie, mais bien comme la recherche de la reconnaissance de l’égale dignité de tous dans le fonctionnement de la société, ce qui est tout à fait différent.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]
13 mars 2019RéflexionsKèpos recevait dernièrement Thibaud Diehl, chargé de mission à l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) de Nancy, pour discuter des changements de comportement dans la perspective de la transition écologique. Voici quelques éléments fruits de nos échanges,.
« Tout consomme de l’énergie, et donc émet des gaz à effet de serre (GES) » : telle est la prise de conscience à opérer avant tout changement de modes de vie. Les émissions de GES se mesurent en tonnes équivalent CO2. Il est donc essentiel, à titre personnel, de savoir et de suivre où l’on en est. Quatre postes d’émissions sont à prioriser : l’habitat, le transport, l’alimentation, et les déchets. Il importe également de bien comprendre que l’électricité n’est pas une énergie, mais un vecteur d’énergie, produit à partir d’un combustible, ou de sources renouvelables (en France, essentiellement l’hydraulique). Le numérique est très consommateur de ressources, aussi bien à la production, qu’à l’usage et au recyclage. Il est symptomatique de l’enjeu lié à la récupération d’énergie (par exemple dans les data centers), pour produire soit de l’électricité, soit de la chaleur. Mais quoi qu’il en soit, le domaine le plus consommateur d’énergie est l’habitat.
Le bâtiment est donc plus émetteur de GES que les transports. Or, sur ce sujet, la simple modification de son comportement permet d’atteindre des résultats considérables (jusqu’à 40 à 50 % d’économies d’énergie). Le premier poste de consommation énergétique dans l’habitat est le chauffage : de 2/3 à 3/4 de la facture énergétique d’un logement en Lorraine. Pour ajuster ses usages à ses besoins, ce qui va compter est le temps de sollicitation des appareils. Il faut donc utiliser l’énergie là où j’en ai besoin, quand j’en ai besoin. Cela aboutit à une forme de bien-être : on se sent mieux, car on est en accord avec ce dont on a réellement besoin. La situation dépend également du type de logement que l’on occupe : une grande maison ancienne va plus consommer qu’une petite maison récente, mais il existe toujours des marges de manœuvre pour faire évoluer ses comportements.
Le deuxième poste de consommation dans un logement concerne l’eau chaude sanitaire. Celle-ci va dépendre du nombre de personnes utilisatrices, et du temps d’utilisation. L’efficacité du système va être très liée au débit des points d’eau. Le limiter est l’action prioritaire. Pour avancer, il est essentiel de suivre ses consommations, et de se comparer. A partir de là, on peut agir sur ce que l’on peut, en fonction de sa situation. L’eau chaude représente 900 kWh/pers/an, l’électricité jusqu’à 3000 kWh/pers/an. Sur ce dernier point, la question clé est de savoir si j’ai besoin de tant d’appareils pour vivre. Il est alors possible de changer son comportement et ses modes de vie avant de changer ses appareils, en faisant toujours ce que l’on est prêt à faire. Bien sûr, le potentiel de gains diminue avec le temps. Tout cela revient finalement à hiérarchiser le confort, le financier et les économies d’énergie. Ce changement est rendu aisé par le fait que suivre ses compteurs, chez soi, est relativement simple (beaucoup plus que de mesurer sa consommation d’essence par exemple). Le collectif, le partage de bonnes pratiques avec d’autres, est un très bon moyen d’avancer. C’est le propos du Défi Familles à Energie Positive. L’interface Internet de ce concours est ouverte à tous, et permet d’évaluer ses consommations corrigées du climat.
Le changement de comportement doit venir de soi : imposer aux autres de l’extérieur n’est d’aucune utilité. Mais globalement, on constate que la motivation est avant tout financière plutôt qu’environnementale. Changer est souvent vu comme une contrainte et comme une perte de temps. A tort, le statu quo peut être perçu comme un élément de bien-être. Mais quelque part, il s’agit aussi d’être réaliste, en prenant en compte une réalité non immédiatement accessible, mais qui est en train de remettre en cause notre qualité de vie de manière définitive : des limites physiques propres au système terre ont été franchies, et ce que l’on ne fait pas maintenant va se traduire à terme par un retour du refoulé encore plus catastrophique. Il faut donc être très clair sur ce que va être le monde de demain. Mais il est vrai qu’un discours que l’on rencontre peut être résumé à cette expression : « Changer, c’est dur ». C’est là un trait fort de l’être humain, et cela se justifie même pour des petits gestes. Dans le même temps, le marketing et la publicité savent faire évoluer un comportement. Peut-être y a-t-il là une source d’inspiration. En la matière, tout est question de budget : le budget de la plus grosse ONG environnementale en France, à savoir Greenpeace, est de 20 millions d’euros, là où le budget publicité de Renault, toujours en France, est de 400 millions d’euros. Il est essentiel de savoir travailler sur l’horizon de nos actions. On peut craindre que dans la plupart des cas, l’horizon temporel de chacun soit réduit à quelques semaines, alors que justement, nous devons tous, dans la situation présente, voir plus loin, notamment via ce que nous dit la science. La question est donc de savoir comment porter une argumentation sur une perte à court terme, et ce hors de toutes violences.
Le deuxième domaine d’émissions de GES concerne les mobilités : en la matière, les comportements sont encore plus difficiles à changer que pour l’habitat. Car ici, une personne doit tout changer : son budget, sa gestion du temps, son organisation. Certes, la question des transports est étroitement liée aux politiques publiques mises en place. Mais il ne faut pas chercher le coupable idéal qui nous permettra de trouver une raison de ne pas changer de comportement. Il reste cependant vrai que tout le monde n’est pas capable de faire des économies facilement sur les transports. Les logiques dominantes dans la société ne sont pas vertueuses, que ce soit sur ces questions ou en général, avec des approches très individualistes, mais quelque part, il s’agit de ne pas être la goutte d’eau qui va faire déborder le vase. La contrainte peut être contreproductive sur ces sujets, avec des retours de bâtons sociaux importants, comme le montre l’exemple récent des « gilets jaunes ». Cependant, des effets de seuils peuvent être profitables au changement de comportement : par exemple, la multiplication des cyclistes en ville habitue les automobilistes à partager la rue, et incite d’autres conversions au vélo. Quand l’usage des vélos devient vraiment plus important, la piste cyclable n’est plus utile. L’exemple de l’autre est toujours très incitatif. Et bien sûr, le vélo, qui est la vraie mobilité durable, est facteur d’un grand bien-être. A noter d’ailleurs que l’air est toujours plus pollué dans l’habitacle d’une voiture que sur un vélo à l’air libre, même pris dans le flux de la circulation.
La mobilité est l’exemple type de l’intérêt d’avoir une vision « cycle de vie » dans les choix que l’on fait. Ainsi, la mobilité électrique pose la question de la fabrication et du recyclage des batteries, et de la manière dont l’électricité est produite et transportée. L’électricité est typique également du caractère « dissonant » des choix que l’on peut faire : les énergies renouvelables sont par exemple très ambivalentes en termes environnementaux. L’énergie grise, c’est-à-dire l’énergie nécessaire à la construction, l’opération et le recyclage de l’infrastructure, est compensée, mais quand est-il des autres critères, par exemple de respect de la biodiversité, de limitation de la pollution, etc… ? La méthanisation, qui se fait de plus en plus à partir de cultures dédiées, est un cas d’école. Il importe en tous cas de toujours voir le bilan énergétique global.
Au final, les pistes d’actions sont nombreuses, et laisse une large part à l’initiative individuelle dans un cadre collectif. En la matière, les turpitudes d’autrui ne peuvent justifier l’inaction personnelle.
Emmanuel Paul de Kèpos [...]